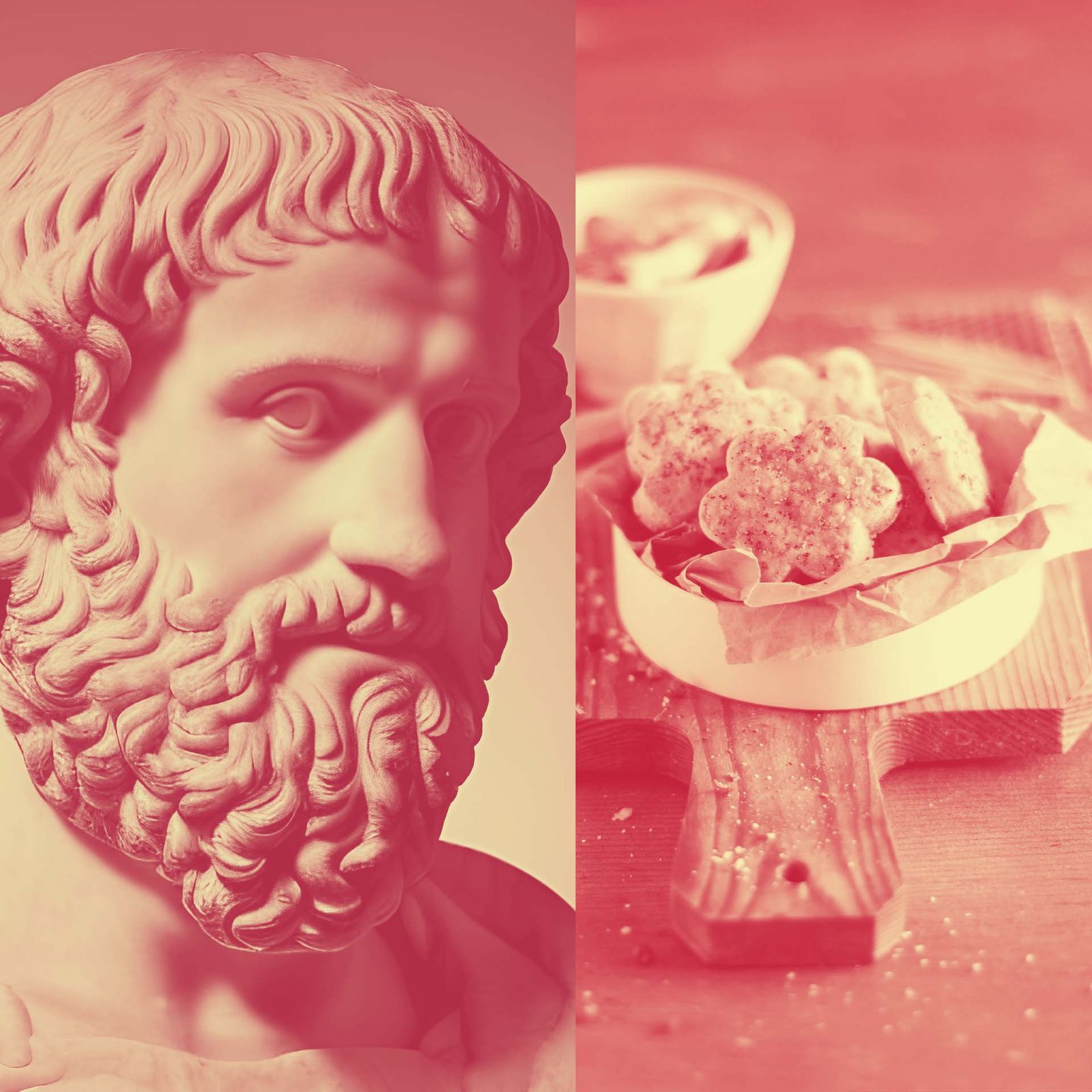Ne pas paver l’enfer de ses bonnes intentions
Texte présenté à Florensac (Hérault) lors de l’Apéro des savoirs de mars 2023.
Je me souviens de mes 20 ans quand, nourri de ma meilleure volonté, il me semblait urgent comme à tant d’autres d’oeuvrer à ce que ce monde aille un peu mieux. L’envie me démangeait de faire ce qu’on appelle de l’« humanitaire ». Mais quelle cause choisir ? Fallait-il lutter contre la faim ? La guerre ? La pollution ? La pauvreté ? La torture ? Une infinité de combats s’offraient à moi.
Un point toutefois me chiffonnait : ces combats, quels qu’ils soient, devaient sans cesse être recommencés. Une famine chasse l’autre, chaque pollution s’ajoute aux autres… J’imaginais Sisyphe traînant péniblement son boulet jusqu’au sommet de la colline, et s’affligeant à chaque fois de le voir dévaler jusqu’en bas. Ce n’était guère encourageant. Car l’humanitaire s’attache le plus souvent à régler les effets d’une catastrophe, d’un tremblement de terre, d’une guerre… mais pas les causes premières sur lesquelles il n’a pas vraiment de prise. L’humanitaire n’empêche pas les guerres, il ne change pas le comportement prédateur des grandes multinationales ou l’accaparement des ressources par quelques-uns. Bien au contraire, il sert souvent d’alibi : qu’importe les inégalités, puisqu’il y aura toujours de bonnes âmes pour porter secours aux plus démunis, ou pour nettoyer nos plages des plastiques échoués.
La politique me semblait donc plus à même d’agir à la racine, en changeant le système lui-même. Je fus donc séduit un temps par des horizons révolutionnaires : puisque ce monde va mal, changeons au plus vite les règles qui le gouvernent. Fallait-il une révolution communiste ? Ecologique ? Spirituelle ? J’étudiais l’histoire et les concepts de chacune. J’en côtoyais des partisans qui, tous, prétendaient agir pour le bien de l’humanité, convaincus de détenir la vérité du chemin vers un monde meilleur. Jamais je n’ai mis en doute la sincérité de leur engagement. Sauf qu’en face, mes ennemis d’extrême droite, les ultra-néo-libéraux de tous poils et autres fondamentalistes religieux avaient de toute évidence les mêmes certitudes. Il n’y avait nul besoin d’être grand érudit pour se rappeler que l’Inquisition, les purges staliniennes ou le « grand bond en avant » maoïste avaient été, en leur temps, décrétés pour le bien du peuple. Et mis en œuvre par des zélotes qui, eux aussi, prétendaient peu ou prou faire de l’« humanitaire ». Des millions sont morts de ces lendemains qui devaient chanter.
En tant que journaliste, je suis contraint de constater que, chaque année, les mouvements révolutionnaires, de quelque bord qu’ils soient, créent eux-mêmes les catastrophes humaines que l’humanitaire s’attache ensuite à réparer. Dès lors que l’on admet qu’une partie au moins de ces révolutionnaires agissent par convictions, une conclusion s’impose : non seulement les bonnes intentions ne suffisent pas à faire le bonheur d’autrui, mais elles peuvent détruire des vies. Hier, l’Occident colonial apportait à coup de fusil ses « lumières » aux peuples dits « sous-développés ». Aujourd’hui, les accusations de néo-colonialisme masquent en retour l’incurie des mouvements dits de libération qui, au Maghreb, en Afrique subsaharienne ou ailleurs, continuent sous leurs beaux discours d’accaparer les richesses au détriment du peuple.
A notre échelle, plus modeste, naïf celui qui croit qu’il suffit de creuser un puits pour abreuver durablement un village en Afrique. Mais cela donne à bon compte l’illusion d’avoir « fait sa part », d’être quelqu’un de bien. Et permet d’oublier notre contribution aux barges de déchets que nos sociétés industrielles continuent de déverser en douce sur les plages du même village, contaminant au passage l’eau du puits à peine creusé.
Les famines, l’extinction des espèces ou le réchauffement climatique ne sont pas des catastrophes « naturelles ». Ce sont autant le résultat de nos égoïsmes que d’idéologies qui prétendent agir pour le bien. Alors que faire ? Devais-je trouver ma vérité et me battre, à mon tour, pour elle et contre celle des autres ? C’eût été confortable pour l’esprit, mais le mien n’était plus dupe. L’urgence ne me semblait plus être de prendre les armes, mais d’abord de mieux choisir son combat.
D’année en année, ma conviction s’est renforcée que derrière chaque catastrophe humanitaire, chaque dysfonctionnement de notre monde, chaque « révolution » ratée ou trop bien réussie se cachaient invariablement les mêmes causes : un manque à la fois d’intelligence ou de bienveillance. La bienveillance qui met les intérêts du groupe au moins au même niveau que les siens, et l’intelligence qui permet de trouver les bons outils pour y parvenir. Et par bons outils, j’entends d’abord ceux qui conviennent à ces autres qu’on prétend aider et au nom de qui on prétend parler. Toute démarche humanitaire, ou prétendument altruiste, me semblait vouée à l’échec si elle ne s’appuyait pas sur ces deux valeurs cardinales. C’est ce que je continue de croire aujourd’hui. D’où Nova Alexandrie, dont la mission est de fortifier, en chacun de nous, ces deux piliers sur lesquels chacun pourra ensuite bâtir sa propre action. Encore faut-il s’entendre sur ces deux termes. Car c’est là en général que le vrai débat commence.
Qu’est-ce que l’intelligence ? Question redoutable. Les sondages montrent qu’une majorité de gens se considèrent plutôt plus intelligents que les autres. Un résultat paradoxal car mathématiquement impossible, et qui démontre l’étendue du travail à entreprendre. On est toujours, quoi qu’on dise et qu’on fasse, le con de quelqu’un. Et mieux vaut d’ailleurs vous inquiéter sur la qualité réelle de votre réflexion lorsqu’un parfait con vous trouve intelligent.
Le Larousse donne de l’intelligence trois définitions principales.
Ce serait d’abord la capacité de raisonner à partir de concepts abstraits. Serait donc intelligent, en somme, celui qui aurait à la fois des idées et de la logique. Nous conviendrons cependant que ces deux qualités ont conduit des cerveaux brillants à théoriser, entre autres, le racisme et l’eugénisme au début du 20e siècle, ou la supériorité de la charia au début du 21e. Le génocide des Juifs, des Arméniens, des Tutsis et autres ont été planifiés par des gens qui, au sens de cette première définition, étaient incontestablement « intelligents ». Ne nous y trompons pas, exterminer efficacement des gens demandent de la rigueur et de la méthode. Himmler n’avait rien d’un idiot. Sans doute pouvait-il se prévaloir d’une grande érudition. Et sa biographie révèle que, jeune homme, il s’était impliqué dans de multiples actions de bienfaisance. Comme quoi…
Le Larousse définit aussi l’intelligence comme « l’aptitude à s’adapter à une situation, à choisir des moyens d’actions en fonction des circonstances ». Soit… Par un étonnant paradoxe, l’intelligence permettrait donc, en somme, de mieux affronter les fléaux que nous réservent les esprits « brillants » au sens de la 1ère définition. On est là dans une vision de l’intelligence plus concrète, pragmatique.
Mais comme la fin – voire la faim – justifie bien souvent les moyens, il est plutôt rare que cette capacité soit mise spontanément au service du collectif. Elle est le plus souvent utilisée à des fins personnelles, accroissant les problèmes globaux au lieu de les résoudre. Car enfin, lorsqu’on est bien adapté à un système, on n’a nulle envie de le changer. Bill Gates a très bien su s’adapter à notre monde… ne comptons pas sur lui pour vraiment le changer, malgré la puissance de sa fondation. Il n’y a strictement aucun intérêt et n’en voit d’ailleurs sans doute pas l’utilité : ce serait détruire l’oeuvre de toute sa vie puisque ce monde est, en partie, le sien.
Le Larousse définit enfin l’intelligence comme le « souci de comprendre, de réfléchir, de connaître » et d’adapter « facilement son comportement à ces finalités ». Plus qu’une capacité, l’intelligence serait donc cette fois une attitude, un trait de caractère, qui consiste à se méfier de ses premières impulsions, à traquer les préjugés qui nous mènent vers de fausses vérités.
Capacité de raisonner dans l’abstrait, de s’adapter à des problèmes concrets, mais en prenant conscience que nous ne savons pas tout, que la vérité n’est jamais une évidence qui s’impose à l’esprit. Que rien n’est ni blanc ni noir, mais que tout est dans cette palette infinie de gris qui rend tout jugement hasardeux. C’est pour englober toutes ces dimensions de l’intelligence que Nova Alexandrie veut être au carrefour de tous les savoirs : les savoirs abstraits, mais aussi concrets, les savoirs vécus, ceux qu’on appelle l’expérience. Parce que c’est cette intelligence globale, enracinée dans le réel mais aussi dans l’empathie, qui nous permet de comprendre qu’on ne résout pas les problèmes de sécheresse en creusant un puits qui sera ensablé six mois plus tard, qu’on n’impose pas, dans des cultures dont on ne connaît rien, des « solutions » qui ne paraissent logiques qu’à nous-mêmes. Les « yaka » et les « faukon » sont les plaies de l’humanitaire amateur, qui masque sous une apparente bienveillance son absence totale d’efficacité. Au moins ça ne fait pas de mal, dira-t-on. C’est à voir. On sait que l’aide alimentaire apportée « généreusement », en Afrique ou ailleurs, peut détruire les réseaux de production locale. Mais elle permet surtout de développer les nôtres. Peut-être serait-il plus efficace – et moins hypocrite – de moins subventionner nos produits et d’acheter un peu plus les leurs, mais au juste prix…
D’où la difficulté de définir aussi ce qu’est la bienveillance. Car il ne suffit évidemment pas de se déclarer altruiste pour l’être. « Moi j’aime le peuple », ânonne Philippe Serrault qui joue un politicien roué dans le film « La gueule de l’autre ». On le croirait presque… Mais reste à le prouver. Qu’en dit là encore le Larousse ? Il définit la bienveillance comme « la disposition d’esprit inclinant à la compréhension, à l’indulgence envers autrui ». On notera qu’il n’est nullement besoin d’aimer autrui pour lui être bienveillant. Et c’est heureux, car rien n’est plus fragile que l’amour. C’est bien parce que chacun entend protéger ceux qu’il aime que les ennuis, à l’échelle globale, commence. L’amour des siens amène très vite à vouloir les protéger des autres, ceux qu’on n’aime pas, par un mécanisme naturel que l’anthropologie appelle « biais de favoritisme endogroupal » : l’être humain s’identifie spontanément à des groupes qu’il cherche tout aussi spontanément à défendre contre les autres groupes. Un mécanisme naturel qui mène vers le racisme – présent dans toutes les sociétés humaines – et les intolérances de tous poils.
Être bienveillant, c’est donc chercher d’abord à comprendre celui qui n’est pas comme moi. Mais pas pour mieux le combattre, comme ferait celui qui n’est qu’intelligent, mais parce qu’on admet qu’il puisse détenir aussi une part de vérité, ou en tous les cas d’humanité, quand bien même il serait l’ennemi idéologique que je combats.
On notera que le Larousse parle d’« indulgence » envers autrui. Un terme malheureux, à mon sens, car l’indulgent se place au-dessus : il pardonne à l’autre, en quelque sorte, d’avoir tort ou d’avoir mal agi. Or la bienveillance, me semble-t-il, va au-delà. Elle est cette capacité à reconnaître qu’il n’y a rien à pardonner, qu’il y a juste à comprendre et à expliquer. Sans pour autant faire sienne la conclusion ou l’action de l’autre. Une capacité à reconnaître qu’il y a des raisonnements qui nous divisent, des actions qu’on ne comprend pas, mais au-delà, un statut d’être conscient et sensible qui nous rassemble tous. Etre bienveillant, c’est d’abord comprendre que nous voulons au fond tous la même chose – être bien, avoir sa place, réaliser ce que l’on est… – mais que notre vécu nous fait diverger sur les moyens d’y parvenir concrètement. La bienveillance est donc l’intelligence appliquée à l’autre, dès lors qu’on laisse se développer l’empathie naturellement en nous (nous mettrons bien sûr à part le cas particulier des psycho et sociopathes).
Est-il intelligent d’être malveillant ? Il faut bien se protéger, dira-t-on. Mais être bienveillant ne signifie nullement que l’on s’interdit de considérer l’autre comme un adversaire. Il l’est objectivement, parfois. Mais il n’est pas pour autant un ennemi, c’est-à-dire un objet de haine dont on souhaite la destruction, l’annihilation. « Trop bon, trop con » ? Ce serait confondre bonté et faiblesse, bienveillance et naïveté. Dans l’art de la guerre, Sun Tzu écrivait, en substance, qu’il fallait connaître son ennemi comme soi-même. On ne combat efficacement que ce que l’on connaît. La bienveillance intelligente consiste donc à reconnaître qu’il y a dans son adversaire les mêmes failles que celles que l’on porte en soi. Que l’on connaît autrui en se connaissant soi-même, et que l’on ne se connaît jamais mieux soi-même qu’en étudiant son voisin.