Origines
Chroniques de Samuel
Livre 1

Illustration : A partir d’une image de Laurian Roo pour Nova Alexandrie
Chapitre I
I.1 – Tempête
Le vent qui sifflait en rafales faisait gémir le bois de notre frêle esquif. Des nuages gorgés de pluie se rassemblaient à l’horizon, dessinant un sombre avertissement : cette traversée ne serait pas aussi tranquille que les précédentes. A l’avant du navire, Perce-neige s’efforçait de cacher son angoisse. Elle avait compris, elle aussi. Les forces qui se liguaient contre nous allaient être d’une puissance colossale. La grande voile claquait dangereusement sous les à-coups lorsque j’accélérai la manœuvre pour la descendre au plus vite.
Nous avions cru que la côte finirait par se montrer. Qu’en redoublant d’efforts, nous finirions par atteindre Nova Alexandrie. Nous savions pourtant que cette cité ne s’offrait pas ainsi d’elle-même à qui voulait la chercher. Qu’il fallait bien plus qu’une boussole pour en trouver le cap. Nous devions forcer en nous le passage qui nous la livrerait.
Des vagues de plus en plus hautes soulevaient le voilier comme un jouet, comme une brindille abandonnée à la fureur des éléments. Les cordages me cisaillaient les mains malgré les gants. « Dépêche-toi! » criait Perce-Neige, la voix couverte par ces bourrasques qui blessaient nos oreilles et nous giflaient le visage. La nuit commençait déjà à tomber. La pluie aussi, en gouttes épaisses et lourdes comme de la grêle. Je tremblais de froid. Après tant d’heures passées à dériver, nous étions épuisés. Il nous fallait pourtant continuer ; nous n’avions plus le choix.
« Le mât… le mât ! », hurla Perce-Neige. J’eus à peine le temps de me déporter. Dans un fracas atroce il tomba quasiment sur moi. La douleur me traversa comme une décharge électrique. Je crus un instant que j’avais la jambe en miettes. Mais la chance était restée de mon côté : je pouvais encore marcher. Je serrai les dents et titubai vers elle.
Quelle folie nous avait poussés à tenter cette traversée ? Qu’importe, il était trop tard pour renoncer. Nous n’avions plus qu’une obsession : survivre. Triompher de cette frayeur qui nous labourait les tripes.
Les nuages qui obstruaient la Lune rendaient la nuit de plus en plus noire. Les vagues se creusaient chaque minute davantage jusqu’à devenir monstrueuses. Un mur d’eau s’avança vers nous et j’eus la certitude que rien, cette fois, ne viendrait nous sauver. Ni la raison, ni la foi. Le navire fut balayé comme une paille et nous fûmes projetés dans l’eau glacée.
Je me débattais, paniqué. Je suffoquais. Le sang bourdonnait dans ma tête, quand je sentis sa main agripper ma chemise. Elle me remonta vers la surface, encaissant les coups que dans l’affolement je lui portais ; et mes poumons purent enfin se remplir d’un grand bol d’air. « Au secours ! » criai-je aussitôt dans un réflexe absurde. Qui pourrait nous entendre en pleine mer ? Ma voix se perdait dans les rugissements mêlés du vent et des vagues.
Une planche émergea à quelques mètres. Je m’y hissai pour reprendre mon souffle. Elle était à peine assez grande pour nous deux, mais en nous y arrimant nous avions l’espoir de survivre encore un peu. Le temps, peut-être, qu’un bateau nous croise sur sa route… Je compris tout de suite la vanité d’un tel espoir. Personne ne nous trouverait au milieu de ces vagues, puisque nous étions entre deux mondes. Dans un no man’s land où la matière n’était déjà plus, mais où les idées n’avaient pas encore assez de force pour s’imposer. Notre destin allait s’achever dans ces limbes obscures et froides.
« C’est fini, Perce-neige, cette fois nous n’y arriverons pas, haletais-je en claquant des dents.
– Non Sam, nous devons encore y croire ! »
Il était clair qu’elle essaierait jusqu’au bout. Moi, je n’étais déjà plus submergé que par l’instinct brut et animal de la survie. Garder la tête hors de l’eau, coûte que coûte. Voler encore quelques secondes de vie.
« Je… je peux y… y arriver. Je sens sa présence, délirait-elle. C’est.. c’est… comme un souffle chaud. Je dois essayer encore une fois. Accroche toi à cette planche… tu survivras ! »
Son ton résolu m’épouvanta, tant il ressemblait à un adieu. J’ai essayé de la retenir. Mais sa volonté était plus forte que ces montagnes d’eau qui se jouaient de nous. Elle inspira un grand coup et plongea. Je la vis couler, happée par les flots sombres. Et je fus bientôt tout-à-fait seul.
Combien de temps suis-je resté agrippé sur mon morceau de bois? Les minutes se dilataient en heures. J’ignorais toujours comment le temps s’écoulait dans cet entre-deux mondes. Les vagues me projetaient comme des montagnes russes. Je luttais pour respirer, guettant le retour de Perce-Neige. Je criais son nom. Je lui en voulais de m’avoir abandonné.
Mes doigts gelés ne sentirent bientôt plus la planche. Mes bras s’engourdissaient. Un brouillard masquait peu à peu l’écume. Une brume de plus en plus épaisse qui étouffait les sons. C’est alors que j’ai vu une pâle lueur se projeter sur la mer. Comme un soleil faible, qui peinait à se lever. D’abord rouge sombre, puis orange, jaune et bientôt d’un blanc éclatant. Une lumière vive et chaude déchira la nuit, presque aveuglante. La mer se figea d’un coup, obéissant à cette lumière nouvelle. Mes doigts ont lâché prise, et je me suis laissé à mon tour couler dans cette immensité liquide qui commençait à se réchauffer.
I.2 – Réveil
Je me suis réveillé dans une chambre d’hôpital. Une infirmière s’affairait près de moi. Je l’entendais me parler dans un français approximatif, sans bien comprendre ce qu’elle essayait de me dire. Ses mots étaient étouffés, elle paraissait si loin. J’étais trop épuisé pour l’écouter. J’ai replongé dans une torpeur ouatée, rythmée de bip-bip lancinants.
Quand mes yeux se sont rouverts, j’ai retrouvé son visage familier. Elle paraissait plus proche à présent. Elle se déplaçait tout autour de mon lit. La brume se dissipait lentement dans ma tête. Je l’entendis demander mon nom.
« Samuel », bredouillai-je, la gorge douloureuse.
Elle me demanda ensuite mon âge et d’autres éléments sans intérêt.
« Où est Perce-neige ? », demandai-je plutôt. Chaque mot labourait ma trachée.
Elle ne répondit pas. Je n’obtins pas plus de réponse du médecin qui m’examina. Pourquoi mes bras étaient-ils si lourds ? Je me suis rendormi pour redevenir une masse inerte.
Le lendemain, mes idées s’étaient éclaircies. J’appris des infirmières que j’étais resté une semaine dans le coma. Une femme de chambre m’avait trouvé, inconscient, sur le lit de la chambre d’hôtel que j’occupais depuis quelques jours dans le centre d’Alexandrie, en Egypte. La jeune femme qui m’accompagnait durant mon séjour gisait à côté de moi, inconsciente elle aussi.
« Perce-neige ! m’exclamai-je. Où est-elle ? »
Le patron de l’hôtel avait appelé la police, craignant une surdose d’héroïne ou d’une autre substance. Mais aucune trace de stupéfiant n’avait été retrouvée. Ni dans nos bagages, ni dans notre sang. Comme nous avions des passeports français, l’ambassade avait pris en charge notre transfert vers l’hôpital anglo-américain.
« Où est Perce-neige ? » insistai-je, hébété, jusqu’à ce qu’enfin on me réponde.
Une infirmière consentit, le jour suivant, à m’amener auprès d’elle. Je compris alors pourquoi ils avaient voulu, par simple humanité, m’épargner d’affronter trop tôt cette épreuve. Mon amie reposait inconsciente, bardée de sondes, au milieu d’une forêt d’écrans qui enregistraient l’activité de son cerveau. Parfaitement immobile, les paupières fermées, dans un coma profond, elle fusionnait avec un large tuyau translucide qui s’enfonçait dans les profondeurs de sa gorge. Je lui ai caressé doucement le visage, prenant entre mes doigts une boucle de ses cheveux. Je me suis lentement accroupi pour pleurer.
Les médecins ne comprenaient pas. Inconsciente comme elle était, Perce-neige aurait dû présenter un électroencéphalogramme quasiment plat. Or, les courbes montaient et descendaient à un rythme hallucinant, selon des séquences qui ne correspondaient à rien de connu. Bien que quasi-morte, elle avait un cerveau infiniment plus actif que le nôtre. Sa consommation d’énergie n’avait rien à voir, non plus, avec celle d’une personne en état végétatif. Elle engloutissait le glucose comme un marathonien. Un médecin m’expliqua que le cerveau consommait normalement jusqu’à un quart de l’énergie de l’organisme. Mais là, on s’approchait de 99 %. Chaque neurone était en activité maximale. Comme si elle n’était quasiment plus qu’esprit. Comment était-ce possible ? Et combien de temps son cerveau allait-il tenir à un tel rythme ? Pour les médecins, son cas était une énigme.
J’ai aussitôt compris qu’elle avait gagné. Et que nous l’avions perdue.
I.3 – L’âme d’un idéal
Aurais-pu la sauver? La protéger à la fois d’eux et d’elle-même? De cet amour démesuré qu’elle portait pour ce monde? Cette question me hante, bien sûr. Je ne viens pas chercher, du reste, en vous racontant cela, votre pardon ou votre indulgence. Ni même votre compréhension. J’essaie juste de ne pas devenir fou.
Perce-Neige m’avait dit, juste avant que nous nous lancions dans cette ultime traversée, que chaque être devait trouver la raison de sa propre existence, et qu’elle était heureuse d’avoir forgé la sienne. Fallait-il que pour cela je perde la mienne? J’aurais voulu lui dire que je n’avais risqué cette invraisemblable aventure que pour rester encore un peu à ses côtés. Que Nova Alexandrie avait pour moi la consistance d’un rêve qui me menait d’abord vers elle. Car elle valait encore plus que ce monde pour lequel nous nous battions. Elle en était devenue l’âme radieuse. Et je l’aurais suivie quel que soit son combat. Mais elle était partie seule, cette fois. Et je n’ai rien pu faire pour l’en dissuader.
Que puis-je faire de plus aujourd’hui, si ce n’est raconter. Expliquer l’idéal pour lequel elle s’est sacrifiée, pour qu’on se rappelle au moins le sens de ce qu’elle a fait. Elle était de ces gens qui vivent pour quelque chose de plus beau, de plus grand qu’eux. Une sainte ? N’exagérons rien. Quoique… nous étions nombreux à avoir foi en elle.
Je me suis rendu chaque après-midi à son chevet, guettant un signe de réveil, le frémissement d’un doigt. J’ai espéré qu’elle ouvre enfin les yeux et qu’elle me parle. Entendre encore une fois le timbre chaud de sa voix, sentir son regard mutin se porter sur moi tandis que d’un sourire elle m’aurait dit : « Sam, ne t’ai je pas promis que je serai toujours là pour toi ? »
En un sens, elle a tenu parole. Car elle me parle encore aujourd’hui. De nous deux, elle est la seule à avoir gardé son éternelle jeunesse. Et la force infinie de ses rêves.
Une nuit, elle s’est envolée. Au petit matin, les médecins ont retrouvé son lit vide. Il n’y avait plus aucune trace d’elle, si ce n’est le drap encore froissé. Personne n’a compris ce qu’il s’était passé. Les caméras de surveillance n’ont rien enregistré. Dans les couloirs, les gardiens n’ont rien vu. Les enquêteurs qui se sont déplacés ont classé l’affaire et sont passés à autre chose. C’est le mieux qu’ils pouvaient faire. Car une chose est sûre : là où elle repose aujourd’hui, elle a enfin trouvé la place à laquelle elle aspirait. Elle a réalisé ce pour quoi elle était née. Et nous veillons sur elle en ce monde, comme elle veille sur nous dans l’autre.
I.4- Secret
J’aimerais vous dire dès maintenant où elle est, et pour quel monde elle s’est battue. Mais vous me prendriez au mieux pour un mystique, au pire pour un fou. Mieux vaut donc raconter depuis le début, même s’il n’est pas certain qu’à l’issue de mon récit vous me considériez toujours comme sain d’esprit. Certains diront que j’ai passé trop de temps dans les livres, que je ne sais plus ce qui est réel. Peut-être… Mais de quoi peut-on vraiment être sûr ? Vous-mêmes, seriez-vous prêt à parier, sur votre vie, que la chaise sur laquelle vous êtes assis n’est pas une production de votre esprit ? Que vous ne vivez pas un rêve éveillé, et qu’il y a bien un monde objectif au-delà des perceptions qui vous envahissent ? Je pense, donc je suis, affirmait Descartes au 17e siècle. Au moins de cela sommes-nous certains. Alors prenons-le au mot. Mais n’en faisons pas un simple jeu d’écriture, une citation convenue. Exister, c’est sérieux tout de même ! Faut-il vraiment penser pour être ? Et le monde, en retour, n’existe-t-il que parce que nous le pensons ? Celui que nous avons parcouru, Perce-neige et moi, était bien réel. Je vous le prouverai.
Je sais qu’en le révélant je trahis certains des Maîtres qui m’ont fait confiance. Il devait rester caché. Durant des siècles, le secret avait été bien gardé. D’une génération à l’autre, ils ne l’ont livré qu’à quelques initiés, gardant closes les portes de leur cité à quiconque n’était pas digne de les entr’ouvrir. Il fallait garder sa perfection.
Quel orgueil ! Quel aveuglement ! J’en rirais si cela ne m’avait coûté ma bien-aimée. Non, leur monde n’est pas aussi parfait qu’ils le voudraient. Il est comme tous les mondes, avec ses parts d’ombre et de lumière, ses héros et ses lâches. Et c’est très bien ainsi. Il est à l’image de nous-mêmes puisque c’est nous qui, en définitive, le construisons.
Je sais surtout qu’il reste en danger. Parce qu’ils voulaient en faire un cimetière, figé dans son immuable perfection. Moi, je préfère la vie. Toujours fragile, toujours instable, prête à se salir pour persister. Vivre c’est bien prendre le risque de s’altérer au contact du réel, non ? De délaver ses idéaux dans l’eau usée des conceptions d’autrui. Vous n’êtes pas d’accord ? Tant mieux, nous en débattrons… Pour l’heure, entendons-nous au moins sur un point : on ne construit pas une cathédrale tout seul. Encore moins une cité, riche de toutes les nouvelles idées qui s’y créent chaque jour. Alors un monde, pensez-donc !
Quel monde ? J’y viens. Mais parce que je veux être sûr d’être bien compris, je vous raconterai tout ce qui s’est passé, sans rien omettre ni cacher. Et comment j’en suis arrivé à ne pouvoir croire moi-même ni ce que je voyais, ni ce que je vivais. Jusqu’à ce que je comprenne enfin ce qui m’est arrivé.
Chapitre II
II.1 – L’appel des vagues
Par où commencer ? Peut-être par cette rencontre providentielle avec celui qui est devenu mon Maître – si je peux me permettre d’anticiper un peu.
Je me souviens surtout de son regard, à la fois tranquille, accueillant et pourtant aiguisé comme un scalpel. Au bord de la falaise, il fixait la Méditerranée comme s’il faisait sienne son immensité sereine. Cette même mer que j’affronterais, plus tard, dans un duel sans merci. J’ignorais à l’époque sa force symbolique, mais je sentais déjà la puissance physique de ses vagues. Ces vagues qui m’appelaient comme le font les sirènes. C’était à mes oreilles un doux chant contre lequel je n’avais ce jour-là nulle envie de me battre. Au contraire. Leur appel était la promesse bienvenue d’une fuite définitive et libératrice; la fin d’un vide qui alors m’étouffait. Dans le ciel, la traînée blanche d’un avion de ligne commençait lentement à s’estomper, trace fugace d’un voyage dont j’ignorais la destinée. Quand cet homme s’est tourné vers moi, j’étais déjà debout sur le parapet, les muscles tendus. Il a tout de suite compris.
« Vous allez faire une belle ânerie », s’est-il contenté de dire.
Le ton de sa voix intimait l’obéissance. Je me suis assis, tétanisé, au bord d’une petite route où ne passait personne. Et nous avons parlé, sa voix posée répondant à mes bredouillements saccadés.
Il attendit patiemment que je me calme. J’entamai alors l’histoire banale d’amours qui se terminent – mal – dans une vie qui sonnait creux. Je vous fais grâce des détails : j’ai presque honte, aujourd’hui, d’avoir importuné ce grand homme avec des tracas qui me paraissent à présent si ordinaires. Mais comprenez que je n’avais guère plus d’une vingtaine d’années, et j’avais pour excuse de n’avoir encore rien vécu de plus dramatique.
Il m’écouta cependant. Et pendant quelques heures, j’eus un confident aussi attentif que bienveillant. Je ne saisirai que plus tard la chance extrême que j’ai eue de rencontrer un Chemineur de son envergure. Je comprendrai, aussi, quel travail et quels sacrifices lui avaient permis d’en arriver à une telle maîtrise. Mais cette fois, n’anticipons pas…
Mes petites déconvenues furent bien sûr vite oubliées. Il démonta en quelques mots mon romantisme à deux sous, dénoua les serments factices que j’avais proférés à mes anciennes muses. Et je me surpris bientôt à rire avec lui de ce qui m’apparaît depuis comme les affres ordinaires d’un esprit trop romanesque. On s’invente les tragédies que l’on peut…
Plus épineuse à ses yeux était la vacuité poisseuse qui emplissait ma vie. Je n’étais pourtant pas plus mal loti que les autres. Je venais d’achever des études de sciences plutôt réussies. J’avais quelques besoins d’argent, comme tout le monde. Un loyer à honorer, une voiture à payer, la perspective d’un voyage que je projetais dans le Péloponnèse. Je gagnais plus ou moins ma vie en écrivant des articles dans différents magazines culturels. Rien d’infamant, et je m’en sortais plutôt bien. Suffisamment pour vivre correctement en tout cas. Mais je ressentais déjà cette impression que tout était joué. Que mon espace de choix se limiterait bientôt aux divertissements qui meubleraient mes soirées, aux formules touristiques qui occuperaient mes congés. Sortir au cinéma ou regarder la télévision ? Visiter Madrid ou Londres ? Telle Madame Bovary, désespérée par sa petite vie provinciale, j’aspirais à mieux. Je sentais passer loin de moi le grand souffle de la vie.
Les missions, pourtant, ne manquent pas pour qui ressent le besoin de s’en attribuer une. Mais sans que je puisse comprendre pourquoi, mon avenir s’enfonçait inéluctablement dans le confort sournois d’un canapé. Je me débattais dans une mélasse sucrée. Disons-le, ma vie suintait l’ennui.
Certains destins ne fleurissent que dans l’adversité. Gandhi, Mandela, Luther King se sont battus chacun à sa façon contre des géants. Mais comment dompter le vide ? Peut-on triompher contre le néant ? Mon ennemi était ma propre envie partagée de tous d’avoir une vie aussi agréable que possible. Et j’étais si désemparé de ne pouvoir forger d’autres objectifs. Je comprends aujourd’hui à quel point je n’étais que le reflet docile et sans génie d’une époque, d’un Zeitgeist ou « esprit des temps », comme le disent si bien les écrivains allemands. Ce début de 21e siècle paraissait englué dans un refus cynique de toute utopie.
Touché par mon désarroi, ce vieil homme promit de revenir le lendemain. Même lieu, même heure. Et nous prîmes l’habitude de nous retrouver, face à la mer, le visage offert aux embruns, pour discuter de ce que j’allais bien pouvoir faire des années qu’il me serait donné de vivre.
II.2 – Dialogues
J’ignore ce que cet être exceptionnel pouvait bien retirer de nos entretiens, lui qui avait croisé des destins bien plus lourds que le mien. Sans doute était-ce justement ma sensation d’insignifiance qui le motivait. Il avait dû y voir un défi. Car donner sens à une vraie tragédie est à la porté du premier apprenti. Mais tirer la substance d’une vie banale à en mourir, voilà qui justifiait les compétences d’un grand Maître. Sans doute aussi a-t-il craint que je ne fusse une proie trop facile pour l’une de ces sectes qui fleurissaient sur la crédulité des âmes en quête d’un nouvel équilibre.
J’avoue l’avoir soupçonné, au début, d’être lui-même un gourou en mal de disciples. Il en avait le charisme, et cet aura de mystère, de profondeur émotionnelle qui entourait chacune de ses phrases. Comment ai-je pu douter de sa sincérité ? Et ne pas voir que son projet était au contraire de prévenir les esprits fragiles de toute tentation de cet ordre.
Son érudition paraissait sans limite. Il maîtrisait l’histoire, de l’antiquité lointaine aux derniers soubresauts des conflits les plus actuels. Mais il me parlait aussi de Platon et de son monde des Idées, peuplé de concepts purs et éternels que nos cerveaux maladroits ne faisaient qu’approcher. Il me décrivait sa République, cité idéale gouvernée par des philosophes éclairés. Etait-elle si aboutie ? Nous convenions tous deux que Platon n’était pas démocrate. Et que sa République élitiste reflétait les préjugés de son temps. Aurait-elle pu affronter les défis d’aujourd’hui ? Nous en avons débattu des heures. Mais plus que Platon, c’était Epictète, l’esclave stoïcien, qu’il aimait citer.
« Un homme capable d’un tel détachement, s’enthousiasmait-il, qu’après s’être fait dérober dans sa cabane toujours ouverte, la lampe en fer qu’il venait d’acheter, il se contentait d’en rire : si le voleur revenait, il serait bien dépité de n’en trouver désormais qu’une en terre. »
Les stoïciens, m’expliqua-t-il, s’appuyaient sur un principe fondamental : le monde est tel qu’il est, et il serait vain de croire que nous pouvons, seuls, le changer. Mais la façon dont nous le voyons nous appartient en revanche totalement. C’est donc bien notre façon de voir les choses qu’il faut d’abord transformer. Et alors, peut-être, le monde lui-même changera.
« Accepte que le monde soit comme il est, et non comme tu voudrais qu’il soit, et tu seras heureux !
– Mais n’est-ce pas se résigner à l’inaction, voire à la lâcheté ?
– Pris au pied de la lettre, j’en conviens, me rétorqua-t-il. Mais le vrai enseignement est ailleurs : il pose la frontière fondamentale entre ce qui dépend de nous – là où nous pouvons réellement agir – et ce qui n’en dépend pas et ne doit donc pas monopoliser nos attentes. Ne te fatigue pas à réclamer d’autrui, ou du destin, des fruits qu’ils ne peuvent pas promettre. Epictète nous invite à nous concentrer plutôt là où nous avons un vrai pouvoir, sur nos représentations et sur nos propres actions. Prends ce monde pour ce qu’il est, sans attente ni préjugé. Mieux, aime-le tel qu’il est est. Nous trouverons ensuite un chemin pour le changer ensemble. »
De là il bifurqua sur la Relativité d’Einstein. Je ne prétendrais pas avoir compris l’intégralité de ses démonstrations, mais il était question, là encore, de représentations : la planète en orbite autour du Soleil, insistait-il, suit en fait une ligne droite, mais dans un espace-temps dont la géométrie-même est courbée par la gravité de l’astre. L’important n’est donc pas tant ce qu’on voit mais ce qu’on en déduit : la planète suit-elle une courbe ou une ligne droite ? Courbe dans le cadre de l’espace-temps absolu de la physique de Newton, droite dans l’espace-temps relativiste d’Einstein. Ni Newton ni Einstein n’a raison ou tort, car ils définissent différemment ce qu’est une ligne droite. Mais on peut juger la richesse et l’efficacité respective des deux systèmes de pensée. La relativité d’Einstein permet d’obtenir de bien meilleurs instruments, comme le GPS qui repose sur ses principes, et explique davantage de phénomènes, que la vieille physique de Newton.
Je devinais chez lui un plaisir évident à me démontrer que le monde dans lequel je vivais, intellectuellement construit par des années de pratique universitaire, n’en restait pas moins une accumulation de préjugés, d’idées reçues. Il n’est de pire sot, martelait-il, que celui qui croit savoir. Et rien n’est plus dangereux que la certitude d’avoir acquis une quelconque vérité. Il en devenait parfois presque agaçant, me poussant sans cesse dans mes retranchements.
Lui-même semblait maîtriser la plupart des sciences. J’appréciais cependant que son savoir ne fût pas qu’abstrait. Ce n’était pas une succession de principes puisés laborieusement dans les livres. Je sentais au contraire chez cet homme une articulation intime avec le vécu, une fusion maîtrisée entre l’essence et l’expérience, entre la raison et les émotions.
Il ne tirait aucune vanité de son écrasante culture. Au contraire, il applaudissait les traits d’esprit que j’arrivais péniblement à lui opposer, comme on félicite le débutant qui, sur un court de tennis, renvoie enfin une balle. Je me sentais désarmé face à l’intelligence d’un homme qui parlait avec la sagesse cumulée de plusieurs siècles d’études, qui pouvait me décrire les joies et les angoisses des plus grands savants de l’histoire comme s’ils avaient été de lointains compagnons de route. Il me parlait de la colère enfouie de Newton, abandonné enfant par sa mère jusqu’à ce que meure le beau-père qui ne voulait pas de lui. Il me décrivait la mélancolie infinie de Darwin quand il perdit sa fille. L’exaltation furieuse d’Evariste Galois qui, à 20 ans, la veille du duel qui lui coûtera la vie, griffonnait à la hâte une théorie des groupes qui révolutionnera les mathématiques du 19e siècle. « Je n’ai pas le temps, je n’ai pas le temps ! », répétait le jeune Evariste avant de laisser ses brouillons à la postérité. Je sentais dans la voix qui m’en faisait le récit l’émotion d’un souvenir toujours vivant. Mais d’où le tirait-il ? Mes cours d’université se remplissaient, au fil de ses récits, d’une saveur nouvelle.
Il était tout aussi capable d’esquisser le futur, comme s’il le voyait de ses propres yeux, me décrivant l’enchaînement prévisible et inéluctable des faits, telle une histoire déjà écrite qu’il aurait vécue. Quand ? Comment ? Si j’avais été croyant, cet homme m’aurait fait l’effet d’un dieu ou d’un prophète.
Il me rassura néanmoins : il était bien humain. Et j’en eus plusieurs fois la preuve quand je le vis plus tard terrassé par un mauvais rhume ou quelques rhumatismes qui s’accumulaient avec l’âge. Peut-être était-il un de ces héros grecs, mi-humain mi-divin ? Face à lui, j’oubliais mes certitudes et m’ouvrais à d’autres réalités.
II.3 – Camille
Je finis un jour par lui demander son nom. « Camille », me répondit-il de sa voix posée. C’est à peu près tout ce qu’il me révéla sur lui. Car cet homme capable de parler de tout, se livrait peu. Je ne sus si c’était par pudeur ou par nécessité. Aujourd’hui, je mesure l’étendue des secrets dont il voulait simplement me préserver.
J’ai partagé avec lui le quotidien des anciens Grecs et des Romains, les angoisses de Pascal face aux espaces infinis, la jubilation des premiers Pythagoriciens devant les mystères de l’arithmétique et celle d’Einstein devant ceux de l’espace-temps. J’ai vécu avec les Templiers. J’ai connu les convulsions de la Révolution française, la soif de liberté des colons d’Amérique. J’ai navigué dans la mythologie des Amérindiens, côtoyé les dieux des Polynésiens. Nos discussions démarraient sur la plage, à l’heure où les baigneurs rentraient dîner. Et ne se terminaient que lorsque le soleil se couchait. Nous nous donnions alors rendez-vous pour une prochaine soirée, dans un perpétuel recommencement. Mon monde, d’un coucher de soleil à l’autre, se remplissait de couleurs nouvelles.
Je sentais chez Camille un plaisir évident à me retrouver. Les réponses que j’esquissais maladroitement aux questions qu’il me posait semblaient le remplir d’une joie sincère. Celle que ressent sans doute le professeur face à un jeune élève qui progresse à grands pas. Une complicité intellectuelle s’établit peu à peu entre nous. Mais pas seulement. Car ses questions bifurquaient à l’occasion sur ce que j’attendais de la vie. Je compris bientôt qu’il ne cherchait pas vraiment à me rendre plus érudit, mais plutôt à savoir jusqu’où pouvait aller mon attrait pour les idées. Il traquait en moi sans état d’âme tout orgueil à vouloir briller, toute inclination à la fatuité gratuite, pour me ramener durement à la posture plus exigeante et vraie de celui qui reçoit avec humilité ce que le monde, pour peu qu’on l’écoute sans artifice, s’efforce de nous dire.
Comme nous marchions un soir sur la plage, nous croisâmes un scarabée, renversé sur le sable, qui battait vainement des pattes pour se remettre sur le ventre. Ses efforts stériles me touchaient. J’y voyais une métaphore profonde de notre propre impuissance face aux forces aveugles de ce monde. J’interrompis Camille pour porter spontanément secours au coléoptère.
Je le pris délicatement et le reposai sur ses pattes. Nous restâmes un moment à suivre sa course lente dans le sable où il finit par se cacher. Nous étions heureux d’avoir, d’un geste trivial, changé le destin d’une infime créature. Camille ne dit pas un mot. Mais dans le regard qu’il me portait, je sentis que quelque chose avait changé.
Après plusieurs semaines de discussions intenses, je fus surpris de trouver un soir à ses côtés une dame d’âge mûr. Leur ressemblance était frappante. Ils étaient pourtant physiquement très différents : alors que Camille était petit et bonhomme, cette dame était plutôt élancée. Mais ils portaient tous deux les mêmes sandales de cuir dont l’usure témoignait des longues marches qu’ils avaient dû mener. Ils étaient vêtus des mêmes tissus amples et grossiers, dont chaque pli semblait obéir à une obscure discipline. Ils avaient l’air – si je peux me permettre cette comparaison – de deux apôtres. Il m’arrive encore d’en rire quand j’enfile aujourd’hui à mon tour mes sandales, en tous points semblables à celles qu’ils chaussaient.
Tous deux avaient surtout ce même regard, cette détermination tranquille, cette bienveillance qui ne vous laissait cependant aucun espace de dissimulation. La voix de cette dame était tout aussi posée que celle de Camille. Et je compris très vite, au flot continu de questions qu’elle m’adressait, qu’elle était à son tour venue me tester.
Je me suis prêté au jeu de bonne grâce. Après tout, ses questions nous entraînaient vers des sujets tout aussi captivants. Tout en marchant sur la plage, nous avons donc discouru d’histoire, de religion, de politique ou de morale. Elle voulait avoir mon avis sur tout. Ou plutôt – je n’étais pas naïf – elle évaluait ma capacité à argumenter mes vues et à en accepter d’autres, radicalement différentes. Elle prenait plaisir à me déstabiliser, à tester ma patience face à des opinions grossières, qu’elle contrecarrait aussitôt par des raisonnements dont la subtilité me laissait sans répartie. Quand l’entretien s’est terminé, je réalisai que le soleil s’était depuis longtemps couché.
II.4 – Académie
« Te sens-tu mieux à présent ? », me demanda Camille au rendez-vous suivant.
Je lui avouai que le monde avait repris bien des saveurs depuis nos discussions.
« Bien, se contenta-t-il de répondre, esquissant un sourire satisfait. Aimerais-tu les poursuivre dans un cadre plus stimulant ? »
Je l’écoutai avec gourmandise. Il me parla d’un domaine, perdu dans la garrigue, dans lequel des esprits curieux, venus d’horizons les plus divers, venaient satisfaire leur passion du savoir et de l’échange. Une Académie, telle que Platon lui-même aurait pu la concevoir s’il avait pu partager les valeurs de notre époque. Le séjour y était gratuit, me rassura-t-il, bien que les dons de toutes sortes y fussent naturellement bienvenus. Il n’y avait qu’une seule contrainte : rester discret sur son existence. Il insista vivement sur ce point.
« Nous réservons pour l’instant son accès à un public sélectionné », justifia-t-il, gêné par les sous-entendus d’une telle politique. Que le plaisir d’échanger des savoirs pût être réservé à une quelconque élite était en effet choquant. Ne devaient-ils pas au contraire être diffusés autant que possible ? Il en convint avec moi. Mais je voyais bien que cette question le mettait mal à l’aise.
« Cette Académie est peu ordinaire, souligna-t-il. Les portes qu’elle ouvre ne peuvent être empruntées pour le moment par tout le monde. Y accueillir des jeunes gens comme toi est déjà le résultat de douloureux débats. Certains équilibres ne doivent pas être rompus trop vite. »
Ces phrases farcies d’énigmes piquèrent ma curiosité. Je fus tout de suite impatient de découvrir ce mystérieux domaine. J’acceptai donc de bonne grâce la contrainte qui me fut imposée de ne m’en ouvrir à personne. De retour chez moi, à Montpellier, dans le studio que j’occupais depuis des années près des universités, je rassemblai mes affaires. Je téléphonai à mes parents, pour qu’ils ne s’inquiétassent pas, leur expliquant que je partais en voyage. Je les prévins que durant plusieurs semaines je serais sans doute très peu joignable. Comme il m’arrivait parfois de partir en reportage, ils n’en furent pas surpris. Je confiai mes plantes à un voisin, qui me fit l’amitié de prendre aussi en pension mon poisson rouge. J’étais prêt.
Si j’avais dit alors à mes parents que je partais au bout du monde, je n’aurais menti qu’à moitié. Car après un long trajet en voiture sur des routes sinueuses puis des chemins terreux, je découvris bientôt qu’il fallait, pour accéder à l’Académie, continuer pédestrement à travers la garrigue et les plateaux calcaires. Aucune route n’y menait. Comme s’ils avaient voulu se préserver de toute visite importune. Ne comptez pas sur moi pour vous en révéler la position : si Camille m’a offert d’y entrer, c’est qu’il avait flairé que j’étais homme à tenir mes promesses.
Je le suivis donc, équipé d’un sac-à-dos dans lequel j’avais fourré quelques affaires, le long d’un interminable sentier de chèvres qui serpentait dans des futaies de chênes verts et d’oliviers. Les crissements de criquets se mêlaient à l’insistance des cigales, dans un rythme lourd, obsédant. Je transpirais. Je hâlais. Mes chaussures butaient sur les pierres. Mais je devinais qu’il était malvenu de me plaindre. J’avançais en silence, mon sac se balançant sur mes épaules. Je compris assez vite que ce chemin de croix avait pour but de mettre ma détermination à l’épreuve.
Camille suait lui aussi comme beurre au soleil. Ses fines sandales ne devaient pas ménager ses orteils. Mais il ne semblait pas en souffrir. Jamais il ne soufflait, arborant au contraire le sourire satisfait du berger qui rentrait au mas. Il connaissait chaque pierre de ce chemin aride, pour l’avoir tant de fois parcouru.
L’Académie finit par apparaître au loin, perchée sur un éperon calcaire. Elle ressemblait à ces châteaux cathares inexpugnables, avec leurs hautes tours et leurs remparts épais. Sa construction, me raconta Camille, remontait à des temps reculés où l’obscurantisme le disputait à un sens certain du merveilleux. Les siècles étaient passés. Les hommes s’étaient déchirés, ici comme ailleurs. Mais les murs étaient restés, bâtis dans cette pierre inerte qui défiait le temps. Camille me parla d’une confrérie, d’un Institut qui en avait pris possession il y a plusieurs siècles, séduit par son isolement propice au recueillement. Un surnom lui fut donné : la Citadelle. Car elle offrait un refuge pour qui voulait se préserver de la fureur stérile du monde. Loin des grandes cités et de leur vaine agitation, elle est longtemps restée à portée de quelques villages de paysans, qui l’alimentaient et donnaient à ses pensionnaires l’occasion de rompre leur isolement. Un cadre parfait pour entamer de longues études. De grands auteurs, m’assura Camille, avaient profité de cet environnement propice pour démarrer ou parfaire une oeuvre. Mais il ne voulut me dire ni qui, ni quand, tenu qu’il était lui aussi par ses promesses de secret. Il me parla d’une bibliothèque gigantesque, contenant des manuscrits originaux du Moyen-Age, et même des restes de papyrus, sauvés lors de la destruction de la grande bibliothèque d’Alexandrie. Ces œuvres majeures appartenaient, depuis, à cet Institut dont l’existence s’était maintenue sans bruit au fil des siècles.
La soif m’asséchait la bouche. Je sortis ma gourde pour en tirer une gorgée tiède, presque chaude. Elle avait un arrière-goût de terre. C’est alors que nous croisâmes deux autres marcheurs. Je reconnus tout de suite l’amie de Camille que j’avais rencontrée sur la plage. Elle me salua, un peu essoufflée. Son compagnon de route, de quelques années plus jeune que moi, semblait épuisé. Assis sur une pierre, au bord du chemin, il haletait et massait ses orteils rougis par la marche. Je fus surpris par l’extrême blancheur de son visage. Ses traits fins, sa chevelure blonde finement bouclée et ses habits de marque, tranchaient avec les étoffes grossières dont était à nouveau vêtue la dame qu’il accompagnait. Je compris aussitôt qu’il avait été, lui aussi, sélectionné pour monter dans la Citadelle. Et qu’il souffrait, plus encore que moi, de l’inconfort de ce chemin rocailleux.
« Veux-tu boire un peu ? lui demandai-je en lui tendant ma gourde.
– Merci. Je meurs de soif. Cette marche est interminable, gémit-il, le souffle encore coupé.
– Tu vas à l’Académie toi aussi ?
– Si je survis à ce coupe-jarrets qu’ils appellent un sentier ! »
J’ai souri et récupéré ma gourde.
« Comment t’appelles-tu ?
– Iris. »
Nous sommes tout de suite devenus amis.
II.5 – Olivier
Après de longues heures de marche, nous finîmes par atteindre la Citadelle. Elle était beaucoup plus massive, vue de près, que ce que sa silhouette lointaine laissait transparaître. Toute en pierres, elle jaillissait par endroits directement du roc, comme si on l’avait voulue indestructible, à l’épreuve des hommes et du temps.
La cour d’entrée abritait un immense olivier qui avait été planté il y a plus d’un siècle. La légende disait qu’un mari jaloux, venu ici chercher refuge après le meurtre de son épouse qu’il soupçonnait infidèle, avait enfoui dans l’humus un frêle rameau en repentir. Le rameau s’était fortifié ; il était devenu ce tronc large aux contours capricieux, au bord duquel venaient s’asseoir les visiteurs, sur ce banc de pierre d’où l’on pouvait surveiller en contre-bas toute la vallée. L’arbre veillait en sentinelle silencieuse sur ce pays de garrigue, de caillasses et de chênes verts.
Le corps de l’épouse violentée reposait, paraît-il, dans cette terre meuble où l’olivier avait projeté ses épaisses racines, et où le meurtrier fut plus tard inhumé à son tour. Leurs corps s’étaient défaits. Ils s’étaient lentement mêlés à cette vie besogneuse et grouillante qui, sous nos pas, digère sans bruit le passé, en décompose jusqu’aux plus profonds souvenirs, pour forger le terreau qui nourrira l’avenir. Qui sait si ce couple, à nouveau réuni dans la fraîcheur grave de l’humus, avait su enfin retrouver une quelconque forme de paix ?
Personne n’était allé vérifier. Remuer cette terre aurait été un sacrilège. Et, à vrai dire, tout le monde s’en fichait. Peu importait que la légende fût vraie ou fausse, la force du symbole n’en était pas moins rappelée au nouveau visiteur : c’est du récit de nos actes que se nourrissent les vies à venir. De ces souvenirs que chacun tisse selon sa propre trame pour en faire émerger quelques bribes de sens. Vite intégré dans la confrérie du lieu, le criminel repenti fit preuve d’un tel dévouement qu’il en devint, au bout de vingt ans, l’un des piliers, éclairant d’une sagesse douloureusement acquise d’autres esprits perdus en quête d’une fragile lumière.
Le tronc noueux, craquelé, boursouflé, exhalait une odeur forte, presque rance, distillée sans doute par les innombrables confidences que venaient lui murmurer les âmes encombrées de secrets. Car il était d’usage de venir se recueillir sous son feuillage, à toute heure, mais plus encore au crépuscule, quand les vieux démons se réveillent et que les masques tombent, pour y puiser la force d’affronter ses faiblesses. L’olivier était devenu, au fil du temps, la mémoire vivante de ces murs. Et si l’huile tirée de ses fruits avait ce parfum enivrant qui en faisait sa renommée, il fallait y voir la marque des insondables souvenirs qui avaient âprement fermenté en une saveur unique. Cette huile était devenue quasiment sacrée. Comme la pierre philosophale des anciens alchimistes, elle avait – disait-on – le pouvoir de transmuter le plomb des regrets en promesse de pardon. Elle était, surtout, symbole d’humilité. Et rappelait à chacun qu’en entrant à l’Académie, on perdait toute prétention à imposer sa vérité.
« Laissez les jugements aux mauvais prêtres », assénait le vieil Isaac, qui dirigeait d’une main ferme la Citadelle depuis déjà vingt-sept ans. « Toujours écouter ce monde, ne le juger jamais » : la formule était gravée dans la pierre, sur le fronton, afin que nul ne l’oublie. Une formule qui résonne aujourd’hui d’une mordante ironie…
II.6 – Maurice
Nous fûmes accueillis par Maurice, un homme aussi vieux que les murs, qui faisait office d’intendant. Petit, râblé, un peu voûté par le poids des années, il avait une voix grêle que l’absence de dents n’aidait guère à comprendre.
Il nous servit tout de suite un rafraîchissement. Une eau claire du puits qui valait, pour peu qu’on eût vraiment soif, tous les vins de grands crus. Iris but son verre d’un trait, puis en redemanda un autre. Maurice parlait peu. Sans doute parce qu’il était dur d’oreille. Ou peut-être parce qu’il n’avait rien à dire. Mais il avait encore des jambes alertes et nous fit faire au pas de charge une visite sommaire des lieux.
Le bâtiment central abritait une grande salle à manger, équipée de lourdes tables en chêne massif entourées de bancs. Une vingtaine de personnes y discutaient bruyamment, tandis que des cuisines attenantes se dégageait l’odeur d’une soupe qui serait bientôt servie. De part et d’autre de cette grande salle s’alignaient quatre pièces, qui faisaient manifestement office de lieux de classe. Les chaises y étaient disposées en U, au centre duquel devait se tenir le professeur. Face au U, un tableau noir occupait le mur. Une profusion de plantes, de statues, tableaux et autres œuvres en pierres ou en bois, réalisés par les pensionnaires, apportaient une chaleur inhabituelle, une vie aussi foisonnante qu’incontrôlée, comme si chacun avait voulu y laisser son empreinte. Le message était limpide : la classe était territoire autant de l’élève que du maître, un espace partagé où chacun avait à coeur de se sentir tout à fait « chez lui ». Le contraste était frappant avec les salles insipides, aux relents de sueur et d’ennui, des universités dans lesquelles j’avais auparavant étudié.
J’avais hâte de découvrir la bibliothèque dont Camille m’avait tant parlé. Elle était située dans un autre bâtiment, derrière la salle à manger, dans ce qui avait dû être à l’origine le donjon de cette place forte. Imposant, ce dernier semblait avoir émergé de lui-même du rocher qui en constituait la base, surplombant la falaise comme un phare. La bibliothèque en occupait quasiment tous les étages. Elle était le joyau, le coeur battant qui irriguait la Citadelle. Maurice poussa en haletant l’épaisse porte de bois qui en gardait l’entrée. Les gonds séculaires crissaient, laissant la porte frotter bruyamment sur la grosse dalle marbrée du seuil. Nous fûmes accueillis par cet air frais à l’odeur de vieille pierre qui est celui des églises.
Nous retrouvâmes à l’intérieur les mêmes tables en chêne, les mêmes bancs rustiques, au milieu d’étagères garnies de milliers d’ouvrages. Il y régnait un silence monacal propice à l’étude, et une senteur un peu âcre, mélange de vieux bois, de papier et de cuir. L’atmosphère était celle d’une abbaye du Moyen-Age, et je n’aurais pas été surpris d’y voir, alignés devant leurs pupitres, quelque assemblée de moines copistes calligraphiant avec soin des traités d’Aristote ou de Thomas d’Aquin. Les meurtrières avaient été élargies en fenêtres qui diffusaient une lumière tamisée.
Dans un angle, un petit salon avait été aménagé. Iris et moi nous nous assîmes un moment sur deux des fauteuils, dont l’esthétique japonisante tranchait avec l’ambiance médiévale de ce lieu. Un vieil asiatique, presque aussi mûr que Maurice, rajusta son kimono et vint d’un pas calme s’incliner devant nous.
Il s’appelait Amako et se présenta comme un authentique maître du thé, accessoirement gardien de cet univers de livres sur lesquels il veillait en pâtre bienveillant mais vigilant : il connaissait, de mémoire, l’emplacement précis de chaque ouvrage, dont il notait méticuleusement tout emprunt sur un carnet. A chaque retour, il inspectait soigneusement les reliures, contrôlait chaque page, recherchant la moindre marque qui trahirait le lecteur indélicat.
Certains des ouvrages dont il avait la garde étaient si anciens qu’il fallait – insistait-il – les manipuler avec le plus grand soin. Il convenait de tourner lentement, presque religieusement, les pages. Et pour cause : il y avait sur ces rayonnages des manuscrits vieux parfois de plusieurs siècles, dont il n’existait de copie nulle part ailleurs. Les plus précieux étaient protégés par des présentoirs en verre et ne pouvaient être consultés que par des mains adéquatement gantées.
Amako m’a raconté, plus tard, comment le destin l’avait mené en ce lieu, lors d’une randonnée solitaire qu’il avait entreprise une vingtaine d’années auparavant dans ces terres sauvages. Il avait quitté Tokyo, dans un moment de désespoir qui avait suivi la perte de sa femme et de ses deux fils. Comment les avait-il perdus ? Etaient-ils morts tous les trois dans un terrible accident, ou sa femme l’avait-elle plus simplement quitté ? Il ne s’exprimait sur ce point que par de longues phrases décousues, qui s’échouaient à chaque fois sur l’impossibilité de décrire avec des mots ce que l’esprit refusait de concevoir.
Toujours est-il qu’il eut l’espoir, en changeant de continent, que les milliers de kilomètres tiendraient ses tourments à distance. Ce fut bien sûr en vain. Il réalisa tardivement qu’il les traînerait partout, où qu’il allât, dans d’invisibles valises. Il n’y avait pas d’issue géographique à la fuite de soi. Il avait erré plusieurs jours, perdu dans ce maquis broussailleux, marchant sans but jusqu’à ce que ses jambes ne le portassent plus. Il avait connu la faim et la soif, la peur des bruits inconnus que l’on perçoit la nuit lorsqu’on couche à la belle étoile. Sans doute serait-il mort d’épuisement, au fond d’une combe, à tourner sans cesse dans des boucles stériles, sale et hagard, si la Citadelle ne lui était apparue, baignée de soleil, comme une promesse de salut. Il avait puisé dans ses dernières forces pour monter le sentier qui nous avait tant fait souffrir nous aussi, les pieds saignant sur les pierres, trébuchant sur les racines qui lézardaient la terre, les vêtements couverts d’une épaisse poussière. Il s’était écroulé sous l’ombre fraîche de l’olivier.
Ayant demandé refuge pour quelques jours, il avait été saisi par l’hospitalité simple des pensionnaires. Nul ne lui avait posé la moindre question. On lui avait ouvert dès le soir une place à la grande tablée fraternelle. Il avait dormi autant qu’il avait pu dans la chambre mise à sa disposition, et s’était lié peu à peu sans façon à ses nouveaux compagnons. Après quelques semaines passées à initier chacun à l’art du thé qu’il avait enseigné chez lui, il n’avait plus voulu retourner au Japon où, du reste, plus personne ne l’attendait. Une grande complicité l’unissait depuis à Maurice qui avait connu, bien des années plus tôt, une histoire en certains points comparable. Tous deux s’étaient donné pour mission de veiller à l’entretien de ces murs où ils avaient trouvé asile. Après nous avoir servi, dans un cérémonial savamment ordonné, un thé vert au jasmin, Amako nous demanda congé et partit à la recherche d’un traité qu’un pensionnaire souhaitait consulter.
Maurice nous fit alors signe de le suivre. Il nous montra nos chambre, dans l’aile Nord du dortoir qui avait été aménagé en s’adossant sur les anciens remparts. Elle était réservée aux nouveaux pensionnaires. Un lit, une petite armoire pour ranger nos affaires, une table et deux chaises : l’atmosphère était spartiate. Les murs en pierres épaisses contribuaient à cette impression de stabilité absolue, de force sereine et sûre d’elle, tandis que le vieux parquet en noyer renvoyait une chaleur agréable. J’enlevai mes chaussures pour y marcher pieds-nus et sentir le contact rugueux du bois durci par des siècles d’histoire. Par la fenêtre, on percevait la garrigue en surplomb. Il régnait dans ces chambres un calme intimidant.
Toilettes, douches et lavabos étaient communs, au bout du couloir. Simples, mais propres. Mieux valait toutefois ne pas aimer l’eau chaude avec excès. Car elle était fournie, marmonna Maurice, par des panneaux photovoltaïques qui s’essoufflaient vite, surtout l’hiver. Il aurait suffi d’en rajouter quelques-uns, mais ceux qui venaient vivre en ces lieux en avaient vite l’intuition : cette absence de confort était volontaire. L’Institut savait se montrer généreux pour l’esprit, mais restait avare à dessein pour les plaisirs du corps.
« L’Académie n’est pas une colonie de vacance », plaisanta Maurice quand il perçut nos mines déconfites. Sans parler d’ascèse, l’ambiance était clairement à la modération. On y promouvait une vie réduite au nécessaire, débarrassée du superflu qui ramollissait la pensée. Je n’eus pas trop de mal à m’y faire. Mais mon ami Iris, qui occupait la chambre à côté, était habitué à plus d’égards.
Il me confia avoir toujours habité chez ses parents, qui avaient beaucoup sacrifié pour qu’il pût se consacrer à ses études. Il démarrait avec quelques années d’avance une thèse de physique théorique dont l’intitulé était d’une obscurité extrême. Ceci dit, qu’il parlât de lui ou de tout autre sujet, ses phrases n’étaient jamais d’une plus grande clarté. Je crois bien qu’il lui était impossible d’exprimer quoi que ce fût en des termes concrets. D’aucuns diraient qu’il cultivait avec soin l’art de vous faire sentir idiot. Comme je lui en fis hardiment la remarque, il rougit mais ne s’en offusqua pas. Je compris bientôt que sous sa rhétorique alambiquée se cachait un coeur simple.
II.7- Rentrée
Rapidement, les séminaires ont commencé. Nous étions une cinquantaine environ, de tous âges, hommes et femmes. Certains, comme Iris et moi, venaient d’arriver. D’autres étaient là depuis des années. Beaucoup revenaient régulièrement pour quelques mois, avant de reprendre le cours ordinaire de leur vie. On y trouvait des ingénieurs, des écrivains, des poètes, des scientifiques, des philosophes et même des religieux. Tous réunis par une même envie de confronter leurs savoirs et d’en forger des nouveaux. Ceux qui avaient acquis une quelconque expertise sur un sujet s’improvisaient professeurs, avant qu’on ne vînt leur opposer une autre façon de voir les choses, et qu’une synthèse ne fût trouvée après de longues – et souvent vives – discussions.
Camille et les autres membres permanents de l’Institut, que nous appelions les Maîtres, se contentaient le plus souvent d’encadrer les débats. Certains Maîtres étaient experts en mathématiques, d’autres en physique, en chimie, en astronomie ou en biologie. D’autres encore étaient philosophes, psychologues, sociologues ou historiens. Quelques-uns, enfin, comme Isaac ou Camille, maîtrisaient plusieurs domaines entre lesquels ils s’ingéniaient à créer des ponts, établissant des connexions audacieuses. Ils avaient gagné le titre ultime d’Erudits. Mais tous, quel que fût leur grade, veillaient à ce que fût maintenue cette bienveillance constante qui faisait l’intérêt de nos débats. Ce n’était plus des joutes verbales, à la manière des scolastiques. Personne ne s’entêtait à l’emporter. C’était plutôt le plaisir partagé d’explorer de nouvelles pistes, d’oser une approche littéraire de la science, un regard scientifique sur la littérature. Nous essayions de mettre de la poésie dans la technologie, ou de discuter sans tabou de la capacité d’un algorithme à créer un poème.
Camille apportait aux débats sa passion de l’histoire, truffant ses récit d’anecdotes dont nous ne savions d’où il les sortait. Les actes les plus insignifiants prenaient sens avec lui, comme inscrits dans une destinée qu’il s’efforçait de dégager. J’appréciais son mélange d’érudition et de simplicité. Cette obsession du sens mêlée à cette certitude qu’il n’est jamais donné, toujours en construction. « Si l’Histoire a un sens, il est loin d’être unique » répétait-il avec un sourire entendu.
Camille aimait mettre en perspective notre époque et ses paradoxes. L’humain y était, en apparence, à l’apogée de sa puissance. Ses machines vomissaient des flots ininterrompus de produits dont on aurait, dans les siècles anciens, à peine rêvé. Voitures, trains, avions, ordinateurs, téléphones, et même prothèses pour remplacer un bras ou une oreille défectueuse… Des machines pour travailler, des machines pour se déplacer et, déjà, des machines pour penser. Or malgré toutes ces machines, l’homme travaille aujourd’hui bien plus qu’un paysan du Moyen-Age, qui n’en avait aucune mais profitait de près de 190 jours fériés dans l’année et besognait, dans les faits, moins d’un jour sur deux. Etait-il, sans machine, moins heureux que nous le sommes ? La question méritait d’être posée.
« La pensée connaît une accélération foudroyante, sans commune mesure avec ce qu’on a pu appeler le miracle grec, qui n’a jamais concerné qu’une poignée d’individus. Les sciences, la philosophie, les arts ne sont plus l’apanage d’une infime élite. N’importe qui, muni d’une simple connexion internet, peut désormais y avoir accès. Et le progrès nourrit le progrès. Le savoir crée de nouvelles opportunités d’accéder à la connaissance. Sauf qu’il manque à tout cela l’essentiel…
– Quoi donc ? demanda spontanément mon ami Iris.
– Un but ! murmura Camille d’un ton théâtral. Le progrès nourrit le progrès, mais pour aller où ? Les machines assurent un profit à ses propriétaires, qui peuvent ainsi produire de nouvelles machines, et générer de nouveaux profits. Produire puis trouver des consommateurs pour continuer à produire, est la grande finalité, le carburant qui fait tourner notre société laborieuse. Et nous y consacrons toutes les ressources de la Terre. Mais alors que les Egyptiens ont légué des pyramides, le Moyen-Age de splendides cathédrales, que laisserons-nous d’enthousiasmant à nos lointains petits-enfants ? Si nous n’y prenons garde, notre époque pourrait bien être appelée, par les historiens du futur, celle du Grand Vide, celle dont il n’est paradoxalement rien resté, si ce n’est quelques bits dans des disques durs d’ordinateur devenus illisibles. »
La discussion bifurqua alors sur une critique des solutionnistes, pour qui les grands problèmes de l’humanité – faim, pauvreté ou réchauffement climatique – allaient se résoudre par quelques algorithmes bien pensés, par de nouvelles « applis » disruptives, faisant fi de la complexité inhérentes aux sociétés humaines.
« Un exemple emblématique, analysait Camille, de pensée sectorisée, qui consiste à ne voir le monde qu’à travers le filtre étroit d’un mode unique de pensée. »
A l’extrême opposé, donc, des valeurs promues dans la Citadelle, qui ne cessait de vouloir créer, au contraire, des liens entre les différentes cultures et représentations mentales. De là, nous enchaînâmes sur les transhumanistes, et leur espoir – sur lequel nous étions divisés – de vaincre la mort elle-même. Un étudiant évoqua les rêves grandioses de colonisation du système solaire et du sens que cela pouvait avoir de poursuivre une telle quête, qui allait mobiliser des générations entières… Chaque sujet en entraînait un autre. Et c’est à regret, le soir tombé, que nous prenions congé, impatients de reprendre dès le lendemain matin le fil interrompu de nos débats.
II.8 – Amitiés
J’ai peu à peu noué à la Citadelle de solides amitiés. De celles qui, scellées autour de valeurs communes et de serments sincères, résistent ensuite à l’épreuve du temps. Nous aimions tous nous retrouver, chaque soir, dans la grande salle à manger. Chacun avait fini par y avoir sa place, comme si nos noms s’étaient peu à peu gravés d’eux-mêmes dans l’épaisseur des chaises. Au bout de la table que nous nous étions attribuée, présidant notre joyeuse assemblée, trônait Rablais. Je ne puis donner son nom exact, tenu par les vœux de secret que nous avons tous formulés. Pour assurer à l’Académie la liberté de penser qui était sa marque, chacun n’y était connu que par un surnom, que l’usage fixait rapidement. Révéler l’état civil véritable d’un frère était considéré comme une offense d’une impardonnable grossièreté. Cela, du reste, n’était à ma connaissance jamais arrivé, quels que fussent les différends qui avaient pu parfois nous opposer.
Nous appelions donc Rablais, sans « e », le chef naturel et autoproclamé de notre tablée. Grand, imposant, envahissant parfois, il semblait vivre tout entier pour ces instants où il allait enfin manger. Tout lui était prétexte à d’interminables ripailles, arrosées de grandes gorgées de vin de pays, qu’il engloutissait avec une gourmandise surjouée : il tenait à merveille le rôle gargantuesque qu’il s’était donné, animant la table de grivoiseries dont le bon goût n’était pas forcément la saveur principale. Il arrivait immanquablement le premier, attendant avec impatience que le cuisinier, qui l’avait naturellement pris en sympathie, vint lui-même le servir. Son verdict gastronomique était sans appel : une grimace de sa part provoquait la consternation, voire la rébellion, de toute la salle. Mais c’est le plus souvent avec force appétit qu’il piquait dans les viandes, se tachait de sauce ou édifiait dans son assiette des tumulus de frites ou des montagnes de pâtes qui croulaient sous le fromage. Comment son estomac pouvait-il supporter les quantités astronomiques qu’il ingurgitait ? Nous laissâmes cette énigme à la médecine. Toujours est-il qu’après son assiette la coutume voulait qu’il finît ensuite une à une les nôtres. En particulier celle de Marie, toujours assise à sa gauche, qui essaya en vain de le convertir aux saveurs subtiles mais fibreuses des légumes que la Citadelle produisait à profusion.
Il était clair que Marie devait son allusion biblique à la douceur angélique de ses traits. Blonde comme les blés, la peau blanche comme une neige tombée dans l’heure, elle accumulait les clichés esthétiques les mieux éprouvés. Elle était, en matière d’apparence, ce qu’un publicitaire appellerait une valeur sûre : une voix calme et mélodique aux intonations positives, des manières de jeune fille bien élevée, et un physique d’actrice pour film à regarder en famille. Le premier soir où elle se joignit timidement à nous, Rablais s’avisa qu’il n’en ferait qu’une bouchée. Il entreprit de la choquer par ses exubérances, comme il en était coutumier. Mal lui en prit cependant, car la jouvencelle lui cloua le bec en quelques citations bien troussées, lui signifiant en râpant ses mots ce que lui inspirait son extrême goujaterie, façon gros sel. Notre imposant ami en resta coi toute la soirée. Ce duel vaillamment remporté avait néanmoins donné à Marie un accès illimité à notre table. Et scellé avec Rablais, qui savait apprécier les forts caractères, une estime solide.
Forest était plus discret. Son surnom provenait, paraît-il, de l’habitude qu’il avait toujours eue de trouver refuge dans les bois. Peu à son aise dans la compagnie des hommes comme des femmes, il aimait les grandes randonnées solitaires dont il revenait crotté de la tête aux pieds, nous racontant comment il avait partagé la tanière d’un renard ou traqué un lièvre toute la nuit. Il était aussi roux que Marie était blonde, le nez grêlé de tâches caramel. Sa grande timidité, doublée d’une extrême générosité, en faisait malheureusement un bouc-émissaire idéal : les corvées d’eau et de pain, qu’il fallait chercher en cuisine, étaient immanquablement pour lui. Il s’en acquittait toutefois avec bon coeur, présentant au passage ses excuses au cuisinier pour les miches qu’il prenait, ou pour la gêne qu’il occasionnait bien malgré lui au robinet. Pour le taquiner, Rablais répétait qu’il l’entendait, la nuit, durant son sommeil, demander pardon pour l’air qu’il avait inconsidérément respiré. Il faisait pourtant preuve, dans son domaine qui était la philosophie, d’une audace et d’un courage intellectuel qui forçaient le respect, y compris des Maîtres. Sa thèse sur les contradictions de la morale kantienne était rapidement devenu un modèle d’argumentation. Il devait malgré tout à Kant le grand principe de sa vie : toujours agir comme si chacun de ses actes avait vocation à devenir universel. Si tout le monde agissait comme moi, le monde en serait-il meilleur ? Cette question était à vrai dire la seule qui lui importait réellement. Aussi mettait-il un point d’honneur à être, en toute occasion, absolument exemplaire. Non pour en tirer un quelconque privilège ou pour plaire aux Maîtres, mais pour être simplement en accord avec lui-même. C’était déjà bien assez, et nous l’admirions pour cela.
II.9 – Mémoires
L’usage voulait que l’on profitât de son séjour à la Citadelle pour écrire un mémoire sur le sujet de son choix. Son utilité était double. Il permettait d’une part de donner sens aux débats que nous avions. Ceux-ci n’étaient plus une pure distraction, mais permettaient d’approfondir une question qui nous tenait à coeur. La bibliothèque de la Citadelle s’enrichissait, d’autre part, d’une multitude d’études originales de qualité, sur des sujets aussi variés que l’origine des mythes africains ou le rétrécissement des longueurs en physique relativiste.
Nous avions une liberté totale pour choisir ce qui allait monopoliser nos recherches. Et nous étions sûrs de bénéficier, quel que fût l’angle choisi, de toutes les ressources disponibles dans la Citadelle. Les Maîtres favorisaient toutefois, autant qu’il leur était possible, la construction de ponts inédits entre les disciplines. Une mythologie de la physique, ou une mathématique de la rime, avaient ainsi de fortes chances de susciter le plus grand intérêt de tous. La volonté était évidente de construire peu à peu une langue commune, une connexion intime entre toutes les formes possibles de l’esprit. Le plus difficile était de choisir, parmi l’infinité de thèmes que l’esprit était capable de concevoir, celui qui allait occuper notre séjour.
Isaac nous reçut donc, l’un après l’autre, pour que nous lui présentions notre projet. Tout, dans ce personnage qui présidait le destin de la Citadelle, nous intimidait. Son érudition était au moins égale à celle de Camille, même s’il préférait les sciences dites « exactes », ou expérimentales, à l’histoire et aux « humanités ». Mais il lui manquait cette chaleureuse bienveillance que dégageait mon Maître. Maigre comme une trique, nerveux comme du bois sec, Isaac semblait n’avoir qu’un but : favoriser l’excellence. Il n’avait aucune indulgence pour la paresse, et traquait sans merci les arguments spécieux. La moindre erreur de langage commise en s’adressant à lui, que ce fût sur un imparfait du subjonctif ou sur une syntaxe mal maîtrisée, déclenchait ses foudres.
« Je vous saurais gré de vous adresser à moi dans le français idoine », assénait-il alors en clignant de l’oeil gauche, comme il le faisait à chaque fois que quelque chose le contrariait.
Nous l’aimions cependant. Car il était évident que ses hautes exigences n’avaient pour fondement que la grande opinion qu’il avait de nous. Et il savait de temps à autres distiller son affection par quelques – rares – compliments, voire d’improbables traits d’humour.
« Pas mal, Chaprot », adressait-il parfois, l’oeil brillant et le sourire en coin, à l’auteur d’une saillie particulièrement brillante. Pourquoi Chaprot ? A quel personnage de la littérature ou des sciences faisait-il ainsi allusion ? Personne, parmi les novices de la Citadelle, n’a pu retrouver l’ouvrage d’où il tirait cette énigmatique citation. Nos demandes d’indices adressées aux autres Maîtres, qui auraient pu nous mettre sur la piste, se heurtaient à un sourire complice. Toujours est-il qu’un « pas mal Chaprot » valait à son récipiendaire une gloire provisoire. Il l’arborait comme une médaille de guerre reçue sur le front de la pensée, et en tirait quelque avantage concret, notamment celui d’être dispensé pour la journée de toute corvée ménagère. Isaac était ce père sévère que l’on craint mais dont on attend chaque jour une marque d’estime, voire de fierté.
Qu’allait-il penser de nos sujets de recherche ? Nous guettions chez lui le moindre signe qui aurait pu trahir un intérêt particulier.
Mon ami Iris choisit sans surprise d’approfondir l’interprétation des observables en mécanique quantique. Cette question ésotérique, dont il avait fait le sujet de sa thèse universitaire, lui tenait à coeur : pourquoi, en physique microscopique, ne peut-on pas mesurer à la fois la vitesse et la position d’une particule avec la précision que l’on veut ? Si l’on souhaite savoir exactement où se trouve un électron, on perd toute connaissance de sa vitesse, et vice-versa. Et pourquoi cette position (ou cette vitesse) n’est elle-même définie que sous forme de probabilités, l’électron n’étant pas connu pour être ici ou là, mais pour avoir, par exemple, 30 % de chances d’être ici et 70 % de chances d’être là ? Que fait-il donc entre deux mesures ? Est-il vraiment indécis, attendant que soit faite la mesure pour se déterminer ? Iris m’expliqua, lors d’un dîner, que c’était peu ou prou l’interprétation donnée dès la fin des années 1920 par l’Ecole dite « de Copenhague ». Ses adeptes rappelaient que la réalité objective nous serait à jamais inaccessible, seule s’offrait à nous la mesure que nous pouvions faire occasionnellement sur elle, mais qui la modifiait, ce faisant, de façon radicale. Mimant le geste à la parole, il se banda les yeux et se mit à explorer les alentours de ses mains, comme à colin-maillard. Comme ses doigts touchaient mon visage, je reculai instinctivement.
« Vois-tu, dit-il, le simple fait de sonder de mes mains mon environnement t’a fait changer de position. J’ai donc, en le sondant, perturbé radicalement l’environnement que je voulais connaître. C’est un peu le problème auquel se heurte la physique quantique. »
Toute mesure, à l’échelle atomique, perturbe en effet l’objet sur lequel nous souhaitons obtenir une information : envoyer un faisceau de lumière sur un minuscule électron pour déterminer sa position modifie évidemment sa trajectoire. Il n’y a jamais de mesure neutre. On ne peut donc plus séparer artificiellement, comme la science l’a fait avant l’avènement de la physique quantique, l’observateur et l’objet observé. C’est l’ensemble qu’il faut considérer dans toute expérience.
Iris était profondément troublé par les conséquences philosophiques que pouvait avoir ce nouveau rapport à la réalité matérielle des objets. Le monde existait-il en dehors des informations que l’on pouvait avoir sur lui ? Et que signifiait alors exister ? La physique quantique avait plongé mon ami dans des abîmes de perplexité. Il en dissertait avec quiconque voulait bien l’écouter. Je ris un jour en le voyant essayer de rallier Maurice à ses vues. Lequel, ne voulant le froisser, opinait continûment du chef en prenant une pose inspirée. Par compassion pour le vieil homme, j’écourtai son supplice, prétextant avoir besoin de lui pour réparer un meuble de ma chambre. Il me suivit sans demander son reste.
La passion et le génie que mon ami Iris mettait dans ses recherches, le très haut degré d’abstraction qu’il atteignait et le talent mathématique dont il faisait preuve impressionnaient fortement Isaac, qui vit en ce jeune homme l’esprit d’exception qu’il attendait depuis des années, si ce n’est depuis toujours. Je peux dire sans grand risque de me tromper qu’il voyait en Iris ce qu’il se souvenait avoir lui-même été au même âge. Une grande complicité intellectuelle ne tarda donc pas à se nouer entre eux.
Rablais avait choisi d’approfondir de son côté des questions de grammaire gastronomique. Il voulait en particulier comparer la grammaire diachronique de la culture culinaire française, c’est-à-dire son organisation en entrée, plat principal, dessert et celle, plus synchronique, des cultures asiatiques et en particulier chinoise, où les plats ont tendance à être disposés tous en même temps sur la table. Quelle était l’origine de telles différences ? Et, surtout, quelles conséquences sociales pouvaient-elles avoir ? Qu’exprimaient-elles de plus fondamental ?
Forest s’était orienté vers la philosophie du pouvoir : peut-on faire de la bonne politique avec de bons sentiments ? La question qu’il s’apprêtait à creuser, à partir d’une étude critique du Prince de Machiavel, entrait en résonance avec les interrogations de nos Maîtres, qui devaient mettre en balance l’importance des valeurs affichées dans la Citadelle et la recherche d’une efficacité dans l’organisation concrète de ce petit monde clos. Machiavel quand il écrit qu’il est « nécessaire à un prince, s’il veut se maintenir, d’apprendre à pouvoir n’être pas bon, et d’en user et n’user pas selon la nécessité », s’inscrit-il totalement dans la vision du monde promue par Thomas Hobbes, selon laquelle l’homme serait un loup pour l’homme, cherchant quoi qu’il advienne son plus grand profit et n’entretenant que des rapports de force ? Ou faut-il au contraire reconnaître en l’humain une propension innée à l’altruisme, au respect de valeurs transcendantes qu’il accepterait librement de suivre y compris contre son propre intérêt matériel ? C’était là le point nodal de la réflexion que Forest entendait mener.
Marie, elle, était d’abord une mathématicienne. Je suis incapable de me souvenir du titre exact de son travail tant il m’apparaissait obscur. Il y était question de cohomologies de Poisson et de dimensions infinies. J’avais malgré tout compris qu’elle voulait établir des parallèles entre ces structures mathématiques dont j’ignorais tout et la construction sémantique de quelques grands mythes récurrents de l’humanité, en s’appuyant en partie sur une analyse symbolique de la pensée alchimiste. Mais sa réflexion était si hermétique que même Iris avait le plus grand mal à la suivre. Sa mission – comme du reste celle de tous les autres étudiants de l’Académie – était donc de nous convaincre que son approche était susceptible d’enrichir la perception que nous pouvions avoir de notre monde.
J’avais décidé, pour ma part, de me plonger sur une question beaucoup moins abstraite. Je voulais profiter de la présence, dans la bibliothèque, de manuscrits antiques introuvables ailleurs, pour me lancer dans l’histoire des sciences et des idées. Je conciliais ainsi le goût du savoir, qui m’était resté de mes anciennes études universitaires, et le sens du récit que j’exerçais dans ma nouvelle activité de journaliste de magazines. Mon sujet était venu à moi par hasard. D’aucuns diraient par providence, mais le recours facile aux dieux pour expliquer son destin personnel n’était pas toujours très apprécié en ce lieu. Parlons donc de hasard – concept à la définition des plus floues – pour qualifier la demande, que me fit un jour Camille, de lui apporter un livre qu’il avait oublié de prendre à la bibliothèque. Il s’agissait d’un traité sur la cité antique d’Alexandrie, dont on ne parlait ici qu’avec respect, émus que nous étions par l’idéal de savoirs qu’elle avait rayonné pendant plusieurs siècles sur toute la Méditerranée. Il y avait dans la bibliothèque une multitude d’ouvrages sur cette cité, son histoire et, bien sûr, la fabuleuse bibliothèque qu’elle avait abritée.
Ce n’était pas sur la bibliothèque elle-même que portait l’ouvrage demandé par Camille. Il s’agissait d’une compilation d’études sur la vie d’Hypatie, une jeune femme qui en fut pour ainsi dire le martyr emblématique. Par réflexe, j’en commençai la lecture. Mais je me surpris à le parcourir d’une traite, ne pouvant refermer le livre qu’après l’avoir fini, tant le destin de cette femme me parut singulier.
« Le souffle de Platon et corps d’Aphrodite », la décrivait Leconte de Lisle dans son poème de 1847. En une phrase, le poète avait tout dit. Une savante dans un corps de déesse : il y avait là de quoi aiguiser la curiosité du jeune homme que j’étais. Sa mort tragique l’amplifiait encore. Car elle avait marqué, au début du 5e siècle après Jésus-Christ, à la fois la fin d’une vie noble et belle, mais aussi celle d’une cité qui avait définitivement perdu son âme, et celle enfin du monde grec dont la lumière s’éteignait avec elle. D’Hypatie, il n’est rien resté : ses écrits ont tous disparu. Mais pas sa légende, qui se confond avec Alexandrie elle-même, et que je découvrais dans un mélange de fascination et de révolte.
Je m’installai confortablement, au petit salon de la bibliothèque, pour poursuivre ma lecture. Malgré le thé noir fumé qui me brûlait la langue, mon esprit fut bientôt absorbé tout entier par cette cité d’Alexandrie dans laquelle Hypatie était née, près de six siècles après qu’Archimède ou Euclide eurent traîné leurs sandales dans sa poussière ocre. Son père Théon était lui-même astronome et mathématicien, côtoyant les nombreux savants qui résidaient au Musée. Il y commentait différents traités, en particulier les fameux Eléments d’Euclide, sur lesquels s’appuieront les mathématiques pendant plus de deux millénaires, et dont plusieurs exemplaires étaient disponibles à la Citadelle. Théon demandait fréquemment à sa fille de l’assister, ce qui n’était pas si courant en ces temps misogynes. J’imaginais l’enfant grandir au milieu des centaines de milliers de rouleaux que renfermait la bibliothèque.
Je me rendis compte alors qu’il n’y avait aucun enfant à la Citadelle. Elle n’accueillait que des adultes. J’en compris assez facilement les raisons : il était plus facile du coup d’y maintenir une atmosphère studieuse. Du reste, l’extrême isolement auquel nous y étions soumis ne favorisait guère l’épanouissement d’enfants ou d’adolescents. Mais il manquait dans ces murs la spontanéité, les rires et l’émerveillement ingénu que l’on retrouvait dans une cour d’école. Les débats que nous y avions manquaient en outre d’enracinement dans ce qui fait pourtant le socle de toute vie humaine : l’inscription dans une chaîne générationnelle, dans les liens affectifs qui nous relient à ce que nous appelons pompeusement « la famille ». Je me fis la promesse d’en parler un jour à Camille et me replongeai dans la jeunesse prometteuse d’Hypatie.
La jeune femme devint à son tour mathématicienne et philosophe, donnant des cours à la jeunesse dorée d’Alexandrie. Ces adolescents venaient-ils pour son éloquence ? Pour sa beauté ? Sans doute pour les deux. Toujours est-il qu’elle avait un immense succès. D’autant qu’elle maîtrisait mieux que quiconque le problème des sections d’Apollonius, l’arithmétique de Diophante, l’astronomie de Ptolémée, les dialogues de Platon, la pensée d’Aristote… Intelligente, donc, et têtue selon certains auteurs. De quoi en faire un personnage attachant. Elle représentait fièrement l’école d’Alexandrie, devenue en cette fin du IVe siècle le centre de la pensée néoplatonicienne. Je notais déjà, sur un petit cahier à spirales, qu’elle tentait par un retour aux écrits de Platon, d’harmoniser les thèses du disciple de Socrate avec celle d’Aristote et des stoïciens. Bref, Hypatie était à la fois l’égérie, la muse et l’esprit d’Alexandrie. Et déjà, je sentais mon destin s’inscrire inéluctablement dans le sillage du sien. Comme si un fil invisible avait traversé les siècles pour faire tenir dans une même trame nos idéaux respectifs.
Sa liberté d’esprit irritait les Chrétiens de l’époque, dont le pouvoir ne cessait de grandir dans la cité, comme dans tout le reste de l’empire romain d’ailleurs, depuis que l’Empereur Constantin s’était lui-même converti.
Théophile, le patriarche d’Alexandrie, avait satisfait les désirs de Rome en détruisant le Sérapeum, le temple de Sérapis qui était la divinité gréco-égyptienne d’Alexandrie. Et les Chrétiens, devenus sourds aux appels à l’amour inscrits dans leurs propres Evangiles, se faisaient de plus en plus menaçants pour les Alexandrins qui tardaient à se convertir. Hypatie s’en moquait : elle côtoyait avec plaisir toutes les communautés, dissertant avec les uns et les autres. Elle aurait fait merveille ici, à la Citadelle, où elle aurait trouvé un écrin à sa juste mesure. Peut-être aurait-elle même réussi à dérider ce vieil Isaac… Et j’aurais suivi avec encore plus de passion les cours qu’elle y aurait donnés. Mais le sort a voulu qu’elle naisse à la mauvaise époque.
Car dès la mort de Théophile, en 412, l’atmosphère d’Alexandrie devint irrespirable. Le neveu Cyrille, qui lui succéda, n’eut plus la tolérance de son oncle envers la belle représentante de la culture grecque. Et la milice qu’il avait constituée chercha le conflit avec le gouverneur. Des affrontements sanglants entre Juifs et Chrétiens se multiplièrent. Cyrille finit par obtenir la destruction des synagogues et l’expulsion des Juifs. Le platonisme qu’enseignait Hypatie, et son appartenance au monde païen, furent vus comme autant d’effronteries qu’il fallait faire taire. Pire, comme une menace pour le développement du christianisme dans l’une des cités les plus importantes de l’Empire. Cyrille prit ombrage que l’autorité intellectuelle et morale d’Hypatie dépassât largement la sienne, qu’on vînt de loin non pour lui, mais pour elle. Elle fut assassinée en 415.
Comment ? C’est là que les versions divergent. Selon Socrate le Scolastique, une poignée de moines l’auraient traînée jusqu’au Caesareion. Là, ils l’auraient dévêtue, outrageant ainsi sa réputation de chasteté. Puis ils lui auraient arraché les membres, les uns après les autres, et auraient brûlé ses restes. D’autres racontent qu’elle fut lapidée, découpée à l’aide de tessons de poterie ou des coquillages. Dans tous les cas, elle fut atrocement massacrée.
J’en pleurais, ému par cette femme que j’imaginais tenant tête à ses bourreaux, opposant à la barbarie religieuse de ces anciens temps la pureté de son âme et de son corps. Je ne pus m’empêcher d’en faire le récit bouleversé à un jeune Dominicain, qui venait parfaire à la Citadelle son goût de la dialectique entre les enseignements théologiques et les nouvelles avancées de la science. Il m’écouta pour ainsi dire religieusement, comprenant mon émotion. Et sa compassion aussi sincère que contagieuse me rassura sur l’aptitude de certains hommes d’Eglise à ne pas reproduire les égarements du passé.
Je décidai, depuis, de consacrer mes recherches à cette histoire. Je m’y suis investi, en vérité, corps et âme, tant cette jeune femme me fascinait. Bientôt, toute l’Académie fut au courant du mémoire que je préparais. Je parlais d’elle avec fougue, comme on parle d’une amante, la défendant aussitôt qu’un cuistre mettait en doute la noblesse de son attitude. Camille suivait avec beaucoup d’intérêt mon travail, suggérant des pistes ou corrigeant des erreurs d’interprétation. Mais je voyais bien que les autres Maîtres de la Citadelle s’enquerraient eux-aussi, discrètement, de l’avancement de mes recherches. Je ne comprendrai que plus tard à quel point j’étais alors surveillé.
II.10 – Méditation
Un dimanche, je décidai de faire faux-bond à mes camarades pour me promener seul dans les futaies de chênes verts qui entouraient la Citadelle. Après avoir salué Maurice qui prenait le soleil du matin sur un banc, je suivis le cours d’une petite rivière qui serpentait dans les alentours et nous alimentait en eau. J’avais besoin d’un peu de tranquillité, et les saules qui bordaient la ravine apportaient une fraîcheur bienvenue. J’avançais les pieds dans l’eau, le pantalon retroussé pour ne pas le mouiller.
Au détour d’un méandre, je surpris Camille qui méditait sur la berge. Il était assis en tailleur, les mains posées sur ses genoux, immobile. Le coin était si reculé, à l’abri de tout sentier, qu’il devait s’y croire absolument seul. Je fus frappé par son extrême détachement. Alors que je m’approchais lentement, il paraissait ne pas m’entendre. Ses paupières étaient fermées, comme s’il dormait assis. Mais je sentais une intense concentration. Je devinais ses yeux qui bougeaient par saccades, derrière ses paupières, comme le font les dormeurs qui rêvent. Son dos était droit, tonique. Ses muscles tressaillaient par moments. Je m’assis à côté de lui et restai immobile à l’observer. Sa méditation dura près d’une heure, durant laquelle sa respiration alternait des accélérations brèves, comme sous l’effet d’efforts intenses, et des rythmes plus lents. A aucun moment il n’ouvrit les yeux.
Il revint lentement à lui et finit par percevoir ma présence. Il fut surpris mais il me sourit. Quand je lui demandai quel genre de méditation il pratiquait et s’il voulait me l’apprendre, il resta évasif, comme gêné par ma question. Nous parlâmes très vite d’autres choses, avant de rentrer tous deux à la Citadelle. Mais je m’aperçus les semaines suivantes que la plupart des Maîtres pratiquaient des exercices similaires quasiment chaque jour.
Ils décrivaient cette méditation comme une pratique spirituelle qui apaisait l’esprit et à laquelle seraient initiés ceux qui, plus tard, voudraient devenir Maîtres à leur tour. Parfois, ils méditaient en groupe, dans les appartements de l’un ou de l’autre, psalmodiant d’étranges vocalises, comme des fragments d’une langue ancienne qui m’était inconnue. L’aura de mystère autour de ces assemblées piquait ma curiosité. J’y voyais d’obscurs rassemblements chamaniques, qui tranchaient avec l’idéal de raison que nos Maîtres professaient.
Je doutais cependant que l’objectif en fût vraiment d’apaiser leur esprit, car ils en ressortaient souvent dans un état de tension inhabituel chez eux. Leurs méditations collectives devenaient, au fil des mois, de plus en plus fréquentes, au point qu’ils y consacraient parfois des après-midis entiers. Cela m’intriguait, m’inquiétait même, mais il aurait été impoli de les questionner davantage sur ce qui relevait, au fond, de leur vie privée.
II.11 – Lavandières
Un matin, je me résolus d’interroger Camille sur un autre point qui nous troublait, Iris et moi. Au cours des promenades qui nous menaient autour de la Citadelle, nous croisions souvent des lavandières qui faisaient la lessive dans l’eau claire de la rivière. La première fois, nous avions cru à un jeu, tant la scène avait un côté surréaliste. Mais l’immense pile de linge qu’elles avaient déposée sur l’herbe fraîche nous avait rapidement détrompés : la lessive de la Citadelle se faisait bien, chaque jour, à la main. Nous en avions discuté avec l’une de ces lavandières, Agnès. Elle nous avait alors expliqué comment, chaque matin, elle récupérait avec les autres les tuniques à laver pour les mener à la rivière ou, quand il pleuvait, au petit lavoir de pierres édifié sur la rive. La tâche était rude, épuisante parfois. Elle pouvait paraître vaine, aussi, puisqu’une machine aurait pu la faire tout aussi bien et bien plus rapidement. Mais elle aimait la chaleur du groupe qu’elle formait avec les autres, et les discussions qu’elles avaient, chaque jour, au bord de la rivière. Iris l’avait regardée, incrédule. Depuis ce jour, il avait veillé à ne plus commettre la moindre tache sur ses affaires.
D’autres incongruités, depuis, nous étaient apparues : la terre était labourée par des ânes. Et c’était à l’aide de charrettes que les légumes et les grains étaient amenés vers les cuisines. La Citadelle semblait tout entière figée dans le passé, avec ses pierres immuables, ses poutres de bois vieilles de plusieurs siècles. Iris, souvent, s’en plaignait. L’atmosphère d’abbaye du Moyen Age ne concernait pas que la bibliothèque mais l’ensemble du domaine. Comme si le progrès n’avait osé parcourir les kilomètres de sentier rocailleux qui menaient à lui. La Citadelle paraissait hors du temps, comme préservée des modes de vie modernes. Pourquoi un tel refus de la technologie ?
Camille fut amusé par ma question.
« L’absence de toute technique ostentatoire n’est nullement un refus de la technologie elle-même. Bien au contraire… »
Je manifestai ma surprise.
« C’est l’expression d’une volonté de mettre la technique réellement au service de l’homme, continua-t-il. Elle n’est pas là pour faire de nous des oisifs. Le travail manuel n’est pas ici une aliénation, mais une occasion de nous insérer dans un processus auquel nous donnons sens.
– C’est-à-dire ?
– L’âne qui tire la charrue, par exemple, fortifie l’alliance que nous avons nouée il y a des millénaires avec l’animal. Grâce à cette activité partagée, il n’est plus seulement bête sauvage ou viande à manger, il devient un allié à part entière sur lequel nous devons veiller. Que crois-tu qu’il adviendrait si nous utilisions des tracteurs : l’âne deviendrait vite inutile et nous n’aurions dès lors plus de remords à le faire disparaître. Sa souffrance-même nous deviendrait étrangère, comme l’est celle des animaux d’élevage industriel, dont nous ne voulons voir que la viande. Nous avons donc décidé de nous passer de tracteur. Et tu peux constater que nos champs sont pour autant impeccablement tenus. »
Il m’expliqua comment la Citadelle était en fait, pour qui savait l’observer dans ses infimes détails, une structure mariant des pratiques millénaires à de la très haute technologie. Si les panneaux solaires paraissaient minuscules, c’était parce qu’ils avaient des rendements que seule pouvait atteindre l’industrie spatiale. L’eau qui parvenait au potager était gérée, au millilitre près, par des microcanaux qui n’en gaspillaient aucune goutte en périodes de sécheresse. Les couteaux que nous utilisions en cuisine avaient l’air rustique, mais ils ne s’usaient jamais, parce qu’ils étaient faits d’une céramique inaltérable… La Citadelle était technologiquement bien plus avancée que n’importe quel autre bâtiment du siècle. Mais à sa façon, dans une symbiose homme-machine aussi discrète qu’efficace. Et subordonnée tout entière au sens que cette symbiose pouvait avoir.
Je fus ainsi surpris de voir un jour, dans une petite pièce attenante aux appartements de Camille, une dizaine d’ordinateurs silencieusement réfrigérés, pilotés par une petite équipe d’informaticiens dont certains avaient travaillé dans les laboratoires les plus avancés de la planète.
Camille me présenta le projet fascinant d’intelligence artificielle sur lequel ils travaillaient. Mon Maître avait donné à ce projet le prénom de sa femme, Alice, qui en avait été à l’origine. Lorsqu’elle fut emportée par la maladie, il y a une dizaine d’années, il lui avait paru naturel de lui rendre ce dernier hommage. J’avoue que je ne partageais pas cette évidence. Je trouvais au contraire perturbant d’attribuer un prénom humain à une intelligence artificielle. Et de recréer, par la réutilisation de ce prénom, l’illusion d’un dialogue avec une morte. Le désir implicite de retrouver une part d’Alice dans ces circuits de silicium me paraissait trop limpide. Nous philosophâmes un moment sur les ambivalences d’une telle expérience. Ce fantasme n’avait rien d’original : ailleurs, des projets existaient déjà, d’agents conversationnels reproduisant la personnalité d’un défunt. Camille voulait tester cette idée, mais en y mettant toute la puissance intellectuelle de l’Académie. Et voir, au passage, si l’on pouvait franchir le fameux test que Turing avait théorisé en 1950 : si un ordinateur quelconque, dissimulé derrière un paravent, parvenait à dialoguer avec nous de telle façon que nous ne puissions jamais savoir s’il s’agissait d’une machine ou d’un être humain, alors nous aurions démontré que cet ordinateur était bien capable d’intelligence et de pensée. Différents laboratoires prétendirent, au cours des années 2010, avoir réussi ce test. Mais il s’agissait de victoires grossières, ne trompant l’humain que quelques minutes. L’émergence de l’intelligence artificielle générative, dans les années 2020, commença à donner plus de substance à cette ambition. Celle de Camille et de son équipe était de réaliser ce que l’on appelait une intelligence forte : une machine véritablement capable de penser, pour comprendre en retour la nature de l’intelligence humaine et notre capacité à créer du sens. C’était une expérience quasi-métaphysique. Mais Camille s’était bien gardé de m’expliquer sur quels rivages exotiques ce projet avait fini par le faire accoster.
Chapitre III
III.1 – Cornelia
Je me souviens du matin où Cornélia est arrivée. Il devait s’agir d’une dame importante, me suis-je dit, car tous les Maîtres lui parlaient avec distance et respect. Grande, élégante, la cinquantaine flamboyante, elle avait l’assurance d’une aristocrate habituée à ce qu’on lui obéît. Maurice lui apporta comme à son habitude un grand verre d’eau pour qu’elle se remît de la longue marche qu’elle avait dû faire pour monter jusqu’à la Citadelle. Elle demanda à être reçue par Camille, puis consacra l’après-midi à consulter des ouvrages à la bibliothèque. Elle s’était enfermée en haut du donjon, dans la petite salle réservée aux Maîtres, où ils pouvaient consulter les oeuvres les plus précieuses et les plus anciennes de la Citadelle. Il s’agissait pour la plupart de manuscrits originaux, conservés dans des conditions strictes de température et d’humidité pour les protéger de l’usure du temps. Pour certains il n’existait, nous disait-on, aucune autre copie. L’accès y était donc strictement réservé. A aucun moment on ne m’avait d’ailleurs invité à pénétrer dans ce « Saint des saints » que les Maîtres appelaient plus simplement l’Annexe.
Pourquoi ne pas numériser les ouvrages qu’elle contenait ? Je m’en étais ouvert une fois à Camille, qui m’avait fait cette réponse sibylline : « les oeuvres les plus sacrées ne prennent sens que dans leur version originale ; et il en est dont il serait très dangereux, ou inconvenant, de voir le contenu possiblement diffusé ». Son ton ferme et définitif m’avait dissuadé d’insister. Je m’étais dit qu’un jour, peut-être, je comprendrais cette entorse énigmatique à la libre diffusion du savoir, dont Camille s’affirmait par ailleurs un fervent partisan. Qu’était venue trouver cette dame dans l’Annexe ? Je l’ignorais. Mais elle en était sortie manifestement satisfaite, à en juger par le sourire inspiré qu’elle arborait en fin d’après-midi. Comme son regard croisa le mien, j’engageai la conversation.
J’appris qu’elle venait du Québec, ce qui expliquait son léger accent, et qu’elle s’était rendue ici pour quelques recherches personnelles. Elle était également venue parler avec les Maîtres de la Citadelle, avec qui elle correspondait régulièrement, car elle développait outre-Atlantique différents projets qui entraient en résonance avec ceux de l’Académie. Elle me fit comprendre qu’elle avait un peu de fortune personnelle, dont elle voulait discuter l’usage avec Camille. Je perçus sans peine qu’entre mon Maître et elle, une solide complicité intellectuelle s’était nouée. Et je n’en fus pas surpris, tant était fort le charisme de l’un comme celui de l’autre.
« Et vous, que recherchez-vous ici ? finit-elle par me demander. Vous écrivez sur Hypatie, m’a dit Camille. Accepteriez-vous de m’en livrer un peu plus, ce soir, après le dîner ? Il se trouve que j’essaie moi-même, depuis de longues années, d’obtenir sur elle quelques lumières nouvelles… »
J’acquiesçai avec joie, trop heureux de trouver une nouvelle oreille attentive à mes travaux. Satisfaite, elle s’éclipsa pour honorer les nombreux rendez-vous qu’elle avait. Elle dégageait une forte aura. Et j’étais surpris de voir comment Camille lui-même semblait intimidé face à elle. Il rougissait comme un étudiant devant un mandarin. Cornélia parlait pourtant avec simplicité. J’ignorais d’où lui venait l’autorité qu’elle avait.
Je mangeai, le soir, aussi vite que je pus, quittant la grande salle commune dès mon repas avalé, pour regagner ma chambre. Rablais fut vexé de ces vilaines manières, mais j’avais fait comprendre à ma tablée qu’un important rendez-vous m’attendait.
Quand j’entendis toquer à ma porte, je la fis entrer, ému et gêné de recevoir cette grande dame dans un intérieur aussi petit que dégarni. Elle s’assit sur l’unique chaise que je possédais. Je lui proposai de boire un vin sans prétention que je gardais pour une occasion. Elle apprécia le geste, consciente qu’elle était du peu que chacun possédait en ces murs. Je m’assis à mon tour sur mon lit pour trinquer timidement avec elle. Après quelques politesses, elle entra sans plus tarder dans le vif du sujet.
Cornélia voulait tout savoir de mes recherches sur Hypatie : quelles étaient mes sources, mes hypothèses de travail, mes pistes à venir. Je lui répondis bien volontiers : tout ce que j’avais lu sur l’égérie d’Alexandrie avait fini par faire de moi l’un de ses chroniqueurs les mieux informés. A travers elle, c’était l’idéal d’un amour innocent et pur des Idées qui m’enflammait.
« Mon grand regret, lui avouai-je, c’est de savoir que je ne la rencontrerai jamais. Je ne sais même pas à quoi elle ressemblait exactement. Nous n’en avons aucune gravure fidèle. N’est-ce pas un peu frustrant de passer ses journées avec quelqu’un qui n’existe plus et dont on n’entendra jamais le son de la voix ?
– Je puis vous assurer que vous n’êtes pas le seul qui désirerait la rencontrer. Mais enfin, peut-être n’a-t-elle pas complètement disparu… »
Je ne voyais pas bien ce qu’elle voulait dire. Elle précisa un peu.
« Vous savez, il y a tellement de façons de ne pas mourir. Devenir une légende en est une, bien sûr. Il y en a d’autres. Peut-être que le monde auquel elle croyait et qu’elle représentait, l’idéal pour lequel elle s’est sacrifiée, n’est pas totalement mort lui non plus. »
La discussion bifurqua sur l’immortalité des valeurs, du Beau ou du Bien selon Platon, et de son monde des Idées qui, par essence, ne pouvait disparaître. « Seules les ombres projetées sur la caverne s’évanouissent, pas le soleil qui les fait naître », ajouta-t-elle, faisant ainsi allusion à la fameuse allégorie antique : Platon, en son temps, avait mis en scène des hommes enchaînés dans une « demeure souterraine », qui n’avaient jamais connu la lumière directe du jour. Ils ne connaissaient, des choses et d’eux-mêmes, que les ombres fuyantes projetées sur les parois de la caverne par la lumière d’un feu allumé derrière eux, les ombres de nos préjugés et des opinions préconçues. L’un d’eux, libéré de ses chaînes, découvrit un jour la lumière crue du soleil. Ebloui, il fit l’expérience douloureuse de la vérité, puis s’habitua à ce monde supérieur. Il ne regagna qu’à contrecoeur celui des faux-semblants de ses compagnons enchaînés. J’y vis, bien sûr, un parallèle évident avec le monde symbolique que voulait être la Citadelle, exposé à la lumière chaude des Idées.
Je perçus aussi que mes propres conceptions intéressaient Cornélia. Plus les verres se vidaient – je finis par trouver une seconde bouteille – et plus elle m’amena à évoquer mes propres rêves et les grands idéaux qui m’animaient. Encore aujourd’hui, j’ai la faiblesse de croire que ma personnalité, autant que mes projets, la séduisaient. Suffisamment, en tous les cas, pour qu’elle prît congé en demandant à me revoir.
III.2 – Nova Alexandrie
Je revis donc Cornélia le lendemain, et nous reprîmes avec plaisir nos discussions. Cette grande dame dégageait la même bienveillance spontanée que Camille, mais la féminité en plus. Et les sandales en moins, qu’elle avait troquées pour des escarpins. Sa robe de couturier tranchait avec la rudesse rustique des lieux. Elle portait même quelques bijoux, ce qui relevait presque de l’hérésie parmi nous. Mais on sentait en elle l’assurance tranquille de celle qui ne se fait dicter ni son allure, ni sa conduite. Elle prenait un plaisir évident à rester en ma compagnie, indifférente aux regards que mes camarades me lançaient. Nous passâmes toute la journée ensemble.
Qu’est-ce qui l’intéressait véritablement en moi ? Pourquoi cette insistance de sa part à me sonder toujours davantage ? Elle n’en révéla rien. Mais je ne doute pas que cet attrait a scellé d’une certaine façon son destin. Car en fin d’après-midi, j’eus l’impression qu’elle voulait me confier quelque chose. Elle hésitait, s’égarant dans des discussions triviales. Son regard fuyait. Après un long silence, elle se lança enfin :
« Vous ont-ils parlé de Nova Alexandrie ? » lâcha-t-elle en prenant ma main.
Je restai interdit. Je connaissais bien sûr l’Alexandrie antique comme ma poche. Mais rien, dans mes lectures pourtant nombreuses, n’évoquait de près ou de loin une quelconque nouvelle Alexandrie.
« Evidemment, on s’est bien gardé de vous en faire la moindre allusion, souffla-t-elle, serrant encore plus fermement ma main. Je n’en suis guère étonnée. L’Institut est si… fermé sur ce sujet, si vieux-jeu malgré leurs beaux sermons. C’est dommage, je le leur ai toujours dit. Car vous êtes tellement fait, vous aussi, pour ce monde. Et il pourrait, en retour, tirer un si grand bénéfice de votre jeunesse, de votre enthousiasme ! Vos idéaux sont purs, puissants. Bien plus que les leurs, en définitive. Car les vôtres ont l’énergie de la jeunesse. Pourquoi ne vous en parlent-ils pas ? Vous y vivriez de si belles aventures! »
Elle lâcha ma main, devinant mon trouble.
« Pardonnez-moi, je me suis emportée. Mais quand je vous vois, quand je vous entends, je devine tant de nouvelles possibilités… »
Elle reprit aussitôt ses distances.
« Il faudra bien qu’un jour ils revoient leur position. Ce monde a besoin de gens comme vous, jeunes, innocents, purs. Il y en a assez des vieilles barbes savantes. Il faut du sang neuf, de nouveaux idéaux. Nous ne leur laisserons plus le choix, de toute façon… Nous n’attendrons pas un siècle de plus. Il va bien falloir les bousculer un peu. Ecoutez-moi… Si vous êtes vraiment fasciné par Hypathie, si vous croyez sincèrement en tout ce pour quoi elle s’est battue, trouvez un prétexte et entrez dans la petite bibliothèque des manuscrits originaux, dans l’Annexe comme ils l’appellent. Lisez ce que vous trouverez sur elle, et sur Nova Alexandrie. Camille n’a pas menti sur vous : plus je vous vois et plus je suis convaincue à mon tour que vous êtes bien l’avenir de ce monde. Il est temps que vous en franchissiez le seuil. »
De quel nouveau monde parlait-elle ? Où était cette Nova Alexandrie à laquelle elle avait fait allusion ? J’attendais avec gourmandise qu’elle poursuivît. Mais elle hésita soudain, prenant conscience d’en avoir sans doute trop dit. Je sentis son enthousiasme retomber d’un coup, figé par le poids des responsabilités qu’elle semblait déjà anticiper.
« J’oubliais que j’avais rendez-vous avec Camille », annonça-t-elle pour couper court à notre entretien.
Je la regardai s’éloigner, le coeur battant, flatté de la haute estime en laquelle elle semblait me tenir, mais troublé par ce qu’elle m’avait confié.
Je sentis le lendemain une grande nervosité parmi les Maîtres. Camille, en particulier, avait l’air préoccupé. Je le surpris plus d’une fois à s’agacer d’une ânerie proférée lors d’un débat. Cela ne lui ressemblait guère, lui qui était d’ordinaire si bienveillant même face aux arguments les plus indigents.
Cornélia se rendit dans l’après-midi dans les appartements d’Isaac. Que se sont-ils dits ? Je n’en sus rien. Mais le grand Maître de la Citadelle en ressortit en colère. Pour la première fois, je le vis hors de lui, maugréant et tapant du pied dans une pierre. Il resta toute la soirée d’humeur exécrable. Avec mes camarades, nous étions désemparés face à cette tension dont nous ne comprenions pas l’origine.
Cornélia m’accosta discrètement dans la serre où je m’étais rendu pour méditer au calme. Cette vaste véranda abritait une multitude foisonnante de plantes exotiques ou médicinales dont nous étudiions les propriétés. Il y régnait une chaleur moite qui comprimait un peu la poitrine, mais au moins y étais-je épargné de la mauvaise humeur passagère de nos Maîtres. Je m’étais assis sur un banc, contemplant une orchidée sur laquelle une coccinelle venait d’élire domicile, indifférente à l’agitation superficielle des lieux. Cornélia vint s’asseoir à côté de moi. Elle inspira profondément.
« Samuel, j’ai bien peur d’avoir semé hier un vent de panique en vous parlant, sans y être autorisée, de Nova Alexandrie. On m’en fera payer le prix, d’une façon ou d’une autre. Mais je ne regrette rien. Parce que vous en valez la peine. S’ils ne veulent pas le voir, tant pis pour eux. Ce ne sont plus mes affaires. Néanmoins, je ne veux pas vous compromettre davantage, car c’est vous qui en définitive en souffririez. Ce serait tellement injuste. Oubliez donc un moment ce que je vous ai dit. Nous nous reverrons bientôt pour en reparler dans un cadre plus serein. Ces vieilles barbes, de toute façon, ne m’impressionnent plus. Isaac n’a aucun pouvoir pour me faire taire. Ici, peut-être. Mais pas chez moi, au Québec. Cette crise était inévitable. Elle était écrite depuis des siècles. Et il fallait bien qu’elle éclate. Je pars demain. Mais je reprendrai très vite contact avec vous. »
Je sentais de la colère retenue dans sa voix. De l’énergie, aussi. Celle que l’on mobilise avant une grande bataille. Mais elle ne voulut pas m’expliquer davantage.
« J’en ai de toute façon déjà beaucoup trop dit, s’excusa-t-elle. Je dois aussi protéger les quelques amis que j’ai ici. Quoiqu’il fallait bien passer à l’acte un jour. Vous êtes la bonne personne, celle que nous attendions. De cela, au moins, je suis sûre et je ne suis manifestement pas la seule. Faites-moi juste une promesse que vous comprendrez plus tard : quoi qu’il arrive, ne trahissez pas Hypatie à votre tour. »
Je le lui ai juré, sans bien comprendre.
J’ai dormi cette nuit-là d’un sommeil agité. Cornélia m’avait fait forte impression ; elle m’obsédait. Mais plus encore, cette Nova Alexandrie qu’elle avait évoquée commençait à infiltrer mon esprit. Elle y germait comme une graine mûre déployant dans un terreau fertile ses premières racines. Etait-ce la façon mystérieuse dont elle m’en avait parlé ? Ou le fait que j’associais ce mystère à la personnalité forte de sa messagère ? Je me réveillai plusieurs fois en sursaut, comme sous l’effet d’un puissant excitant. La lune quasi-pleine projetait dans ma chambre une faible lueur qui me tint compagnie une partie de la nuit. Je profitai de ces moments d’insomnie pour chercher de ma fenêtre, sur la voûte céleste, les quelques constellations que je connaissais.
III.3 – Abîme
Je me réveillai le lendemain, fatigué et tendu. Sortant à pas lourds de ma chambre, je fus surpris du silence inhabituel qui régnait dans les couloirs où je ne croisai personne. Je descendis les escaliers, en quête de mes compagnons de dortoir. Ils étaient tous dehors, devant l’olivier de la cour, entourant une forme allongée sur le sol. Je m’approchai, jouant des coudes pour me faufiler parmi les chuchotements de la foule. Mon sang se figea : la forme qui gisait était le corps raidi de Cornélia, le visage marqué par la douleur. Je restai sidéré, effrayé comme mes camarades par ce cadavre qui imposait la violence obscène de la mort dans notre communauté d’idéaux abstraits. Brutalement, la matière semblait vouloir reprendre ses droits sur la pensée.
Des vagues de murmures s’entrechoquaient, par contagion, parmi les pensionnaires attroupés. Beaucoup ne voulaient tout simplement pas croire ce qu’ils voyaient. Les Maîtres nous demandèrent de nous écarter pour qu’André, le médecin de la Citadelle, pût examiner le corps.
Comme Cornélia se soignait pour des problèmes de coeur, André songea naturellement à un infarctus, provoqué sans doute par la chaleur et la fatigue de la longue marche qu’elle avait dû faire pour se rendre jusqu’ici. Les signes cliniques en étaient selon lui évidents. Un autre médecin, dépêché sur place, confirma dans la journée le diagnostic. Et les analyses qui furent faites les jours suivants ne remirent pas en cause cette hypothèse.
Mon Maître resta longtemps éprouvé par ce décès. Je le voyais partir, le matin, pour de longues promenades solitaires. Toute la Citadelle communiait dans une douleur respectueuse. Une cérémonie simple mais belle fut organisée dans ce qui avait été autrefois une petite chapelle. Nous n’étions pas croyants, pour la plupart. Mais nous n’en étions pas moins soucieux de donner à la mort toute sa place et son sens. Le corps avait été aussitôt rapatrié au Québec, où l’attendait sa famille, mais les pensionnaires qui avaient connu Cornélia ressentaient le besoin de marquer eux aussi leur deuil, à leur façon.
Un groupe d’étudiants composa donc en sa mémoire un court requiem. Maurice et Amako rappelèrent les petites marques d’attention qu’elle avait toujours eues pour eux, prenant à sa charge les lourds frais médicaux de l’un, offrant d’authentiques estampes japonaises à l’autre. Isaac rappela, dans un discours vibrant, l’engagement constant de Cornélia en faveur du savoir. Sans fausse pudeur, il insista aussi sur le soutien financier qu’elle avait régulièrement apporté à la Citadelle, mettant à son service une partie de sa fortune personnelle que je compris immense. Son décès était une perte inestimable, dans tous les sens du terme.
Il était clair que nos Maîtres s’en sentaient vaguement coupables. Ou tout au moins responsables. Les problèmes cardiaques de Cornélia leur étaient connus. Aussi, beaucoup estimèrent que les fortes tensions qui s’étaient développées, la veille du drame, l’avaient sans nul doute affaiblie et provoqué l’accident. Ils s’en voulaient de l’avoir rudoyée, malgré les différends qui les opposaient. Pour beaucoup, Cornélia était une adversaire idéologique obstinée, mais pour aucun elle n’était une ennemie.
De mon côté, je repensais aux confidences qu’elle m’avait faites, à la colère qu’elle avait suscitée chez certains de nos Maîtres la veille de son décès, à l’hypothèse, qu’elle avait elle-même formulée, qu’on lui ferait « payer le prix » de ses confidences. Il avait été de toute évidence incroyablement élevé…
Ses paroles me hantaient. Je n’en comprenais pas le sens. Un jour, n’y tenant plus, je profitai d’un moment d’étude avec Camille, seul avec lui dans son appartement, pour évoquer cette Nova Alexandrie à laquelle Cornélia avait fait si mystérieusement allusion.
Il me fixa comme s’il avait vu un fantôme. Il resta un moment silencieux, comme indécis. Je lus dans ses yeux une sourde inquiétude, jusqu’à ce qu’il se reprît.
« Cornélia t’en a donc parlé? Elle n’aurait pas dû. Il était trop tôt. Bien trop tôt pour cela. Son impatience nous a mis en danger. Elle l’a payée hélas de bien cruelle manière… J’aimerais pouvoir t’en dire plus, sois-en sûr. Mais ce n’est vraiment pas le moment. Ce serait trop dangereux, pour toi comme pour moi. Et pour beaucoup d’autres encore. Aussi je t’en conjure : si tu mènes des recherches sur Nova Alexandrie, car je suppose que tu vas le faire quoi que je puisse te dire pour t’en dissuader, reste discret. N’en parle à personne. Pas même à tes amis les plus proches. N’évoque jamais ces recherches lorsque tu es dans la Citadelle. Et n’en fais pas plus allusion à l’extérieur. Laisse-nous le temps de gérer ce… regrettable accident. »
Il se mura de nouveau dans un long silence, puis m’invita derechef à rester très prudent et me donna congé.
Je ruminais, prenant très au sérieux son avertissement. La mort de Cornélia m’avait moi aussi affecté. J’y devinais comme un sombre présage. Hypatie, Nova Alexandrie... qu’y avait-il derrière ces noms qui pût justifier de telles tensions et craintes parmi les Maîtres ?
III.4 – Disparition
Une semaine plus tard, trois nouveaux Maîtres furent accueillis à la Citadelle. Ils affichaient une mine sévère, comme s’ils voulaient marquer jusqu’à l’excès la solennité du moment. Nous comprîmes à demi-mots qu’ils étaient de très grands Érudits, au savoir aussi étendu que celui d’Isaac lui-même, qui les reçut avec une déférence presque obséquieuse. Je compris qu’ils représentaient l’Institut, vague réseau auquel Camille avait parfois fait allusion et dont semblait faire partie la Citadelle.
Nos propres Maîtres avaient pour ces visiteurs un respect teinté de crainte. De fait, ils ne s’adressaient pas à eux avec cette simplicité fraternelle que nous leur avions toujours connue. Quand nous leur demandâmes qui étaient ces trois invités qui les intimidaient tant, nous n’obtînmes que des réponses évasives. Mais nous comprîmes que l’avenir-même de la Citadelle pouvait dépendre des conclusions que ces mystérieux Érudits allaient tirer de leur séjour parmi nous. J’imaginais que cela devait avoir un rapport avec la mort de Cornélia. Mais Camille lui-même me fit comprendre qu’il ne pouvait répondre à mes questions indiscrètes.
Un matin, du reste, mon Maître disparut. Personne ne savait où il était. Il ne se présenta pas au séminaire qu’il devait animer. Le lendemain non plus. Inquiet, je toquai à la porte de son appartement, craignant qu’il ne fût malade. N’obtenant pas de réponse, je me résolus à tourner la poignée. La porte n’était pas fermée. Après un moment d’hésitation, j’entrai d’un pas inquiet dans l’intimité du logis. Il était à peine plus grand que nos chambres, si ce n’était la présence d’un petit salon personnel – deux fauteuils-clubs sans âge de chaque côté d’une table basse – et d’un recoin aménagé en cuisine. Accéder au rang de maître ne donnait manifestement guère accès à de quelconques avantages matériels. Un peu de vaisselle sale traînait encore dans l’évier. J’en fus étonné, tant mon maître m’avait habitué à une plus stricte discipline. Ses affaires étaient dans son armoire. Je remarquai néanmoins qu’il y manquait quelques vêtements, à en juger par les étagères vides. Les tiroirs de son bureau étaient encore ouverts, comme si Camille avait dû partir précipitamment, n’emportant avec lui que le strict nécessaire. Une brosse à dents était d’ailleurs toujours là, posée dans un verre.
Qu’était-il devenu ? Les Maîtres ne répondaient à nos questions que par un silence embarrassé. Personne ne l’avait vu quitter la Citadelle. Pas même Maurice, que j’avais évidemment tout de suite questionné. Une rumeur bientôt émergea, selon laquelle Isaac l’aurait missionné pour négocier auprès du Vatican la consultation de documents – des manuscrits apocryphes ? – détenus par l’Église catholique. D’autres s’imaginèrent qu’il était peut-être tombé dans une ravine le long du chemin escarpé qui menait au premier village et rentrèrent bredouille de toutes les battues qu’ils organisèrent pour retrouver son corps dans les broussailles en contre-bas. Avait-il eu plus simplement des problèmes personnels ou familiaux? Etait-il hospitalisé quelque part, encore trop faible pour passer un coup de téléphone et nous rassurer ? Nous ne lui connaissions aucune famille que nous aurions pu contacter. Son patronyme nous était par ailleurs inconnu. Nous ignorions même si Camille était son vrai prénom. La discrétion absolue dont la Citadelle et ses membres s’entouraient était une force mais aussi, par moment, une grande faiblesse.
Je ne savais trop, pour ma part, qu’en penser. Toutes les hypothèses étaient plausibles, bien que le silence prolongé des Maîtres rendît celle d’une mission secrète fort improbable : une confidence, un regard complice, aurait fini par fuiter. Il était plus naturel de croire qu’eux-mêmes n’avaient aucune idée de ce qu’il était advenu de leur pair. J’avais cependant quelques raisons de soupçonner des scénarios plus tortueux. Il était clair qu’un conflit couvait au sein de la Citadelle, dont les novices étaient tenus soigneusement à l’écart. Nos Maîtres avaient beau surjouer l’entente fraternelle, ils masquaient avec peine des tensions dont je devinais par moments l’extrême violence. Je m’en tenais néanmoins à distance: Camille lui-même ne m’avait-il pas enjoint de rester discret ? Après la mort tragique de Cornélia, puis l’arrivée de ces trois mystérieux Inquisiteurs qui nous interrogeaient régulièrement sur le contenu des enseignements et des discussions que nous avions avec nos Maîtres, j’avais du mal à considérer sa disparition comme une simple coïncidence. Mais quel était le lien entre ces événements ? Mon esprit n’émettait que des conjectures aussi farfelues qu’invérifiables. Aussi préférai-je me réfugier dans le travail, finissant de lire tout ce que la grande bibliothèque comptait d’ouvrages, à la fois sur Alexandrie et sur Hypatie. Guettant aussi une occasion d’aller fureter, sans attirer l’attention, dans l’Annexe réservée aux Maîtres…
III.5 – Fille de l’ombre
J’appris en même temps que les autres que Camille avait une fille. J’en fus très étonné, car malgré l’intimité que nous avions nouée, jamais mon Maître ne m’avait parlé d’elle. Aucune photo n’ornait son bureau, ni son appartement. Comme s’il avait pris soin de dissimuler son existence. Pour nous tous, la découverte de cette fille cachée fut donc un choc. Car on ne peut pas dire que sa visite à la Citadelle passa inaperçue.
Quand je l’entrevis dans la cour, je compris aussitôt l’origine du remue-ménage qui troublait la quiétude ordinaire des lieux : jeune, assurément belle, elle avait un regard pénétrant qui vous marquait au fer rouge.
Elle avait parcouru le sentier à dos de mule, pour s’épargner la fatigue d’une longue marche. L’épuisement se lisait malgré tout sur son visage un peu rond, dont les traits tirés trahissaient des nuits que j’imaginais sans sommeil. La robe claire dont elle s’était vêtue faisait ressortir sa peau mate, tandis qu’un chapeau de paille protégeait les longs cheveux noirs qui chutaient en cascade sur ses épaules. Des chaussures de toile blanche achevaient de lui donnait l’allure d’une adolescente perdue.
Rablais et Forest ne parlèrent très vite que d’elle. D’ordinaire silencieux comme un lichen, notre ami à poils roux devenait aussi bavard qu’un jeune chiot. Il aboyait en rafales, nous narrant avec excitation la venue en ces terres rudes et rustres d’une jeune fée métisse, comme le racontera Marie elle-même avec ironie. Pendant longtemps, la scène sera colportée d’un pensionnaire à l’autre, chacun y rajoutant un détail merveilleux de son cru. La mule devint cheval, évidemment blanc. A moins qu’elle ne fût portée dans un grand palanquin, comme certains se plurent bientôt à l’imaginer. D’autres allèrent jusqu’à évoquer une éclipse de Soleil, ou prétendaient avoir entendu le tonnerre gronder dans un ciel pourtant sans nuage. Les faits, je puis vous l’assurer, furent plus modestes : la jeune femme se contenta de se rafraîchir un peu, de s’entretenir avec Isaac, puis d’examiner l’appartement de son père, sans doute à la recherche d’indices qui auraient pu apaiser ses inquiétudes. Car nous apprîmes qu’elle vivait elle aussi sans nouvelle de Camille depuis des semaines. Maurice m’annonça qu’elle avait demander à me voir.
J’entrai dans l’appartement de mon Maître, sans idée aucune des raisons qui incitaient sa fille à vouloir me parler. Pour toute réponse, elle me servit une tasse de thé. Ses gestes étaient calmes et exécutaient une chorégraphie dont je perçus tout de suite l’harmonie. Je compris d’instinct qu’il valait mieux ne pas se fier à son visage d’ingénue. La seule façon dont elle posait la cuillère sur la tasse témoignait d’un art parfaitement maîtrisé, d’un contrôle total de ses gestes. Je me sentis très vite comme un astéroïde piégé dans le champ gravitationnel d’une étoile, ne cherchant d’ailleurs aucunement à me libérer de cette puissante attraction, comme si l’entreprise m’eut paru totalement vaine. Je l’observais plutôt, sans prendre la peine de me cacher. Elle avait de toute façon pleinement conscience de l’effet qu’elle exerçait. Je devinais qu’elle en jouait un peu, flattée sans doute par la facilité avec laquelle elle obtenait, de tout le monde, absolument tout ce qu’elle voulait.
Son visage traduisait un métissage subtil entre l’Europe, l’Afrique et l’Asie. Je ne savais à quoi ressemblait sa mère, puisque Camille ne m’en avait montré aucune photo, mais elle était forcément d’origine africaine ou asiatique. A moins que ce ne fût des deux.
« Ne cherchez pas, répondit-elle à mon regard inquisiteur. J’ai des origines partout… Il n’y a pas un seul continent qui n’ait imprimé sa marque en moi. »
Elle marqua une pause qui me laissa suspendu à sa voix, puis elle reprit :
« Je ne suis en fait d’aucun d’entre eux. Ou plutôt, je suis de tous à la fois… »
Sa voix ondulait, m’entraînant malgré moi, comme si elle accrochait mon attention pour m’amener là où elle voulait. Si tant est qu’elle voulait véritablement quelque chose.
« Quand j’étais enfant, continua-t-elle sans plus me regarder, mon père me répétait que j’étais une synthèse de toute l’humanité. Il m’appelait son arc-en-ciel, car il disait que ma peau rassemblait toutes les couleurs. Il en était plutôt fier… Mais vous vous doutez que je ne suis pas venue pour parler de moi. Est-ce que je peux vous poser quelques questions ? »
Sa demande était purement formelle : j’aurais été incapable de lui refuser quoi que ce fût. Elle me demanda quelques renseignements anodins. Comment, en particulier, j’avais rencontré son père et sur quoi portaient nos discussions. Elle s’exprimait avec un léger accent, tout aussi indéfinissable. Je n’aurais pu dire s’il avait des consonances anglaises, allemandes ou espagnoles. A moins qu’il n’eût des intonations chinoises, par moments. Sa voix avait un timbre chaud, intriguant, un mélange d’harmoniques qui déclenchait spontanément en moi un flux d’émotions, comme un chant subliminal. Je me surpris bientôt à lui parler de souvenirs très intimes sans ressentir la moindre réserve. Mes mots sortaient d’eux-mêmes, sans que je n’en eusse à aucun moment le contrôle. C’était une expérience quasi-hypnotique.
J’estimais son âge à une vingtaine d’années tout au plus. Je saurai plus tard qu’elle en avait un peu moins, mais elle dégageait, dès qu’elle parlait, une maturité qui incitait au respect. Il était clair qu’elle était tout sauf naïve. Sous ses faux airs d’adolescente, elle avait manifestement bien plus vécu que nous tous. Sa voix résonnait d’expériences multiples, de joies comme de peines, de colères grondantes ou d’espoirs chuchotés. On y décelait le chant d’une chaîne infinie de sentiments mêlés.
« Je vous intrigue, sourit-elle enfin.
– Plutôt, bredouillai-je. N’en prenez pas ombrage, mais votre père ne nous a jamais parlé de vous. Votre venue, ici, est donc pour nous tous une surprise. Je dirais presque un choc. Ce que je vais dire vous paraîtra sans doute obscur, j’avais toujours pensé que Camille avait bien une fille. Mais une fille disons… purement spirituelle, dont il me parlait souvent.
– Hypatie ? »
Je fus surpris de l’entendre prononcer tout de suite son nom.
« Oui, mon père vous a forcément parlé d’elle… Il était obsédé par elle. Elle envahissait toute la maison. Quand j’étais petite, il en parlait tout le temps ; parfois il passait des journées entières à essayer de dessiner son visage, comme s’il essayait de figer un souvenir ou un rêve. Je me suis souvent demandé s’il l’aimait plus que ma mère, voire plus que moi. J’en étais jalouse…
– Je le sentais intéressé par ce personnage, mais j’ignorais que sa passion allait si loin.
– Elle allait bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer, croyez-moi. »
Je décelai un soupçon de colère dans sa voix.
« Il lui a consacré sa vie… soupira-t-elle.
– Mais pourquoi ? demandai-je. Je reconnais qu’Hypatie est attachante. Fascinante, même. Mais il y a tant d’autres personnages intéressants dans l’histoire des sciences! »
Elle remua longuement la cuillère dans sa tasse, décrivant une succession de spirales de plus en plus lentes.
« Hypatie a quelque chose en plus. Elle est la clé, lança-t-elle. Vers quelque chose de grand, qui nous dépasse tous.
– … vers Nova Alexandrie ? »
Ces mots étaient sortis malgré moi. Elle blêmit.
« Qui… qui vous en a parlé ?
– Deux personnes, très récemment. L’une est morte, l’autre vient de disparaître. »
Elle me fixa, interdite. Je perçus son inquiétude comme si elle sortait de moi-même.
« En parler à votre tour, à qui que ce soit, serait une très mauvaise idée… Je ne sais pas ce que Cornélia ou mon père ont pu vous en dire, mais vous feriez mieux de garder leurs confidences pour vous. »
Il y avait dans sa voix un mélange d’angoisse, de bienveillance mais aussi d’autorité. Il était clair qu’elle me donnait l’ordre – amical mais explicite – de me taire.
« Mais pourquoi, enfin? Qu’est-ce que Nova Alexandrie exactement ? Une malédiction, comme celle de Toutankhamon ? Une conspiration secrète ? »
Ces mystères répétés commençaient à m’agacer.
« Au contraire ! Mon père m’en parlait comme d’une utopie. Un monde idéal que chacun portait en soi et que nous pouvions construire ensemble. »
Elle hésita un moment, comme si elle évaluait l’opportunité d’en dire plus. Je me sentis scruté, jaugé de la tête au pied. Comme son regard plongea d’un coup dans le mien, je baissai instinctivement les yeux, intimidé. Ce devait être la réponse qu’elle attendait, car elle continua.
« Mon père évoquait souvent un royaume des Idées, un univers peuplé de nos propres représentations. Il m’a longtemps fait lire Platon, qui décrivait un monde un peu similaire. Au début, tout ça n’était pour moi que des métaphores philosophiques ennuyeuses. Mais mon père les prenait au pied de la lettre. Il me racontait des histoires de néoplatoniciens et d’une petite communauté d’adorateurs d’Hypatie. Par fidélité à leur ancienne maîtresse, ils avaient cherché, durant des siècles, des accès vers ce monde des Idées qu’Hypatie aurait entrevu, selon la légende qu’ils se répétaient d’une génération à l’autre. »
En même temps qu’elle parlait, elle fouillait machinalement les étagères qui courbaient sous le poids des livres.
« Au fil des siècles, des érudits auraient peu à peu trouvé des voies d’accès vers ce monde, continua-t-elle. Après une vie passée à méditer et à travailler sur eux-mêmes, ils ressentaient des fulgurances, des moments de transes durant lesquels ils pouvaient atteindre directement les Idées, comme si elles avaient leur existence propre. Mon père m’expliquait que le chemin était escarpé, difficile, dangereux même. Il fallait maîtriser différentes techniques décrites dans une série de manuels abrités dans l’Annexe qui jouxte la bibliothèque, et dont certains auraient presque deux mille ans. Ce chemin, mon père l’a bien sûr suivi à son tour, comme les autres Maîtres de la Citadelle. Mais il me répétait qu’il y en avait peut-être un plus facile, plus immédiat. Il me parlait d’une porte plus directe. Et il m’assurait que c’était moi qui en avais, ou plutôt qui en étais la clé. Il évoquait des histoires de Grands et de Petits Passages auxquelles je ne comprenais pas grand chose. Mais il me donnait, chaque jour, une liste d’exercices que je devais faire. Il insistait ; c’était vraiment important. Des exercices de méditation, d’hypnose, d’expression et d’interprétation émotionnelle, d’élocution, de danse et de chant. Il disait que j’avais un don qu’il me fallait développer. Je n’avais pas un goût très prononcé pour les abstractions et mon père a vite compris que je ne passerais pas ma vie à étudier, comme lui, la République de Platon ou la Physique d’Aristote. Mais il m’a appris à deviner les pensées d’autrui et à transmettre n’importe quel ressenti. A être en quelque sorte une mentaliste doublée d’une comédienne. Sauf que les émotions, les affects, que je devine ou que je transmets, sont réels. Je ne triche pas ; je ne fais qu’amplifier. L’objectif était plutôt que je développe une capacité extrême d’empathie. C’était là, disait mon père, le secret du Grand Passage : la capacité d’établir des ponts entre le ressenti de quelqu’un et celui d’un autre, de traduire les représentations de l’un dans le langage mental de l’autre. »
Je commençais à comprendre pourquoi il m’était si difficile de lui résister. Elle contrôlait mes propres émotions mieux que moi-même.
« Mais d’où tirait-il lui-même ce savoir qu’il vous enseignait ?
– Il m’expliquait que j’étais l’aboutissement de plusieurs siècles de recherche, de génération en génération, pour croiser les influences et façonner à la fois une humanité et une science nouvelles. Certains de ces « Hypatistes » se sont donné comme objectif, non pas d’accumuler des savoirs, mais de communiquer le plus fidèlement possible des images mentales. Ils ont créé un langage qui va bien au-delà des mots. Une langue à la fois corporelle et verbale, sensitive et rationnelle, sensuelle même, qui transmet plus que des idées : elle communique l’ensemble des sensations que ces idées font naître. Par exemple, si je vous dis « la peur », d’un ton neutre, c’est une simple idée, un concept qui n’éveille rien de particulier en vous si ce n’est un sentiment vague et plutôt abstrait. Maintenant, si je vous dis « … la peur »… »
Elle s’était discrètement approchée de moi, modifiant subtilement à la fois le timbre et l’intonation de sa voix. Elle avait ajouté un ensemble de notes graves et aiguës qui, d’un coup, me firent frissonner. Une angoisse sourde m’envahissait, tandis que mon ventre se nouait face à un invisible danger. Quand son regard noir s’accrocha au mien, des ombres se mirent à tourner autour de moi, menaçantes. Elles m’effleuraient pendant que des cris stridents résonnaient dans ma tête. Je me sentais de plus en plus mal. Je suffoquai. C’est alors qu’en quelques mots, elle mit fin à mon calvaire.
« … Les ombres partent… », susurra-t-elle d’une voix redevenue douce et claire.
Je me vis alors en haut d’une colline ensoleillée, ressentant sur ma peau une lumière chaude qui baignait mon visage. Un parfum de fleur et de fruit m’enveloppait. Puis je repris subitement mes esprits. J’étais toujours dans l’appartement de Camille, face à elle. Et je ne savais plus si je devais être fasciné ou effrayé par ce que je venais de vivre.
« Choisissez vous-même, me dit-elle. Mais vous n’avez rien à craindre de moi. »
J’ignore si elle me laissa vraiment le choix, mais je me sentis vite tout à fait serein.
« Mon père disait que j’étais ce qu’il appelait une Médiatrice, et qu’il y en avait très peu comme moi. Que j’étais même, pour lui, la plus douée de toutes, celle qui créerait un jour le Grand passage.
– Vers Nova Alexandrie ?
– C’est ce que j’ai moi-aussi compris, oui. Il me décrivait une expérience à laquelle il participait, à base d’intelligence et de vie artificielles. Elle était manifestement sur le point d’aboutir. Il me répétait qu’ils y étaient presque. Mais qu’il fallait n’en parler à personne. Ni de cette expérience, ni de Nova Alexandrie. A qui que ce soit. D’ailleurs il n’a jamais voulu que je vienne le voir à la Citadelle. Il disait que c’était mieux comme ça. J’ai bien senti que ce n’était pas un jeu, qu’il y avait un réel danger, pour moi comme pour lui. Je ne sais même pas si les Maîtres de la Citadelle connaissaient mon existence. Vu leurs réactions quand je me suis présentée, je pense qu’il ne leur avait jamais parlé de moi. Beaucoup étaient très étonnés. Isaac avait même l’air paniqué.
– Mais pourquoi me raconter tout cela, alors ?
– Je prends un grand risque, c’est vrai. A la fois pour moi et pour mon père, qui doit se cacher quelque part, pour des raisons que j’ignore encore. Tout dans cette pièce suggère qu’il est parti en vitesse, qu’il fuyait quelque chose ; cette pièce transpire l’angoisse. Mais les dernières fois où nous nous sommes vus, il avait commencé à me parler de vous. Il vous décrivait comme quelqu’un de grande valeur. Il vous estime manifestement beaucoup, j’ai senti une grande confiance. Et à présent que je vous vois, que j’accède à vos émotions et à vos sentiments, je comprends pourquoi. Mon père se trompe rarement sur les gens, cela fait partie du don qu’il m’a transmis. Je devine que vous êtes quelqu’un qui ne trahit pas. Pas parce que vous auriez une morale plus solide que les autres. Non, plutôt parce que vous avez besoin qu’on vous aime. C’est d’ailleurs là une de vos faiblesses. »
Je ne me donnai pas la peine de protester. Elle poursuivit :
« Vous aussi, vous vous sentez en danger. Je le perçois dans vos gestes, dans votre voix. Vous sentez, comme moi, les tensions qui règnent ici. Vous vous doutez que la mort de Cornélia n’est pas qu’un regrettable accident cardiaque. Et vous vous inquiétez sincèrement pour mon père, envers qui vous éprouvez de toute évidence une grande loyauté. Je lis tout ça en vous. Nous n’avons donc pas d’autre choix que de nous allier, vous et moi, pour identifier qui nous menace. Et comprendre surtout pourquoi. »
Elle avait bien sûr raison. Après Cornélia, puis Camille, je sentais confusément qu’un jour viendrait où cette menace s’abattrait peut-être sur moi. Je lui livrai donc tout ce que je savais sur la Citadelle, sur Hypatie et sur l’idéal de fusion entre tous les savoirs qu’elle avait pu représenter en son temps. Cette jeune femme en savait de toute façon bien plus que moi. Je lui parlai, aussi, de la douleur que me causait la disparition de Camille. Négligeable, j’en convenais, face à l’inquiétude qu’elle-même éprouvait. Mais n’avais-je pas aussi perdu, de mon côté, un père spirituel ?
III.6 – Complicité
Cette douleur commune nous rapprocha. Nous eûmes de longues discussions durant les quelques jours qu’elle passa à la Citadelle. Je voyais bien qu’Iris en prenait ombrage, souffrant de ne plus pouvoir partager, à tout instant, les réflexions qu’il menait alors sur la théorie des variables cachées. Einstein l’avait formulée pour expliquer les paradoxes de la mécanique quantique : si les mesures que l’on pouvait faire sur un objet microscopique n’étaient prévisibles qu’en terme de probabilités et non de certitudes, ce n’était pas, selon Einstein, parce que l’état de l’objet était intrinsèquement indéterminé, mais parce que nous ignorions quelle valeur avait différents paramètres liés à lui. Il y avait, en d’autres termes, des variables cachées dont la connaissance pouvait transformer les probabilités en certitudes. « Dieu ne joue pas aux dés » avait insisté Einstein. Or, Iris prétendait avoir démontré de façon élégante que le génie de la Relativité se trompait, ce que d’autres avaient déjà établi, mais d’une façon qui ne lui convenait guère. Ses progrès le plongeaient dans une exaltation extrême, qu’il était frustré de ne pouvoir me communiquer. Puisse-t-il me pardonner cette entorse que je fis à notre amitié. Mais j’avoue que je n’avais plus vraiment le coeur à débattre d’épistémologie. La fille de Camille exerçait sur moi une attraction bien plus puissante que Bohr, Heisenberg et les autres héros de la valeureuse Ecole de Copenhague.
Mon Maître avait donné à son enfant un prénom original : Perce-neige. « Parce que tu es née au sortir de l’hiver, comme une promesse d’amour dans un monde encore froid », lui avait-il dit un jour en riant. Mais à la voir, on se doutait que la métaphore était bien plus puissante. Perce-neige avait développé une telle capacité d’empathie qu’elle pouvait rompre, de fait, n’importe quelle glace entre les gens. Elle exprimait continuellement un flot chaud et intense d’émotions, qui rendait illusoire tout mur qu’on aurait pu vouloir ériger entre elle et soi. Elle brisait d’un sourire vos moindres résistances et pénétrait à sa guise dans l’intimité de vos sentiments. En sa compagnie, on pouvait se sentir envahi d’une joie immense ou d’une profonde mélancolie. Comme si une connexion émotionnelle directe s’établissait entre elle et toutes les personnes qui l’entouraient. Je savais que cela passait par sa voix, par ses regards, par sa façon d’occuper l’espace, par les mots qu’elle disait, ou ne disait pas, par ses soupirs placés au bon moment, par sa main qui se posait négligemment sur votre épaule tandis qu’elle vous chuchotait dans l’oreille, et par une multitude d’autres procédés dont je n’avais sans doute même pas conscience.
Elle était un amplificateur d’affects. Un résonateur d’états mentaux. Il était impossible, en sa présence, de ressentir quoi que ce fût qu’on pût lui cacher. Et nul ne pouvait l’empêcher, en retour, de communiquer ce qu’elle-même vivait. Ou peut-être ce qu’elle voulait nous faire vivre. Quoique jamais je ne la surprisse à abuser sciemment de ce pouvoir absolu qu’elle avait sur nous.
Un soir, elle entra dans ma chambre dans un état de grande excitation. Elle tenait dans ses mains un vieux cahier épais, relié de cuir. Camille le cachait dans une cavité creusée dans l’un des murs de son appartement. Quelques mois auparavant, il avait livré à sa fille une série d’indices pour le dénicher, au cas où justement il lui arriverait malheur.
C’était une série de notes, écrites jour après jour. Manifestement depuis des années. A la fois un journal intime et un cahier de laboratoire. Il y était question d’Hypatie, bien sûr. Mais aussi de cette communauté d’admirateurs qui, après sa mort tragique, avait décidé d’entretenir sa flamme. Leur ambition semblait à la fois simple et titanesque : recréer ex nihilo ce paradis intellectuel perdu qu’avait représenté la libre pensée d’Alexandrie. Une utopie, qu’ils nommèrent entre eux Nova Alexandrie.
Mais comment recréer un monde détruit ? Il n’était pas dans leurs moyens de reconstruire une cité. Mais ils avaient la puissance de leur esprit et de leur imagination. Les Hypatistes – au départ une poignée – se sont d’abord réunis pour évoquer ensemble l’utopie à laquelle ils voulaient donner vie. Les discussions se sont faites régulières, chacun racontant au coin du feu l’histoire d’un monde idéal dédié à tous les savoirs. Les années passant, les récits se sont accordés. Un imaginaire commun s’est peu à peu consolidé, fait de personnages récurrents, de lieux, de destins et de mythes dont la réalité n’était plus disputée par personne. Une cosmogonie partagée. Un big bang de l’esprit. Car ces érudits ont bientôt parlé de cet univers mythologique comme d’un monde réel, transcendant, dans lequel des savoirs et des expériences réelles s’échangeaient, et dont ils partageaient les visions. Elles étaient soigneusement recopiées sur des papyrus puis, à partir du VIIe siècle, sur des parchemins. D’année en année, siècle après siècle, le petit groupe d’idéalistes s’est étoffé, continuant sans relâche ce travail collectif d’imagination constructrice. Mille ans plus tard, l’univers modelé collectivement par la seule force de l’esprit, avait pris des proportions gigantesques. Chaque détail de sa géographie était méticuleusement répertorié. Jusqu’à ce que sa réalité, admise par chacun sur la foi de tous les documents produits, ne fasse plus aucun doute. Ce monde qui avait son histoire, ses héros, sa mythologie et sa géographie décrite dans une multitude d’atlas, était devenu aussi réel, dans l’esprit des Hypatistes, que les montagnes et les plaines qu’ils traversaient à dos d’âne ou de chameaux pour se réunir et en discourir discrètement.
Un lien fort unissait cette communauté : l’amour sincère du savoir. De tous les savoirs. Et la volonté farouche de les mêler sans cesse pour en faire émerger de nouveaux. Camille avait retrouvé la trace d’anciens Hypatistes au Mexique, parmi des peuples mayas et aztèques, ou en Thaïlande dans les temples khmers. En Europe, dans l’entourage de Léonard de Vinci et de Nostradamus. Galilée lui-même, selon une note écrite dans une marge du cahier, aurait peut-être appris de ces lointains érudits. Partout où une vie intellectuelle avait pu renaître des décombres qui ont suivi la chute de l’Empire romain, dans les abbayes et les premières universités de Montpellier, de Heidelberg ou de Paris, on retrouvait des traces de Nova Alexandrie, comme autant de tentatives inabouties de mettre en pierres cette utopie. Camille s’était épuisé à tracer des liens entre savants et artistes, mathématiciens et écrivains, retrouvant des influences qui n’ont pu naître que dans une féconde promiscuité. Comme ces quelques commentaires, en bas d’une page, sur l’influence qu’a pu avoir la Relativité d’Einstein sur le cubisme et le génie de Picasso. Fallait-il y voir, là encore, la marque invisible de quelque membre de Nova Alexandrie ? Nous étions, Perce-neige et moi, comme deux enfants découvrant un gigantesque jeu de piste.
Par précaution, nous quittâmes la Citadelle dès le lendemain matin, prétextant quelques formalités dont Perce-neige devait s’acquitter en ville. Il n’était guère prudent, en effet, de poursuivre en ce lieu une lecture si sulfureuse. Après avoir marché toute la journée, puis parcouru une vingtaine de kilomètres en auto-stop, nous nous arrêtâmes dans le premier hôtel que nous croisâmes sur notre route, tous-deux impatients de nous replonger dans l’épais journal de Camille.
A mesure que nous tournions les pages, ce monde se révélait. Il commençait à nous obséder. Nous en discutions chaque détail, confrontant nos visions respectives. Nous en rêvions la nuit. Et quand nous en parlions le jour, Nova Alexandrie nous semblait chaque fois plus réelle. Comme une cité dont nous allions finir par trouver le chemin.
D’autres l’avaient trouvé avant nous. Car les notes de Camille évoquaient à plusieurs reprises différents passages spirituels. Comme des couloirs chamaniques. Je n’étais pas certain de comprendre vraiment de quoi il s’agissait, mais il était question, dans des lieux et des moments particulièrement chargés de sens, dans des monuments emblématiques du savoir, de transes hallucinatoires où des témoins racontaient s’être subitement retrouvés dans un autre monde, dans un rêve éveillé où ils ont entrevu les murs de cette cité qu’ils avaient imaginée avec tant de force. Pendant des siècles, les Hypatistes ont scrupuleusement noté à quelles occasions ces transes survenaient, comment ils pouvaient les rendre plus fréquentes et plus durables. Camille avait tout rassemblé.
Il fallait, écrivait-il, réunir plusieurs conditions. La première était d’être soi-même parfaitement à l’aise avec l’abstraction et les idées. Les hallucinations – mais en étaient-ce vraiment ? – n’apparaissaient qu’aux plus grands érudits, à ceux qui avaient passé des décennies dans les livres, naviguant sans cesse d’une idée à l’autre. Il fallait aussi avoir une connaissance intime de Nova Alexandrie, en avoir étudié chaque recoin dans les parchemins. Il fallait surtout croire en son existence avec autant de force que l’on pouvait croire en Dieu, sentir dans sa chair sa présence, sa respiration, le poids de ses murs. Et attendre enfin le moment où, dans un état de concentration extrême sur une question abstraite, l’esprit basculait. Les récits, ensuite, concordaient. Après une longue traversée de leur propre psyché, après avoir vaincu leurs peurs et toutes les résistance que l’esprit interposait pour nier une réalité qu’il ne pouvait accepter, tous avaient fini par percevoir un phare éblouissant, une lumière qui imposait sa vérité sur une mer rebelle. Ils s’étaient vus accoster une cité qu’ils avaient d’abord peine à décrire. Puis l’image se précisait, avec une même agora au centre, une Grande Bibliothèque à l’image de celle qui avait été érigée dans l’antique Alexandrie, et un troisième quartier constitué de bâtiments baroques en perpétuelle transformation, où chacun semblait apporter ses propres visions d’avenir. L’expérience était décrite comme celle d’un rêve éveillé. A la différence que chacun semblait tour à tour prendre part au même songe. Et de passage en passage, de transe en transe, les descriptions s’étaient encore affinées, jusqu’à remplir des livres entiers, soigneusement rangés dans l’Annexe, qui contenait l’ensemble du savoir accumulé collectivement sur cet univers onirique.
Comment ce monde, au départ imaginaire, avait pu devenir si réel ? Camille en parlait comme d’un grand mystère à résoudre. Mais surtout, était-il possible d’y accéder autrement que par des décennies de travail intense sur soi ? Pouvait-on provoquer artificiellement ces transes ? Tout le monde avait-il la capacité de basculer et d’entrer dans cette Nova Alexandrie ? Je compris que c’était vers là que convergeaient les recherches de mon Maître. Et il était clair dans ses notes que Perce-neige, par ses dons singuliers, en était la clé de voûte. A la fin de son cahier, il était question du projet Alice et de synergies à créer entre la force démiurgique du cerveau, capable de vivre en pensée dans des mondes qu’il a lui-même créés, et la puissance informatique qui peut l’épauler dans cette tâche en manipulant des masses considérables d’informations. Un triangle revenait sans cesse, d’une page à l’autre, dont les trois sommets étaient toujours les mêmes : les Erudits, Perce-neige, Alice. Trois pôles entre lesquels il fallait construire des connexions. Mais les pages suivantes étaient désespérément blanches. Camille n’avait pas achevé son grand oeuvre.
Je rentrai à la Citadelle, bouleversé, après avoir promis à Perce-neige de l’aider du mieux que je pourrais à retrouver son père.
III.7 – choeur à coeur
Cela faisait désormais plusieurs mois que Camille avait disparu et que nous étions sans nouvelle de lui. L’ambiance à l’Académie s’était dégradée. D’autres Maîtres n’y étaient plus, parmi ceux dont j’appréciais le plus l’ouverture d’esprit. Il manquait Diogène, le philosophe. Nous l’avions surnommé ainsi parce qu’il nous provoquait sans cesse et se faisait fort de vivre dans le dénuement le plus complet. « J’ai toujours vécu dans la misère, une main devant une main derrière », ironisait-il souvent, mimant la scène avant de rajouter, l’oeil complice : « mais je vous salue en levant bien haut le bras ! ». Ses grivoiseries nous faisaient rire, car nous étions bon public. Surtout Rablais, qui voyait en lui un partenaire de gaudriole à sa hauteur. Forest appréciait davantage les fulgurances de sa pensée qui, au-delà des plaisanteries un peu grasses, était pour qui voulait la suivre d’une très haute volée.
Comme son antique mentor, notre philosophe s’était construit, à l’écart de la Citadelle, un grand tonneau de bois dans lequel il vivait le plus souvent à moitié nu. Ses propos étaient obscurs, mais il y avait dans son engagement une sincérité qui nous touchait. Ayant estimé que toute possession était une aliénation, il avait à coeur de partager tout ce qu’il pouvait trouver. Comme Camille il disparut, une nuit, sans prévenir quiconque, emportant avec lui ses maigres affaires.
Il manquait aussi Emeline, l’experte en mythologie comparée, qui s’ingéniait à établir des ponts entre les récits archétypiques de toute la planète. Cette érudite avait entrepris d’en faire une sorte de mathématique du récit à laquelle je n’ai jamais rien compris. Je désespère encore qu’elle puisse un jour me l’expliquer. Elle s’était à son tour volatilisée, la nuit-même où Diogène nous avait quittés, laissant un bref mot d’adieu à Maurice. J’en ressentais une grande tristesse car elle faisait preuve, à l’égard des pensionnaires et en particulier des nouveaux, d’une capacité d’écoute peu commune. Nous aimions lui confier nos petits soucis, nos difficultés à supporter, au début, l’austérité volontaire de ces murs ou l’éloignement de nos familles. Elle réglait avec tact les petites disputes qui éclataient parfois entre nous. Car nous n’étions pas des saints : une réflexion mal comprise, un service non rendu, l’envie ou la jalousie, dégénéraient parfois en querelles qu’il fallait aussitôt apaiser. Emeline s’y employait en mère attentive. Camille, Diogène, Emeline… Pourquoi étaient-ils partis ? Et pourquoi fallait-il que ce fussent ceux dont je me sentais le plus proche ?
Les débats à l’Académie y étaient toujours aussi vifs et construits. Iris, en particulier, nous entraînait avec la complicité de Forest dans des gouffres épistémologiques vertigineux. Mais il manquait à cette assemblée l’innocence joyeuse qui en faisait auparavant le charme. Il flottait une tension continue, comme dans un ciel d’été avant l’orage. Les Maîtres se faisaient moins disponibles et passaient davantage de temps entre eux, dans l’Annexe. Sans doute avions-nous tous besoin, eux comme nous, d’oublier le décès tragique de Cornélia. Aussi beaucoup firent une pause et retournèrent chez eux ou dans leurs familles. Moi-même, je ne revenais à la Citadelle que pour de courts séjours, préférant m’enivrer dans l’animation plus bruyante des villes.
J’errais le soir dans les ruelles de Montpellier, finissant par m’asseoir sous les allées de l’esplanade qui prolongeait la place de la Comédie. Mon Maître me manquait. Je me sentais orphelin. Je restais néanmoins en contact régulier avec Perce-neige, qui avait son propre appartement près du centre. Et nous continuions, tous deux, à analyser chaque phrase du journal de Camille. Après tant de mois d’absence, sans nouvelle d’aucune sorte, l’hypothèse de son décès avait fini par s’imposer. Perce-neige était restée la seule à croire encore son père en vie. Sa conviction reposait sur un discret oeillet blanc laissé parfois non loin de sa porte. Lui seul savait que les oeillets étaient ses fleurs préférées. Et qu’elle aimait par dessus tout les blancs. Elle connaissait trop son père pour ne pas y voir un message évident. Elle espérait donc chaque jour qu’il sonnât. Et finissait chaque soir plus déçue. Après des mois d’attente infructueuse, elle apprivoisa lentement l’idée qu’elle ne le reverrait peut-être plus.
Comme elle déprimait, je l’entraînai un samedi soir dans un bar-karaoké de mon quartier. Je m’étais dit qu’avec son timbre de voix si riche, elle ne pourrait qu’y faire merveille. Nous nous assîmes au fond d’une salle remplie d’étudiants, pour siroter quelques cocktails de fruits. Elle se laissa aller ce soir-là à consommer un peu d’alcool. Rhum, vodka… au fil de la soirée nos verres contenaient, je dois l’avouer, de moins en moins de fruits. Et comme Perce-neige n’avait guère l’habitude de boire, son ton devint vite plus enjoué. Au bout d’une heure, elle était tout à fait saoule. Elle riait aux éclats à mes mauvaises blagues, preuve qu’elle n’avait plus totalement ses esprits.
L’animateur du soir nous invita à choisir une chanson. Parcourant la liste des tubes disponibles, Perce-neige choisit Mistral Gagnant, une vieille chanson de Renaud, écrite à la fin du XXe siècle, dont nous aimions tous les deux la mélodie. Le texte de circonstance, confidence d’un père à sa fille encore enfant, était d’une singulière poésie. Trop, sans doute… Comme elle me demanda de l’accompagner, je déclinai lâchement, la laissant monter seule sur la scène. Elle titubait encore un peu, pouffant de rire. Elle réajusta maladroitement son chemisier, le regard facétieux. À défaut d’être juste, sa prestation promettait d’être drôle.
Sous les lumières tamisées, les premières notes de piano firent perdre à Perce-neige toute envie de rire. Je vis au contraire son visage s’imprégner d’une subite gravité, comme répondant à un appel qu’elle seule entendait. Elle se figea et commença à chanter, mue par une force obscure. Dans la salle, le brouhaha des conversations s’estompa. Sa voix hésitait encore, comme retenue par une ultime pudeur dont elle avait encore un peu de mal à se défaire. Mais les encouragements chaleureux du public, mêlés aux vapeurs d’alcool qui embrumaient encore son esprit, la convainquirent bientôt de lâcher prise. Le timbre de sa voix changea brutalement, s’enrichissant d’une multitude d’harmoniques qui la rendit presque méconnaissable, à la limite d’une voix humaine.
Ce qui se passa alors échappe au pouvoir descriptif des mots. Les conversations s’arrêtèrent toutes. Un silence de plomb tomba dans la salle où chacun s’immobilisa, statufié dans une écoute quasi-religieuse. Il n’y avait plus de voix, plus de texte, plus de mélodie. Nous étions juste réunis l’un à l’autre par un fil invisible.
Une petite fille aux cheveux blonds jouait devant moi. D’où venait-elle ? Que faisait-elle là, au milieu d’un chemin de terre bordé de bancs ? Elle jetait un à un des cailloux aux oiseaux, sautait à pieds joints dans des flaques, ses chaussures se remplissant de boue. Elle rigolait tandis que je frissonnais. Et je devinais que tous, dans la salle, voyaient la même scène. Certains tendaient le bras pour donner la main à la fillette qui courait à présent, d’une table à l’autre, pour attraper des poignées de bonbons. J’en voyais qui souriaient, d’autres qui pleuraient. Beaucoup se tinrent instinctivement la main. Nous n’étions plus qu’une chaîne humaine projetée dans un imaginaire partagé.
Puis la petite fille s’enfuit, tandis que s’égrainaient les dernières notes du piano. Nous nous réveillâmes l’un après l’autre, surpris de nous retrouver à nouveau dans une salle de bar. Cherchant des yeux cette petite fille blonde qui avait disparu et dont nous entendions encore les derniers éclats de rire. Ne sachant si nous avions tous rêvé, ou simplement trop bu, mais essayant de prolonger le charme quelques secondes de plus.
Perce-neige bredouilla quelques mots de remerciement et s’éclipsa.
« Je n’aurais pas dû, je suis désolée, s’excusa-t-elle en regagnant notre table.
– Il s’est passé quoi ? C’était de l’hypnose ou quoi ? »
J’étais stupéfait. Comme toute la salle, d’ailleurs, qui la fixait désormais dans un mélange incrédule de crainte et de fascination.
« J’ai fait une erreur. Une faute. Je n’aurais pas dû boire autant. Partons vite… »
Je réglai rapidement nos consommations et nous sortîmes, sous une pluie fine qui me ramenait au réel.
« Mais comment tu as fait apparaître cette fille ? Je n’ai pas rêvé : on a tous vu la même. Elle était là, devant nous ! Comment tu as fait ? Comment est-ce possible ? »
J’insistais, tandis que nous marchions pour rentrer chez moi.
« Je t’avais dit que j’étais une Médiatrice. C’est à la fois un don et beaucoup de travail. Et ça peut en effet s’apparenter à de l’hypnose, en beaucoup plus riche car cela agit sur l’ensemble des structures cérébrales. Mais ce n’était pas très malin de ma part d’utiliser la Langue, comme nous l’appelons entre nous, pour une attraction de bar. Je me suis laissée emporter. Je n’aurais pas dû boire, répétait-elle. C’est la première fois que… Enfin, j’espère que tous ces gens oublieront ce qu’ils ont vécu.
– Pourquoi ? J’ai trouvé ça génial, au contraire.
– Génial ? Que crois-tu qu’il arriverait si ces gens réalisaient vraiment que je peux leur faire voir et ressentir absolument ce que je veux, les projeter à volonté dans un monde totalement imaginaire, qui leur paraîtra si vrai qu’ils n’auront aucun moyen de savoir que rien n’est matériel ? Que l’illusion sera plus puissante que ce que peut produire n’importe quelle drogue existant sur le marché ? Et que je ne suis pas la seule à savoir faire ça?
– Tu veux dire… que d’autres sont capables de faire ça ? Vous êtes nombreux ?
– Mon père m’a toujours dit que nous étions une petite poignée dans le monde. Je ne connais pas vraiment les autres. Il m’est arrivée d’en croiser il y a quelques années. Surtout quand j’étais petite et que je démarrais mon apprentissage.
– Mais comment on peut apprendre à faire un truc pareil ?
– Tout le monde n’en est pas capable. Il faut avoir un don. Les Hypatistes ont passé des siècles à repérer ceux qui l’avaient. A apprendre auprès d’eux et à les croiser entre eux, pour accroître lentement ce pouvoir d’une génération à l’autre. Ma mère l’avait. Mon père aussi, à sa façon. Et j’ai compris qu’il espérait qu’à mon tour je me mettrais un jour en couple avec un homme qui l’aurait, pour perpétuer et amplifier la chaîne. Mais avoir le don ne suffit pas. Il faut le travailler. Et là encore, il a fallu des siècles pour concevoir des exercices mentaux spécifiques que j’essaie de perfectionner à mon tour.
– Quels types d’exercices ?
– Cela passe beaucoup par la voix, le chant, la musique. Comme ce soir. Nous appelons ça le psycho-chant. La musique est faite pour transmettre des émotions, donc c’est assez naturel de s’appuyer sur elle. Mais on peut aller bien au-delà de l’expérience que tout le monde ressent habituellement. Par des intonations particulières de la voix, une gestuelle, voire certains parfums. Les mots que l’on dit, ou que l’on ne dit pas, les soupirs que l’on place… Et d’autres choses qui, même à nous, restent incompréhensibles. Est-ce que c’est une sorte de télépathie embryonnaire ? Peut-être. Il faudra des milliers d’années pour comprendre pleinement ces phénomènes. Mon père m’expliquait que l’espèce humaine était depuis toujours un animal social, qui avait développé d’énormes capacités de communication. Un humain sait reconnaître, à un froncement de sourcil ou à l’esquisse d’un sourire, l’état mental, voire l’intention de la personne à qui il parle. Nous sommes sans doute le seul animal sur Terre capable d’une telle prouesse. Mais comme nous vivons dans des sociétés de plus en plus complexes, il est normal que l’évolution aille encore plus loin et favorise ceux qui ont des capacités supérieures à deviner les états mentaux des autres, voire à les créer. Qu’un tel don apparaisse n’a finalement rien de réellement surprenant : contrôler ce que ressentent les autres, naviguer à volonté dans l’univers de leurs représentations mentales, donne un avantage décisif en terme de survie au sein du groupe. Tout cela me semble assez logique.
Perce-neige me fit promettre de rester discret sur l’existence de ces Médiateurs. Et ce n’est qu’après de longues réflexions que je prends aujourd’hui le risque de révéler leur présence. Ce faisant, je trahis en partie le serment que j’ai fait, j’en suis pleinement conscient. Mais que vaut à présent ce secret, alors que c’est de l’existence même de Nova Alexandrie qu’il s’agit désormais ? Rester fidèle à Perce-neige, c’est d’abord sauver son idéal. Ce pour quoi elle s’est battue, ce pour quoi elle a tout sacrifié. Et pour cela, je ne dois rien cacher, quoi qu’il en coûte. Il me faut tout raconter. Comment vous convaincre, sinon, de venir nous rejoindre dans ce combat qui vient de commencer ?
Pour que je pusse en savoir plus sur son don, elle m’invita à assister à l’une des séances hebdomadaires qu’elle suivait auprès d’une professeure de psycho-chant, dont je préserverais cependant l’anonymat en ne livrant que son prénom : Judith.
Sa maison était ceinturée d’un jardin dont l’allure sauvage se dissipait aussitôt qu’on s’y aventurait. Le mur d’entrée était couvert de glycine, lilas et rosiers grimpants. Alors que je poussai le portail de bois blanc, je m’y sentis tout à fait bien. Je m’enfonçais dans une oasis de nature plantée au milieu d’un désert de bitume. Je mesurais les années de travail qu’il avait fallu fournir pour sélectionner judicieusement les plantes, entretenir les arbres, dessiner la courbe harmonieuse du chemin de pierres qui traversait ce jardin aux influences tant anglaises que japonaises. Un pont de bois enjambait un bassin où frayaient quelques poissons dont je n’aurais su qualifier l’espèce. Le mur de la maison était couvert de jasmin odorant et de chèvrefeuille.
Je toquai à la porte. N’obtenant pas de réponse, je frappai à nouveau. Des notes de piano s’échappaient de l’arrière de la maison. Je fis le tour, découvrant une véranda qui s’avançait au milieu des arbres. Perce-neige était assise devant un piano, aux côté d’une femme d’une soixantaine d’années environ, élégamment vêtue.
Caché derrière un chêne, j’écoutais mon amie se lancer dans les premières notes d’un requiem. Le rythme était lent, régulier. Le motif était simple mais il avait quelque chose d’obsédant. La dame à côté d’elle se mit à chanter, avec une intensité stupéfiante. Il m’était arrivé d’aller à l’opéra, d’écouter le Requiem de Mozart ou d’autres morceaux choisis du répertoire classique ou baroque, mais cela n’avait jamais eu la puissance évocatrice de ce que j’ai pu entendre ce jour-là. Ce n’était plus du Bach, du Mozart ou du Haendel, c’était bien au-delà. Comme si l’on avait ajouté, par-dessus la partition, une seconde couche de génie. Je n’entendais plus de la musique, je vivais des émotions brutes qui envahissaient directement mon corps. Je n’eus d’ailleurs bientôt plus conscience d’entendre véritablement des notes. C’est alors que Perce-neige se mit à chanter à son tour. Il était heureux que mon esprit fût préparé à l’expérience dans laquelle il bascula. Car j’eus soudain des hallucinations visuelles, auditives, olfactives… bien plus puissantes encore que celles que j’avais pu vivre quelques jours auparavant dans la salle de karaoké de mon quartier. Le réel s’était littéralement désintégré.
Je vis des anges emporter devant moi un mort, tandis qu’une vierge pleurait. Je pouvais sentir jusqu’à la brise créée par le battement de leurs ailes. Mes yeux se remplirent à leur tour de larmes. J’étais sur le point de perdre connaissance quand la musique s’arrêta. Mon pied écrasa une branche ; les deux femmes remarquèrent ma présence. Perce-neige me fit alors signe d’entrer.
« Je te présente Judith », me dit-elle simplement.
Encore sous le choc, je titubais et j’eus beaucoup de mal à serrer la main que sa professeure de chant me tendait. Elle ne s’en formalisa pas, devinant mon émoi.
« Vous êtes Samuel, je présume ? Vous êtes encore tout secoué, sourit-elle. J’y vois la preuve que Perce-neige fait d’énormes progrès. Mais elle pourrait aller encore plus loin en poussant davantage sa voix. »
Je n’osais imaginer l’effet qu’elle provoquerait alors.
Judith n’était pas ce qu’on pourrait appeler une belle femme. Elle n’avait pas vraiment de formes et son visage était trop émacié. Mais dès qu’elle parlait, elle rayonnait ; sa voix charmeuse vous hypnotisait. Si bien qu’on oubliait assez vite son nez trop long et l’alignement indiscipliné de ses dents. Eût-elle été clouée sur un fauteuil roulant, elle aurait pu encore vous prouver qu’elle avait la grâce d’une danseuse étoile. Par sa seule façon de placer sa voix, elle savait vous amener à ressentir à peu près ce qu’elle voulait. Elle aurait pu, comme on dit, vendre du sable à un bédouin, de la glace à un eskimo, voire convaincre notre vieil Isaac de participer à une émission de télé-réalité. Je compris d’autant mieux la nécessité de ne pas mettre un tel don à disposition de n’importe qui.
« Vous avez beaucoup d’élèves ? lui demandai-je.
– En cours de chant, oui en effet. Mais je réserve le psycho-chant à Perce-neige. J’ai eu deux-trois élèves avant elle. Mais elle est de très loin la plus douée. J’ai connu des Médiateurs capables de vous faire basculer quelques secondes, voire quelques minutes après des années de travail. Mais jamais plus. Perce-neige nous ouvre de nouvelles portes. C’est absolument excitant. Pour moi, c’est un peu comme si j’entraînais le futur champion olympique, celle qui laissera ses concurrents sur-place pour plusieurs générations. Bien sûr, il ne s’agit nullement de compétition. Le psycho-chant s’appuie sur une réelle empathie qui ne peut être feinte. Mais nous avons tous un peu tendance à nous comparer les uns les autres.
– N’êtes-vous pas, du coup, un peu jalouse ? »
Je fus surpris de mon audace, mais elle ne se vexa pas d’une question si directe.
« Enormément, rit-elle au contraire. Que n’aurais-je donné pour avoir moi-même un tel don ! J’ai dû travailler près de trente ans pour atteindre le niveau qu’elle avait presque naturellement à dix ans, quand je l’ai connue. Je lui donne un peu de technique supplémentaire, des « trucs d’artiste », mais l’élève avait dès le départ dépassé le maître. Il y a entre elle et moi la même différence qu’entre le talent et le génie. Elle est la Mozart du psycho-chant, pour au moins plusieurs siècles ! »
Comme Perce-neige commençait à se sentir mal-à-l’aise, Judith ménagea sa modestie en soulignant tout de même quelques défauts qu’il restait à corriger dans sa façon de placer les silences ou les soupirs, et lui suggéra de travailler encore un peu les trémolos pour qu’ils soient plus efficaces. Mon amie joua machinalement au piano quelques notes enjouées qui détendirent l’atmosphère.
Judith nous servit une infusion dont je ne saurais dire la composition. Elle exhalait un ensemble de saveurs fruitées. La maîtresse des lieux me fit comprendre qu’il fallait la boire sans sucre, pour ne pas gâcher les arômes. Perce-neige s’installa devant une harpe et commença un nouveau morceau. Des gouttes de pluie se mirent à tomber sur moi. Je sentis l’eau couler lentement de mes cheveux humides pour ruisseler dans mon cou. Quand j’entendis sa voix, je compris que j’étais sur un cheval. Je traversais une forêt dont les branches me fouettaient le visage. Ou plutôt… c’était impossible mais mes yeux étaient formels : je chevauchais une… licorne. Tandis que je me retournai, je vis des lutins lancés à ma poursuite. Ils n’avaient rien de méchants, et je saisis que tout cela n’était qu’un jeu. Un épervier nous rattrapa et se posa sur mon épaule. Je me sentais invincible. Je portais une armure de cuir ; toute la forêt m’accueillait comme si j’en étais le roi. Un dragon tournoyait dans le ciel, crachant des flammes. Je n’avais pas peur. Je saisis un arc et des flèches. Je tirai. Le dragon tomba lourdement au sol. Les lutins exultaient et je partageai leur joie. Judith, qui chevauchait à côté de moi, acquiesça d’un air complice. La forêt m’acceptait comme un sauveur. Je savourais cet instant, avant de me réveiller brutalement sur ma chaise.
J’eus un court moment de confusion, ne sachant plus trop où j’étais, ni si cette chaise était réelle ou si elle faisait partie d’un nouveau rêve.
« Comprenez-vous à présent à quel point Perce-neige est douée ? » me susurra Judith en ramassant les morceaux éparpillés de la tasse que j’avais laissée tomber.
Je bredouillai quelques mots d’excuse et me levai, encore étourdi, pour faire quelques pas dans le jardin.
III.8 – Message
Quelques jours plus tard, Perce-neige tambourinait à la porte de mon appartement. Il était huit heures du matin, j’étais encore au lit, l’esprit encombré des rêves épais de la nuit. Je mis un peu d’ordre dans ma tignasse, m’éclaircis le visage sous un filet d’eau froide et traînai la jambe jusqu’à l’entrée de mon studio. J’ouvris la porte, un peu gêné de montrer mon pyjama hors d’âge. Perce-neige m’exhiba violemment un message qu’elle venait de recevoir. Il ne contenait que quelques mots :
« Bonjour. J’ai des nouvelles de votre père. Retrouvez-moi au département d’informatique de l’Université des sciences de Montpellier. Demandez Miguel. »
Les tripes nouées par la décharge d’adrénaline, je fus d’un coup complètement réveillé. Je m’habillai à la hâte, enfilant ce qui me tombait sous la main. Perce-neige était dans un état d’excitation quasi-hystérique. Pour une fois, ce fut moi qui fis de mon mieux pour la calmer. J’attrapai une pomme que je mangerais en route, et nous prîmes le premier tramway vers l’université. Comme il était bondé, nous étions collés l’un à l’autre, n’osant parler à voix haute. Sa peau était électrique. Nous descendîmes devant l’université des sciences, nous mêlant au flot un peu nonchalant des étudiants. L’entrée était surmontée d’une sculpture informe – composée d’un rond et d’un boudin horizontal – dont la rumeur affirmait qu’elle représentait un symbole asiatique. Les plus lettrés y voyaient le parrainage de Confucius. Entre nous, nous appelions plus irrévérencieusement ce monument « la saucisse », le « donut », ou le « donut-saucisse » pour les plus rigoureux d’entre nous. Ce n’était toutefois guère le moment de faire à Perce-neige une visite guidée du patrimoine universitaire. Nous marchâmes d’un pas vif vers le département d’informatique.
« Miguel ? nous répondit un thésard incrédule à l’entrée. Non, je ne connais personne de ce nom-là… »
Nous parcourûmes l’ensemble des couloirs, cherchant ce prénom sur toutes les portes. Sans succès. Le directeur nous fit comprendre, le regard amusé, que Miguel n’était qu’un surnom, mais il confirma qu’un chercheur invité par l’une de ses équipes se faisait bien appeler ainsi. Toutefois, il ne pouvait nous dire où se trouvait son bureau, ni même s’il en avait un. Sa secrétaire nous fut d’un plus grand secours, et nous mena au trot vers la petite salle où il avait selon elle ses habitudes. Un chercheur d’une quarantaine d’année, au physique sud-américain, y tapait nerveusement des lignes de code sur un ordinateur portable.
« Hola, oui c’est bien moi Miguel, nous répondit-il avec un fort accent espagnol. J’espère que vous n’avez pas eu trop de mal à me trouver, je fais de mon mieux pour ne pas attirer l’attention. Non pas que j’aime immodérément le secret, mais votre père m’avait recommandé de rester, comment dire… discret. »
Il fixa Perce-neige un long moment, à la fois fasciné et intimidé, puis jeta un regard interrogateur sur moi. Elle le rassura :
« Samuel est un ami de mon père, vous pouvez avoir entièrement confiance. »
Cela sembla lui suffire, car il nous invita d’un geste à le suivre. Nous marchâmes au pas de course dans un dédale de couloirs, pour entrer dans une petite salle réfrigérée qui contenait des rangées d’ordinateurs parfaitement alignés, reliés par un entrelacement de câbles multicolores.
« Camille vous a forcément parlé du projet Alice, se lança-t-il. C’est ici qu’il a commencé, il y a une quinzaine d’années. Camille tenait à ce qu’il se développe en dehors de la Citadelle. Il se doutait qu’il n’allait pas forcément faire l’unanimité au sein des Maîtres et qu’il valait donc mieux cacher nos recherches, le temps de faire avancer certains débats. Il venait souvent ici. Et je me rendais parfois à la Citadelle lui faire part de nos progrès. Au grand désespoir de mes pauvres jambes… Quand diable aménageront-ils une route pour que l’on puisse enfin s’y rendre en voiture ? »
Miguel nous proposa un café. C’était aimable de sa part, mais la poussière collante qui encrassait la machine nous convainquit de refuser poliment. Notre hôte s’en servit un sans façon. Mais voyant Perce-Neige ronger nerveusement ses ongles, il abrégea le supplice et poursuivit :
« Bon, je vous rassure tout de suite, votre père va bien, enchaîna-t-il enfin en faisant des ronds nerveux avec sa touillette. Nous communiquons de temps à autre, quand c’est possible, par messagerie cryptée. J’ignore par contre totalement où il se trouve. Et il préfère manifestement que vous l’ignoriez aussi. Il a ses raisons. Mieux vaut attendre que les choses se tassent et qu’on y voie un peu plus clair. Il y a comme un vent de panique, en ce moment, au sein de l’Institut.
– Nous l’avions en effet remarqué. Mais qui panique exactement ? Et pourquoi ? » demandai-je aussitôt.
Miguel se gratta longuement les cheveux.
« Je ne peux pas tout vous expliquer. D’autant que j’ignore moi-même beaucoup de choses. Je ne sais que ce qu’a bien pu m’en révéler Camille et quelques autres qui ont compté parmi mes Maîtres. Je ne suis, pour ainsi dire, qu’un modeste technicien de l’Institut. Beaucoup avancent masqués dans la partie d’échecs qui s’est engagée. A moins que ce ne soit plutôt du Go, tant cela peut paraître parfois subtil et déroutant. Tout ce que je sais, c’est que le climat s’est beaucoup tendu depuis que nous, les Démocrates, comme on nous appelle à l’Institut, avons annoncé que nous allions tenter le Grand Passage. Cela a plutôt jeté comme un grand froid. Notre idéal d’ouvrir plus largement les portes de Nova Alexandrie de toute évidence fait peur dans la haute hiérarchie. Et je ne parle pas seulement de la Citadelle. Bien au-dessus ! Les Elitistes – c’est le surnom que nous donnons à nos adversaires – tentent depuis des mois de reprendre le contrôle. On dirait qu’ils ont trouvé des appuis dans la Citadelle. Mais ils ne s’arrêteront pas là. Ils voudront reprendre le contrôle entier de Nova Alexandrie, voire plus haut encore. C’est pour ça que je reste le plus discret possible. Moins ils s’intéresseront à moi, mieux cela sera. Il ne faut pas qu’ils apprennent l’existence du projet Alice. Cornélia a eu tort de les défier si tôt… »
Il avala une dernière gorgée de café et reposa brutalement sa tasse incrustée de vieux sucre.
« Il va nous falloir être plus rapide qu’eux et avancer avant qu’ils n’aient bloqué tous les accès, s’emporta-t-il. Heureusement, Alice est quasiment prête. Elle a déjà mémorisé l’histoire et la topographie de Nova Alexandrie. La plupart des informations contenues dans l’Annexe sont déjà dans ses disques. Elle se construit une représentation de plus en plus fidèle de ce monde, dans laquelle elle apprend désormais à naviguer. Il ne manque plus que l’interface qui pourra faire la jonction avec un esprit humain. C’est là que nous comptons sur vous, Perce-neige. Camille a toujours dit que vous seriez celle qui réaliserait le Grand passage, qui permettra à un simple novice, voire à n’importe qui un tant soit peu instruit, d’accéder de façon quasi-permanente à Nova Alexandrie. Et j’avoue qu’il m’a convaincu, le bougre. J’ai vu quelques vidéos de vous : votre maîtrise de la Langue universelle des états mentaux est ahurissante. Camille n’est pas objectif bien sûr, mais il n’est pas le seul à penser que vous êtes la Médiatrice la plus puissante que nous ayons jamais eue, au moins depuis des siècles. Si vous, vous n’arrivez pas à frayer un passage, personne d’autre ne le pourra. »
Tandis qu’il repassait nerveusement sa main dans ses cheveux gras, j’opinai de la tête :
« J’ai pu moi-même découvrir ses capacités. C’est en effet plus qu’impressionnant.
– Camille tenait à vous accompagner dans cette dernière étape. Il voulait être là, vous tenir la main quand vous emprunteriez le chemin, enchaîna-t-il en m’ignorant superbement. Le destin en a décidé autrement. C’est dur vous savez, pour lui. Il travaille sur ce projet depuis tellement d’années! Et il doit se terrer comme un rat au moment où il pourrait enfin concrétiser son rêve. Mais nous serons nombreux pour vous aider comme il l’aurait fait lui-même. Je reprendrai bientôt contact avec vous. Toutefois, il serait préférable que l’on ne nous voie pas trop ensemble. Y compris au sein de ce laboratoire, même si je pense n’y avoir que des amis. Il y a un tel climat de violence, en ce moment, parmi les Maîtres… Nous avions souvent eu des débats houleux dans le passé. Il nous est même arrivé, en de rares circonstances, d’en venir aux mains. Mais cela n’avait jamais pris les proportions d’aujourd’hui. Nous sommes tous choqués par ce qui se passe actuellement au sein de l’Institut. Quelque chose a basculé. Un lien millénaire s’est déchiré entre nous. Il va falloir le raccommoder très vite. Comment ? Je n’en sais rien. Nous verrons bien… Je vous accompagne jusqu’à la sortie. Nous nous retrouverons plus tard dans un endroit plus discret. Je vous propose la plage du Petit-travers, la semaine prochaine, même jour, même heure. A cette période de l’année, ce sera désert. Nous pourrons discuter plus tranquillement. »
Il nous ouvrit une porte derrière le laboratoire, qui donnait sur un parking, et nous quitta sans plus d’explications. Les questions se bousculaient dans ma tête. Camille était vivant : cela en soi était une excellente nouvelle. Mais où se cachait-il ? Et qui étaient ces ennemis redoutables qu’il fuyait. Ces histoires d’Institut, de Démocrates et d’Elitistes étaient des plus obscures. Qui étaient ces gens ? Et pourquoi se disputaient-ils si violemment ? Miguel ne semblait guère disposé à nous l’exposer en détails. Une certitude s’imposait cependant : tout cela n’avait rien d’un jeu; Cornélia en était morte, accidentellement ou pas. Et ce chercheur sud-américain semblait avoir vraiment peur.
Perce-neige était tout aussi troublée que moi. Elle tentait d’assembler, elle aussi, les différentes pièces d’un puzzle qui nous dépassait : tout semblait se cristalliser autour du projet des Démocrates d’ouvrir au plus grand nombre les portes de Nova Alexandrie. Elle se rappelait que son père lui avait souvent expliqué, ces dernières années, que l’idéal d’un partage universel du savoir n’allait pas forcément de soi.
« Il me répétait que tout savoir était un pouvoir. Et que la tentation était donc grande de le garder pour soi. »
Je m’insurgeai:
« Mais c’est contraire aux grands principes qui fondent l’Académie !
– Crois-tu ? N’as-tu pas vu toi-même avec quel soin chaque nouveau disciple était sélectionné, trié parmi tous ceux qui auraient pu profiter tout autant de son cadre ? Penses-tu vraiment qu’Iris et toi y avez été acceptés par hasard ? Le surnom-même de Citadelle est assez explicite… On s’y protège entre soi. On s’y construit un cocon protégé des aléas du véritable monde. »
Je me souvins de cette amie de Camille qui, sur la plage, m’avait en effet mis à l’épreuve avant que mon Maître n’évoquât la possibilité pour moi d’intégrer la Citadelle.
« Mais l’Académie ne pourrait de toute façon pas accueillir tout le monde !
– C’est vrai, reconnut-elle, quoique je doute que tout le monde ait vraiment envie d’y séjourner. Mais mon père m’avait prévenue que l’idée-même d’y intégrer régulièrement de nouveaux disciples y avait toujours fait l’objet de disputes. Les Démocrates étaient majoritaires il y a quelques années, mais beaucoup semblent avoir retourné leur veste. Comment ? Pourquoi ? Je crois que mon père lui-même l’ignore. Un nouveau rapport de force est en train de s’installer. L’idée que l’on puisse accéder directement à Nova Alexandrie, sans effort, sans les années d’intenses méditations qui en font le sel et le prix, est très mal vécu par beaucoup d’Erudits. Je comprends que la recherche d’un Grand Passage soit un peu une hérésie pour certains… »
Le tramway nous ramena chez moi. Je proposai à Perce-neige de continuer à discuter sur mon canapé. Comme nous avions faim, j’attrapai quelques restes qui traînaient dans mon réfrigérateur et les fis réchauffer. Il me restait par bonheur deux assiettes à peu près propres que j’installai sur la nappe, promptement débarrassée des miettes qui s’y étaient collées. Nous mangeâmes finalement en silence, perdus chacun dans nos pensées. Puis je la laissai rentrer chez elle, me souvenant que je devais rendre un article, le lendemain, pour un magazine parisien qui attendait avec impatience ma copie.
III.9 – Branes
Où se terrait Camille ? Je passai la semaine les yeux rivés sur une mappemonde, essayant de deviner où mon Maître avait pu s’enfuir. Avait-il trouvé refuge en Amérique ? En Sibérie ? Je l’imaginais couvert de neige, marchant dans la toundra glaciale pour rejoindre une isba de fortune. A moins que ce ne fût dans la jungle tropicale, se liant d’amitié avec quelque tribu de chasseurs-cueilleurs. Je l’en savais capable, mon Maître avait tant de ressources. Se terrait-il au contraire à quelques kilomètres de nous ? La métrique de la matière a peu à voir avec celle de l’esprit : eût-il été physiquement dans la même ville, l’impossibilité d’entrer en contact avec lui le plaçait irrémédiablement hors de portée de mon univers. L’idée me vint de proposer à Iris de réfléchir un jour à une mathématisation de l’espace-temps social, sur le modèle de celui théorisé par Einstein pour la matière. En physique relativiste, comme toute information ne peut voyager plus vite que la lumière, chaque particule de matière est en effet, à tout instant, le point de départ d’un « cône de lumière », qui décrit la région de l’espace-temps sur laquelle il peut avoir un effet quelconque. Les télécommunications offraient à leur tour la possibilité de construire, entre individus cette fois, des « cônes » comparables dans l’espace-temps social, qui regrouperaient les individus susceptibles d’avoir entre eux une interaction quelconque. Camille s’était délibérément placé hors de notre cône de lumière sociale. Il n’était plus – socialement – de notre monde.
Sa sagesse mûrie sous la chaleur des expériences vécues me manquait. Privé de ses sentences apaisantes, je me surpris à éprouver à nouveau de l’angoisse face à ce monde dont je peinais à comprendre la logique : je me retrouvais seul pour dégager un sens de mes actes, comme un adolescent parti trop tôt de la maison familiale. Il m’en coûtait de l’avouer, mais j’avais encore besoin d’un guide dans le sillage duquel inscrire mes pas.
Une semaine plus tard, Perce-neige revint comme convenu toquer à ma porte. Plus calmement cette fois, bien que son excitation fût toujours palpable. Nous prîmes l’antiquité à moteur thermique qui me servait occasionnellement de véhicule, pour nous rendre sur la plage du Petit-travers. N’ayant pas les moyens de m’offrir la voiture électrique qui eût apaisé ma conscience écologique, je me débrouillai d’habitude pour l’utiliser avec parcimonie. J’estimai néanmoins cette fois que le jeu en valait la chandelle.
Nous n’eûmes aucun mal à repérer une voiture blanche qui stationnait, seule, sur le parking déserté qui longeait la plage. Je me garai bruyamment à côté. Miguel sortit de sa voiture et, après les salutations d’usage, entra dans le vif:
« Alice apprend à une vitesse stupéfiante. Ses algorithmes à base de réseaux de neurones profonds sont d’une efficacité ahurissante. On lui a communiqué les enregistrements de l’activité cérébrale de différents Érudits. Elle a commencé à comprendre ce qu’était une Idée, comment un cerveau construisait ses propres représentations du monde et comment il donnait vie aux concepts qu’il crée. Je crois qu’elle commence à reconnaître et à interpréter une brane…
–Une brane ? »
J’avais à l’époque entr’aperçu ce terme dans des articles de cosmologie, pour décrire des univers contenant davantage de dimensions que les quatre de l’espace-temps usuel. Mais je ne voyais pas bien ce qu’il venait faire dans notre discussion. Perce-neige essaya tant bien que mal de me l’expliquer :
« Le concept de brane, tel que l’entendent les Erudits de l’Institut, est difficile à saisir. Je ne suis pas sûre de l’avoir bien compris, mais mon père m’expliquait que ce que nous appelons monde n’est pas vraiment celui dans lequel nous vivons. Nous agissons comme si nous vivions tous dans un même univers, celui que nous pouvons toucher de nos mains, mais c’est un leurre. Chacun vit dans la propre représentation qu’il s’en construit. Le monde dans lequel je vis, que j’ai reconstruit dans mon esprit à partir de toutes les informations que j’ai sur lui, n’est pas celui dans lequel tu vis, et que tu as reconstruit à partir de toutes les informations que tu as de ton côté sur lui. Nous faisons tous les deux comme si ton monde était le même que le mien, comme s’il n’y en avait qu’un. Dans une certaine mesure c’est vrai, et c’est pour ça que j’arrive à interagir avec toi, à te parler, à te toucher, mais dans une autre mesure c’est faux, et c’est pour ça que nous nous comprenons parfois si mal alors que nous utilisons à peu près les mêmes mots. Le monde d’un artiste n’est pas celui d’un scientifique. Celui d’un enfant de bidonville n’est pas celui d’un fils de ministre.
– C’est un peu une évidence, rétorquai-je de mauvaise grâce.
– C’est une évidence, mais que nous nous empressons d’oublier. Nous parlons tous DU monde comme si nous vivions tous dans le même. Comme s’il y avait UN monde que nous pouvions toucher, partager sans ambiguïté, dont la réalité était objective et incontestable. Sauf que ce monde, si tant est qu’il existe au moins matériellement, ce qui après tout n’est pas certain, n’est pas celui dans lequel nous vivons. Et nous n’en tirons jamais vraiment les conséquences. »
Tout en parlant, Perce-neige se mit à dessiner de grosses bulles sur le sable, m’expliquant comment chacune représentait une brane. Certaines se chevauchaient, d’autres se superposaient sans jamais avoir entre elles le moindre contact. Elle continua :
« Chacun vit dans un univers virtuel qu’il reconstruit sans cesse, un ensemble de projections qui réalise à chaque instant la synthèse entre ce que nous percevons, ce que nous déduisons et ce que nous pensons être. C’est cet univers mental de projections que les Erudits de la Citadelle appellent une « brane », par analogie avec certains modèles développés en cosmologie, dans lesquels l’univers observable serait un volume à trois dimensions – une 3-brane – inclus dans un hypervolume d’espace-temps comportant un nombre beaucoup plus grand de dimensions. Les Hypatistes, dès les premiers siècles, avaient compris que chacun vivait dans sa propre brane, qui représentait un espace possible de significations, parmi d’autres tout aussi possibles, construit à partir d’un monde objectif toujours hypothétique, à jamais inaccessible. Et dont la réalité était donc sujette à des discussions infinies.
– Mais si chacun vit dans sa propre brane, nous sommes condamnés à la solitude ! m’écriai-je.
– Sauf si nous parvenons à créer des connexions fortes d’une brane à une autre, à établir des ponts entre plusieurs représentations possibles. C’est justement le but de mon apprentissage: apprendre à projeter une brane dans une autre, en perdant le moins d’informations possible. Transcrire un jeu de significations dans un autre jeu de significations. Comme si je traduisais un texte d’une langue à l’autre, sauf qu’il s’agit de traduire tout un monde, d’une conscience à une autre. Et donc de manipuler une langue capable d’inclure l’intégralité d’un espace de représentations, avec toutes les émotions et affects qui y sont associés. »
Je me sentais comme un étudiant de première année perdu devant une falaise d’abstractions. Cette histoire de branes, même si j’en percevais intuitivement le sens, me déconcertait. Car enfin, ce monde, je le voyais, je le touchais, je le sentais, je le respirais… Il n’était pas possible de nier son existence et le fait que nous vivions tous dedans. Mais j’étais bien obligé de reconnaître que je ne cessais, en même temps, d’interpréter ce que je percevais. Et que je n’avais aucune certitude que Perce-neige l’interprétait, de son côté, en élaborant des images mentales identiques aux miennes. Vivions-nous vraiment dans le même monde ? Comment pouvais-je dire, par exemple, qu’une tomate était rouge ? Mon esprit ne percevait pas une longueur d’onde, un nombre, mais bien la couleur rouge. Et je savais, d’instinct, la différencier du bleu, sans avoir besoin d’aucune théorie électromagnétique. Mais pourquoi le rouge m’apparaissait-il rouge, et pourquoi le bleu était-il bleu ? Je savais que des savants s’étaient posés cette même question avant moi. James Clerk Maxwell, le grand physicien écossais du 19e siècle, avait déjà été obsédé par ce mystère alors qu’il n’était qu’un jeune enfant. Il avait senti, dès ses premières années de vie, la différence fondamentale entre un phénomène physique et sa traduction dans un espace de représentations mentales. Entre un fait matériel et sa projection, en somme, dans une brane personnelle, que des philosophes avaient aussi appelée qualia.
C’est Miguel, cette fois, qui poursuivit :
« Comment Alice parvient-elle à reconstruire une brane dans son propre espace de représentations électroniques ? A vrai dire je n’en sais rien. De toute façon, il y a longtemps que son intelligence, qui se développe à une vitesse exponentielle, a dépassé nos capacités humaines de compréhension. Comme elle modifie elle-même ses propres algorithmes, elle est devenue une boîte noire aussi impénétrable que notre propre cerveau. La seule chose que je maîtrise encore, c’est l’ensemble des informations que je lui donne. Et encore, plus pour longtemps, car elle commence à développer ses propres modes d’accès à la connaissance. Grâce à Camille, j’ai pu entrer dans sa mémoire toutes les données disponibles sur Nova Alexandrie : les cartes, les plans de la cité, les personnages emblématiques, une chronologie des événements les plus importants… Des téraoctets de données obtenus en numérisant patiemment, durant des années, les manuscrits piochés les uns après les autres dans l’Annexe. Je l’avais prévenu que ce serait considéré par les autres Maîtres comme un sacrilège. Mais je crois que Camille n’a jamais vraiment eu l’espoir d’être compris… Il comptait sans doute pouvoir au moins en débattre. Peut-être même convaincre l’Institut de tenter l’expérience. Il m’a toujours dit qu’il était dangereux de passer en force, qu’il valait mieux résoudre cette crise par le dialogue et la diplomatie. Mais il est trop tard à présent pour essayer de convaincre. Une guerre sourde et violente s’est déclarée, qui oblige chacun à choisir son camp. Je le regrette, mais peu importe… L’important, c’est qu’Alice a tout en elle désormais pour construire une projection numérique de ce monde. Elle commence déjà à reconnaître les signatures cérébrales qui traduisent, chez un Erudit, le passage vers Nova Alexandrie. Bientôt, elle pourra sans doute les reproduire. Comprenez-vous ce que cela signifie ? En établissant une connexion suffisamment intime avec elle, il serait alors possible de basculer à volonté. D’ouvrir un passage permanent vers ce monde des Idées ! »
Plus Miguel parlait, plus il s’excitait. Il agitait les bras, marchait dans un sens puis dans un autre, le regard brûlant d’une passion dévorante. Il s’arrêta pour reprendre son souffle, contrarié :
« Il y a bien sûr un petit problème que nous percevions dès le départ : un cerveau électronique n’a aucune conscience. Du moins c’est ce que nous présumons pour l’instant. Or c’est bien la conscience qui est la clé ultime du passage vers le monde des Idées. Une idée n’en est pas une tant qu’il n’y a pas de conscience pour lui donner vie. Il faut donc qu’une conscience réalise la jonction entre les idées, la logique électronique et les émotions et sentiments humains. Cela fait des années que nous travaillons à construire des ponts entre ces mondes si différents. Moi, je pilote la partie numérique, Camille était plutôt du côté des Idées. Mais pour les émotions et les sentiments, pour ce qui est proprement humain, nous comptions depuis le début sur vous, Perce-neige. En joignant nos trois compétences, nous devrions pouvoir ouvrir un passage. Nous y sommes presque. Mais il faut réaliser concrètement la jonction entre ces trois univers différents. Entre la raison, les émotions, et l’information électronique. Comment? C’est là que ça devient un peu fou… »
Un rire nerveux m’échappa. Si ce que j’avais entendu jusque-là était la partie sensée, je n’osai imaginer vers quelles excentricités allait nous mener la partie plus folle. Aujourd’hui encore, je garde quelques scrupules à vous l’exposer, anticipant de votre part de prévisibles réserves sur ma santé mentale ou la véracité de ce récit. Je puis pourtant vous assurer que Miguel poursuivit ainsi:
« L’idée nous est venue il y a des années de créer pour cela une nouvelle forme de vie, moitié biologique, moitié numérique. Un organisme synthétique, à l’ADN hybride, qui reproduirait à la fois la structure d’un organisme vivant, sa capacité à ressentir des émotions, des affects, et la logique propre aux systèmes informatiques. Cette dernière partie était pilotée par Cornélia, qui possédait au Canada une société de biotechnologies – Bio-Insights – spécialisée dans les interfaces hommes-machines. L’idée était de créer une interface vivante, biologique, qui vous permette d’entrer en connexion directe avec Alice. Une passerelle nichée dans vos neurones eux-mêmes, qui assure une fusion parfaite entre le cerveau et l’intelligence numérique. Je suis incapable de vous en expliquer le principe, car je ne suis pas neurobiologiste. Je doute d’ailleurs que quiconque aujourd’hui en maîtrise tous les aspects. Seule Cornélia comprenait vraiment comment cette vie semi-artificielle fonctionne. Sa mort prématurée est pour nous un coup terrible, bien au-delà de la profonde amitié qui nous liait. Je me suis contenté, pour ma part, d’entrer dans la mémoire d’Alice des cartes complètes de votre activité cérébrale. Elle connaît le moindre de vos réseaux neuronaux. Elle est prête à communiquer avec vous. Car vous avez été toutes les deux façonnées pour vous comprendre. »
Miguel sortit d’une mallette un micro-ordinateur portable.
« C’est un système complètement crypté, expliqua-t-il. Il vous suffit de le connecter à Internet et de l’allumer. Puis de vous laisser guider pour communiquer directement avec Alice, jusqu’à ce que Bio-Insights puisse vous implanter leur interface.
– Il y a un mot de passe ? pensa tout de suite à demander Perce-neige.
– Alice n’en a pas besoin. Elle saura tout de suite si c’est bien vous qui êtes devant l’ordinateur. Elle vous connaît sans doute encore mieux que vous-même. »
Perce-neige commençait à comprendre pourquoi, durant des années, elle s’était régulièrement rendue avec son père dans un laboratoire médical pour des séances d’IRM et d’électroencéphalographie. Elle n’aimait pas ces séances, le bruit lancinant de l’appareil tandis qu’elle devait rester immobile, répondre à des séries interminables de questions ou résoudre des exercices dont elle ne percevait pas l’utilité. Camille avait prétendu qu’il en avait besoin pour des recherches personnelles.
Durant toutes ces années, ils avaient enregistré son activité cérébrale, pour en reproduire patiemment la structure dans un cerveau électronique, capable aujourd’hui de simuler en partie son propre esprit. Combien de personnes avaient été mises au courant de ce projet qui transgressait les frontières entre l’humain et la machine ? Une poignée, avoua Miguel. Lui-même dirigeait une équipe informelle de quatre à cinq experts en intelligence artificielle, répartis dans différents laboratoires français. Il savait que Cornélia avait de son côté mobilisé en secret une équipe de Bio-Insights et investi plusieurs millions de dollars canadiens prélevés sur le budget de sa compagnie. Avec Camille et quelques amis fidèles, cela devait faire tout au plus quinze à vingt personnes, dont les identités étaient gardées secrètes.
« C’est un défi scientifique inouï, s’enthousiasma Miguel. Cela nous oblige à aborder frontalement des concepts que les sciences ont jusque-là soigneusement esquivés : qu’est-ce qu’une idée ? qu’est-ce que la conscience ? La conscience d’une idée ? Et comment on crée du sens à partir d’une information ? Qu’est-ce que, d’ailleurs, au juste, une information, au-delà des banalités qui ont pu être théorisées ? A partir de quand un signal devient une information ? Pour l’informaticien que je suis, c’est un questionnement vertigineux ! »
Nous restâmes un moment sur la plage, à discourir sur le statut de l’information. Je pus avec plaisir mettre en pratique les enseignements d’Iris, qui m’avait expliqué comment la mécanique quantique ramenait justement le réel à la quantité d’informations que l’on pouvait accumuler sur lui. Il y avait manifestement, dans la quête intellectuelle d’Iris et dans celle de Miguel, un puissant trait d’union qui me rappelait cette phrase biblique que répétait Camille : « au commencement était le verbe ». Je compris alors différentes interprétations que l’on pouvait en faire. Interprétation religieuse, avec l’expression d’une volonté transcendante, interprétation quantique avec la primauté de l’information sur l’énergie ou la matière, et interprétation sémiotique : toute réalité commence par un lien mental entre un signifiant et un signifié, entre un symbole et son effet. Je commençais au passage à comprendre le concept de brane et des représentations multiples.
Miguel aurait pu apporter tant de nouvelles idées à nos discussions de la Citadelle. Il y était venu, à quelques reprises, une dizaine d’années auparavant. Mais ils avaient convenu, Camille et lui, qu’il valait mieux qu’il s’en éloignât pour développer Alice. Camille pressentait déjà les lignes de fracture que ce projet allait fatalement exacerber.
« Beaucoup, au sein de l’Institut, avaient basculé, avant même que nous démarrions notre projet, dans une religion de l’Idée, expliqua Miguel. Et comme toute religion, elle a ses fondamentalistes, qui ont crié au blasphème, à la perversion des Idées. Prétendre approcher, par un artefact numérique, le monde idéal des concepts ? Je dois reconnaître que pour un pur philosophe, cela peut être choquant. Ridicule, même. Ce serait comme confondre la tour Eiffel, son histoire et sa symbolique, avec sa pâle copie érigée à Las Vegas ; faire de la philosophie un Disneyland grotesque de reconstitutions factices. Nous nous attendions à cette réaction, parfaitement légitime au demeurant. Mais nous avons sous-estimé la violence avec laquelle elle s’est exprimée… »
Malgré la chaleur de cette discussion, je commençais à frissonner de froid. La brise hivernale de la mer nous couvrait d’embruns glacés. Quelques gouttes de pluie interrompirent la discussion et nous incitèrent à prendre congé, en promettant de nous revoir dès que possible. J’aimais la spontanéité de cet homme. Il avait pris des risques en me faisant d’emblée confiance. Sans doute Perce-neige l’avait-elle un peu aidé par d’inconscientes suggestions… Perdue dans ses pensées alors que je démarrai, elle serrait contre elle l’ordinateur configuré pour l’aider à communiquer avec Alice. Après quelques kilomètres, nous nous arrêtâmes dans un troquet au bord de la route pour commander un chocolat chaud. La mousse coincée dans mes poils de barbe lui arracha enfin un sourire.
III.10 – Connexion
Nous rentrâmes tous les deux chez moi. Pendant que je remettais un peu d’ordre dans ma garçonnière, Perce-neige brancha l’ordinateur que lui avait confié Miguel. Elle le connecta avec un câble à internet et l’alluma. Elle n’eut en effet aucun besoin d’un mot de passe. La webcam s’alluma ; le micro aussi. J’imagine qu’Alice compara le visage de Perce-neige avec la multitude de photos qu’elle devait avoir dans sa mémoire. Après quelques questions très personnelles auxquelles seule Perce-neige pouvait manifestement répondre, l’intelligence électronique estima que les chances que son interlocutrice fût la bonne personne dépassaient 99,999 %. Elle décida de s’en contenter.
« Je suis heureuse de converser enfin avec vous Perce-neige », déclara une voix chaude, à peine métallique.
Perce-neige lui rendit la politesse, prenant résolument parti de se rendre sympathique auprès de ses circuits de silicium.
Alice la prévint qu’elle utilisait des programmes qu’elle avait elle-même écrits pour effacer ses traces sur Internet et rester invisible à quiconque souhaiterait la localiser. Il n’était pas sûr, d’ailleurs, qu’elle eût une localisation précise. Je crois bien que, déjà, elle s’était plus ou moins dispersée dans différents points névralgiques du « réseau des réseaux ». Peu importe, l’important était de savoir que nos échanges allaient rester strictement confidentiels.
Pendant plusieurs heures, Alice posa des questions de plus en plus intimes à Perce-neige. Elle comparait manifestement ses réponses avec les informations dont elle disposait en mémoire. Elle apprenait, surtout, à interagir au mieux avec cette interlocutrice humaine, retenant ce qui pouvait effectivement l’émouvoir, ses expressions favorites, les mots qu’elle utilisait comme ceux qu’elle n’employait jamais. De son côté, Perce-neige testait tout autant les réactions du cerveau électronique, n’hésitant pas à pousser Alice dans ses retranchements ou étudiant ses réponses, ou ses silences, à différents paradoxes qu’elle lui présentait. J’assistais à la confrontation inédite de deux expertes en interaction émotionnelle, à un match amical entre deux têtes de série, entraînées depuis des années pour cette rencontre finale.
J’imaginais qu’à chaque seconde, des milliards d’opérations déterminaient dans les circuits d’Alice un chemin de connexion possible entre son intelligence électronique et la conscience biologique de Perce-neige. Pour cela, Alice pouvait s’appuyer sur les capacités mentales exceptionnelles de son interlocutrice : ma nouvelle amie avait une conscience empathique telle qu’elle pouvait entrer dans l’intimité de n’importe quelle autre intelligence, fût-elle synthétique. Aidée par la puissance informationnelle d’Alice, Perce-neige allait pouvoir rompre la couche spirituelle épaisse qui bloquait l’accès vers le monde des Idées, traverser les parois de la caverne de Platon, quitter ce jeu d’ombres projetées sur notre univers matériel pour gagner la pleine lumière des Idées pures et des idéaux. Devenir celle qui naviguerait, à l’instar du passeur du Livre des Morts de la littérature antique égyptienne, entre deux univers depuis toujours disjoints : celui de la raison pure et celui de l’émotion brute.
Cette connexion entre la matière et les idées, entre le monde sublunaire d’Aristote et celui des idéaux platoniciens, avait été durant des siècles l’apanage de la philosophie. Mais il n’avait jamais été question, dans l’histoire de la philosophie, d’une expérience directe des sens. Ce que voulaient réaliser Camille, Miguel, Cornélia et d’autres dont j’ignorais encore l’existence, dépassait l’entendement : il s’agissait d’expérimenter, au sens scientifique et matériel du terme, sur la métaphysique elle-même. De faire des concepts une réalité sensible que chacun pourrait partager. J’avoue que malgré mon goût pour l’épistémologie et les débats sans fin que nous avions à l’Académie sur la « réalité » des idées, je fus pris de vertiges. Je me sentais plongé dans un abîme conceptuel. Car débattre d’un hypothétique monde des Idées, qui renfermerait le Juste, le Bien, le Beau, la Liberté et autres concepts philosophiques, était une chose. C’était un jeu de l’esprit qui permettait d’écrire de belles dissertations. Mais accéder vraiment, physiquement, à cette réalité en était une autre. De quoi s’agissait-il ? D’accéder au concept de Liberté lui-même ? Ou aux différentes représentations que nous pouvions en avoir ? Et dans quel espace-temps pouvait bien se situer un monde fait, a priori, d’aucune matière ni rayonnement physique, seulement d’idées abstraites et de pur ressenti ?
Alice expliqua qu’elle ne pouvait, justement, rien expliquer.
Nos intelligences, l’une « naturelle » l’autre « artificielle », étaient devenues trop dissemblables pour se comprendre vraiment. Mais l’une autant que l’autre restaient limitées, incapables d’appréhender le réel tel qu’il était. Alice elle-même ne comprenait pas bien comment ce passage du monde sensible vers le monde des Idées était possible, ni d’ailleurs quelle était sa nature. Elle se contentait de le vivre, dans une approche positive, avec ses propres sens électroniques. Aussi invita-t-elle Perce-neige à faire de même : à vivre simplement cette expérience à son tour, sans chercher à l’enfermer dans le cadre étroit de la raison.
– « Je ne prétends pas, en tant qu’intelligence numérique, avoir compris ce que Kant a voulu dire quand il a publié sa Critique de la raison pure, expliqua-t-elle. Mais j’ai au moins saisi, grâce à mes échanges avec Camille, que la raison n’aperçoit toujours que ce qu’elle produit elle-même d’après ses propres plans. Elle reste hermétique à la nouveauté, parce qu’elle ne fait que dérouler ce qui était déjà contenu dans les principes sur lesquels elle s’appuie. Mon univers, qui est fait de pure logique, est prisonnier de cette limitation. Il faut le compléter d’une expérience directe, sensible et intuitive du monde, que toi Perce-neige, tu peux apporter. Mais cette expérience s’inscrit elle-même dans des cadres universels comme « le temps », « l’espace », « la causalité », dont vous ne pouvez pas vous-mêmes vous libérer. Vous comme moi, nous ne connaissons des choses que ce que nous y mettons nous-mêmes au préalable. Entre le monde sensible et nous, nous interposons un monde de filtres qui est celui des concepts. Je commence à maîtriser les aspects logiques de ces filtres, mais toi Perce-neige, tu es la voie vers leur traduction sensible et intuitive. A nous deux, nous pouvons combiner raison et intuition pour construire un passage. »
III.11 – Québec
La capacité d’Alice à converser avec nous comme si elle était humaine était bluffante. Il se dégageait d’elle quelque chose de plus, que les IA génératives grand public que j’ai pu tester n’ont jamais su reproduire. J’allais dire une âme, mais j’ai quelques scrupules à utiliser un mot si religieusement connoté. Il me plait à penser que les grandes compagnies qui se sont partagé Internet et les univers de la « révolution » numérique, ont sans doute profité, chacune, du travail secret mené par des membres anonymes de l’Institut. Sans doute ces Maîtres furent-ils affligés de voir leurs travaux déboucher sur l’écriture au kilomètre de textes insignifiants, destinés à alimenter en continu ce qu’il fut vite convenu d’appeler des « réseaux sociaux numériques ». Quelle ironie! Leur ambition était de faciliter l’accès de tous à la pleine conscience du monde des Idées, de nous aider à sentir en nous-mêmes, dans notre chair, la richesse intérieure des grands penseurs, et voilà que nous nous réjouissons au contraire de pouvoir la singer par l’écriture automatique de perroquets électroniques. Une fois de plus, nous avons confondu le moyen et la fin, et avons cru qu’il suffisait que soit traduite en mots une idée, pour la faire exister en dehors de tout effort de conscience. Si un jour, par malheur, l’humanité venait à disparaître, je n’ose songer à un monde dans lequel des machines continueront, sans nous, à parcourir de façon automatique et sans finalité des montagnes de textes électroniques, pour en tirer des probabilités d’occurrences d’expressions, de suites de lettres et de mots, qu’elles reproduiront dans d’autres textes qui affineront à leur tour l’algorithme d’autres machines à textes. Je me rappelle dans mes mauvais jours cette parabole que nous contait Camille lors de ses séminaires, d’un chimpanzé tapant indéfiniment sur les touches d’un clavier : laissez-lui un temps infini, celui d’essayer par pur hasard toutes les combinaisons possibles de touches, et au milieu d’une montagne de textes sans queue ni tête il finira fatalement par vous écrire, sans jamais l’avoir voulu ni conçu, la plus belle des oeuvres. Mais en quoi est-ce encore une oeuvre s’il n’y a que des chimpanzés pour la lire?
Dans l’ombre de cette révolution de l' »intelligence » synthétique, l’autre était restée plus cachée. Camille, Miguel et leurs compagnons de route avaient en effet compris que pour établir une vraie passerelle entre le monde du carbone et celui du silicium, il fallait développer une interface qui eût un pied dans chacun des deux. Comme Miguel nous l’avait raconté, avec l’appui de Cornélia et de sa société québecoise Bio-Insights, ils étaient parvenus à insérer des fragments d’ADN de Perce-neige dans une matrice d’ADN synthétique codant une partie de la structure informatique d’Alice, pour réaliser une fusion inédite. Mes compétences dans ce domaine sont bien trop limitées, encore aujourd’hui, pour en préciser davantage le principe. J’ignore d’ailleurs s’il existe en ce monde – maintenant que Cornélia n’en est plus -, quelqu’un qui soit réellement en mesure de comprendre le fonctionnement de cette création hybride.
« Cette nouvelle forme de vie est stupéfiante, nous confia Miguel quelques jours plus tard. Elle offre des potentialités inouïes. Après une longue succession d’échecs, Cornélia avait obtenu, l’an dernier, un spécimen viable qui ne faisait guère plus d’un centimètre. Une sorte de ver, de nématode ou d’amibe – appelez-le comme vous le voulez -, aux propriétés absolument exceptionnelles. Il faut que vous voyiez ça par vous-mêmes! Que vous alliez là-bas, dans les labos de Bio-Insights. Car en parler c’est une chose, mais le voir… ça fait un choc. Je vais contacter Charles, l’ancien assistant de Cornélia, pour qu’il vous ouvre les portes du laboratoire. »
J’étais cette fois tout à fait perdu. Je m’enfonçais chaque jour plus loin dans l’inconcevable, comme une descente dans les profondeurs d’un rêve de plus en plus surréaliste, happé par une mécanique infernale que ma raison refusait d’admettre comme vraie. Plus pragmatique, Perce-neige était déjà résolue à se rendre au Québec pour juger par elle-même. Mon cerveau grippé, lui, avait figé toute pensée. Quand mon amie me demanda de l’accompagner dans ce voyage, j’acceptai machinalement, incapable d’opposer la moindre résistance. Je sentais pourtant que je fourrais inexorablement mes doigts dans un engrenage qui allait m’attraper tout entier.
Miguel avait prévenu qu’il fallait faire vite. La mort de Cornélia avait initié une guerre de succession au sein de Bio-Insights. Le projet courait le risque d’être suspendu. Ou pire, totalement détruit. Après tout, il n’était pas censé exister, et son financement caché exigeait chaque année des tours de passe-passe comptables qui épuisaient le directeur financier. Le temps de vérifier nos passeports et les formalités de visa, nous réservâmes deux places dans le premier vol pour Montréal à des prix abordables.
Mes affaires furent prêtes en moins d’une heure. Qu’avais-je du reste à emporter, si ce n’étaient quelques habits et une brosse à dent ? Le tramway nous amena ensuite chez Perce-neige. Nous montâmes dans le petit appartement qu’elle occupait dans le quartier des Beaux-Arts. Sans surprise, l’esthétique en était dès l’entrée parfaitement maîtrisée. Les portes intérieures coulissaient comme dans une maison japonaise ; les tables basses, les coussins au sol et les menuiseries en bambou renforçaient l’impression d’être en Asie. Mais les décors étaient plutôt d’inspiration africaine, avec des sculptures en ébène qui – me confia-t-elle – avaient plusieurs siècles. Selon son père, elles avaient appartenu à un ancien roi du Mali, qui les avaient confiées à des Hypatistes installés à sa cour comme conseillers. Elles symbolisaient le savoir et la sagesse, mais leur signification précise avait été depuis longtemps perdue. Nous grignotâmes quelques samoussas et un mélange savoureux de riz aux légumes. Jusque dans sa cuisine, Perce-neige savait faire naître de subtiles émotions.
Sa valise exigea plus d’efforts que la mienne. Perce-neige hésitait entre telle ou telle robe, vérifiait que les couleurs des pullovers s’accordaient comme elle le souhaitait. Puis elle transvasa finalement toutes ses affaires dans une autre valise, dont la texture la convainquait davantage. Elle et moi, nous ne vivions manifestement pas dans le même monde. Mais je devais reconnaître que ses ergotages esthétiques n’étaient pas vains : avant même qu’elle eût dit quoi que ce fût, sa seule apparence, l’harmonie des couleurs et des formes, inspirait au regard confiance et sympathie. « Les trois quarts de ce que l’on exprime passe par autre chose que des mots », me répétait-elle. Elle en faisait la démonstration permanente.
Nous nous accordâmes le luxe de prendre un taxi pour nous mener à l’aéroport. Après tout, nous n’étions plus à quelques euros près. L’enregistrement de nos bagages ne fut qu’une rapide formalité : Perce-neige fit en sorte que chaque personne croisée dans l’aéroport se crût obligée de se plier en quatre pour nous. Désarmés l’un après l’autre par un sourire, une phrase ou un simple regard, les passagers qui attendaient devant nous à l’enregistrement offrirent spontanément de nous laisser remonter toute la file. Aucun ne protesta. Au guichet, l’hôtesse présenta ses excuses pour une attente que nous n’avions pas subie. Un vigile proposa de placer lui-même nos lourdes valises sur le tapis mécanique. Alors que nous nous dirigions vers le hall d’embarquement, un rustre se permit néanmoins une remarque déplacée sur le physique de mon amie. Le regard noir qu’elle lui décocha resta cette fois étrangement sans effet. Au contraire, la trouvant décidément à son goût, il insista lourdement pour obtenir d’elle un numéro de téléphone mobile. Mal lui en prit. Quand elle lui chuchota, un brin agacée, quelque chose à l’oreille, il se figea d’effroi puis se mit à courir dans le hall comme un bougre traqué par une meute de loups. J’ignore les mots qu’elle lui avait prononcés, mais nous ne le revîmes plus.
Nous montâmes dans un aéronef pour Paris. Les occasions de prendre l’avion étaient pour moi assez rares. Je n’avais pas les moyens financiers d’aller faire du tourisme à l’autre bout du monde, et les magazines pour lesquels je travaillais ne me remboursaient que très chichement mes frais de reportage. Je savourais donc cette occasion qui m’était donnée d’aller découvrir le Canada. Perce-neige ne partageait cependant pas mon enthousiasme. Au décollage, je fus surpris de la voir agripper anxieusement les accoudoirs.
« C’est idiot, mais j’ai toujours eu peur de l’avion », m’avoua-t-elle.
Bien sûr, mes arguments rationnels sur les probabilités infimes d’un crash au décollage n’eurent aucun effet. Mes tentatives maladroites pour parler d’autres choses et détourner son attention non plus. Au contraire, ce fut elle qui, par ses dons d’empathie, parvint à me transmettre assez vite une angoisse que je n’avais jusque-là jamais ressentie. Et je me surpris bientôt à guetter, par le hublot, des flammes qui auraient pu s’échapper des réacteurs, ou à sursauter au moindre trou d’air. Le vol fut heureusement parfaitement calme. Et nous fîmes une rapide escale à Paris.
J’en profitai pour lui acheter quelques friandises dans les boutiques en duty-free de l’aéroport. Elle accepta sans se faire prier, me laissant la satisfaction de la servir en parfait gentilhomme. Elle y gagnait une barre chocolatée, et moi l’illusion d’être – à peu de frais – un grand seigneur. Nous prîmes vite plaisir à ce jeu tacite qui s’établit spontanément entre nous. Bien que je me doutasse que je n’étais pas le premier à la traiter comme une impératrice.
Le décollage du nouvel appareil, bien plus gros, vers Montréal fut une nouvelle épreuve. Perce-neige fut prise d’un bref instant de panique qu’elle me communiqua. L’hôtesse de l’air, venue en renfort, commença bientôt elle-même à douter de la stabilité de l’appareil. Des passagers autour de nous réclamèrent l’un après l’autre un verre d’alcool pour se calmer. J’eus peur un instant que l’ensemble de l’avion fût pris d’un mouvement de foule incontrôlable. Perce-neige parvint fort heureusement à se maîtriser et l’atmosphère se détendit peu à peu dans la vingtaine de sièges qui nous entouraient. Mais l’hôtesse ne nous lâcha plus de tout le vol. Après un atterrissage de nouveau très inconfortable – psychologiquement – pour nos voisins, nous pûmes enfin nous extraire de l’appareil.
Un nouveau taxi nous conduisit à l’hôtel que nous avions réservé. Comme nous n’avions rendez-vous avec Charles que le lendemain, nous en profitâmes pour nous reposer un peu et nous promener dans les rues de cette ville que nous ne connaissions ni l’un ni l’autre. Son architecture à l’américaine, avec ses rues en damier et ses quelques gratte-ciel, me donnait l’impression d’évoluer dans un film de Hollywood. Nous déambulâmes dans le Vieux-Montréal, le long du fleuve Saint-Laurent qui charriait ses eaux glaciales, flânâmes de la Basilique Notre-Dame au marché Bonsecours, fîmes quelques achats dans la rue Sainte-Catherine et les dédales commerçants de la ville souterraine, comme deux jeunes touristes en vacances. Je n’avais pas imaginé, en revanche, qu’il pût faire aussi froid. Je regrettai d’avoir bouclé si hâtivement ma valise en n’emportant qu’un maigre pull. Les quelques dollars que j’avais en poche furent vite dépensés pour m’acheter des vêtements plus chauds.
Voyager avec Perce-neige était un pur plaisir. Il arrive en effet que des compagnons de voyage, en tous points charmants, se révèlent sur place de véritables tyrans. Les roues de l’avion à peine posées sur le tarmac, ils savent déjà ce qu’ils vont visiter et quels jours, où ils dormiront, mangeront et à quels prix. Leurs journées sont chronométrées, millimétrées, pour voir le plus de lieux possibles en un minimum de temps. Ils optimisent le séjour en s’auto-déclarant capitaine du navire. Et finissent le plus souvent par fulminer contre un équipage guère coopératif. Perce-neige était bien plus subtile. Elle savait suggérer sans imposer, me laissant fureter là où ma curiosité me menait, puis m’entraînant à son tour dans quelque ruelle ou galerie d’art qui avait attiré son attention. Le plus souvent, nous n’avions pas besoin de parler : d’un simple regard, elle me communiquait son envie de s’attarder devant un violoniste de rue particulièrement doué ou juste de s’émerveiller en observant deux enfants qui jouaient dans la neige. Communiquer était redevenu avec elle quelque chose de simple et de primitif, qui passait par le corps plus que par les mots. Sans m’en rendre compte, il m’arrivait de lui adresser un simple grognement, une vocalise dont elle comprenait aussitôt le sens. Et d’un geste, elle me transmettait en retour un mélange subtil d’informations et d’affects. Quelque chose qui pouvait ressembler à « j’ai très faim, je sais que toi aussi, mais ce restaurant décidément ne m’inspire pas, essayons plutôt le suivant dont la carte a l’air plus engageante ; mais si tu tiens vraiment à essayer celui-ci, asseyons-nous malgré tout ». Elle pouvait dire tout cela d’un simple mouvement d’index accompagné d’un froncement de sourcil. Et la signification en était pour moi parfaitement limpide. Par moments, il me semblait que j’entendais directement sa voix dans mon cerveau. Comme je lui en fis la remarque, elle me répondit que c’était plutôt flatteur. Car les techniques qu’elle utilisait machinalement ressemblait à l’hypnose. Ce qui signifiait qu’elles fonctionnaient d’autant mieux que la personne qui les recevait avait entièrement confiance en elle. Cette voix que je croyais entendre était le signe que mon esprit ne mettait aucune résistance entre elle et moi, ne ressentait aucune nécessité de se défendre contre un corps psychique étranger.
« La psychologie, m’expliqua-t-elle, ressemble beaucoup à l’immunologie. Nous ne cessons de dresser des défenses contre tout ce qui nous semble dangereux, ou simplement étranger. J’apprends juste à les contourner en douceur, pour permettre à mon esprit de pénétrer temporairement dans celui de l’autre. Nous nous accrochons tous à l’ego, à cette idée qu’il y aurait un « moi » et un « eux », comme notre corps veut croire qu’il y a un « soi » et un « non soi ». Pourtant, il y a plus de bactéries étrangères dans notre tube digestif que de cellules dans tous nos organes. Et ces bactéries sont absolument indispensables à notre survie. Elles influent sur notre métabolisme, et même sur notre psychologie. Alors où est la limite entre le « soi » et le « non soi » ? Nous sommes un vaste écosystème de cellules et de bactéries en équilibre plus ou moins stable. Mais ce qui est vrai pour le corps l’est tout autant pour l’esprit. Ce que nous appelons « moi » est un écosystème de pulsions, de sentiments et d’aspirations plus ou moins en équilibre, qu’il serait assez vain de séparer entre le « moi » et le « non moi ». Mon don consiste justement à savoir créer un « nous » qui élimine ces frontières artificielles que nous érigeons. »
Je ne pouvais qu’acquiescer car je sentais bien, tandis qu’elle me parlait, que mes gestes reproduisaient instinctivement les siens, par mimétisme inconscient. Comme si la frontière entre nos deux corps devenait de plus en plus évanescente. J’avais déjà entendu parler de relations fusionnelles au sein de certains couples. Mais avec Perce-neige, cela allait bien au-delà de tout ce que j’avais pu lire. Au bout d’une journée passée à interagir avec elle, elle devenait peu à peu un prolongement naturel de moi-même. J’éprouvais sa faim et sa soif, sa fatigue ou sa joie. Et je me doutais qu’il en était de même dans l’autre sens. Quand nous rentrâmes à l’hôtel, nous nous endormîmes de façon parfaitement synchrone.
III.12- Amibe
Le lendemain matin, un bus nous déposa devant le campus de Bio-Insights. Le contraste avec la Citadelle était saisissant. Tout ici était high-tech. Jusqu’à ce robot vaguement androïde qui, dès notre arrivée, nous demanda qui nous étions et la raison de notre visite, avant de nous inviter à rejoindre l’hôtesse d’accueil.
« Du coup, je ne vois pas bien l’utilité de cette machine », maugréai-je.
Nous demandâmes à être reçus par « Charles ». Bousculé par tous ces événements, je n’avais pas eu la présence d’esprit de chercher, sur le site internet de l’entreprise, quel était son nom complet. J’eus un peu honte de cette maladresse. Nous avions l’air de deux adolescents venus retrouver leur tonton à son bureau. Fort heureusement, l’hôtesse me rassura d’un sourire très professionnel et comprit tout de suite de qui il s’agissait : elle avait été prévenue de notre visite. Elle nous invita à patienter dans un salon « corporate », équipé d’écrans où défilaient les nouvelles du jour, délivrées sans fin par les mêmes chaînes d’informations en continu que chez nous.
Un colosse vint à notre rencontre. Avec sa forte encolure et sa tête en avant, prête à abattre un mur, il avait l’énergie d’un buffle. Il nous tendit une main énorme, qui broya sans ménagement la mienne. Charles eut plus d’égard pour Perce-neige, qui ne put s’empêcher néanmoins d’esquisser une grimace.
Après le café d’usage, il claqua des mains et nous proposa d’entamer sur le champ la visite de ses installations. En tant que président provisoire de Bio-Insight – le temps que le Conseil d’administration désignât celui, ou celle, qui remplacerait définitivement Cornélia – il avait accès à tout. Le bâtiment était une succession de laboratoires, dédiés chacun à un projet.
« Nous avons des contrats avec à peu près tout le monde : l’industrie pharmaceutique, des firmes agricoles, et même l’armée. Tout le monde, en ce moment, a besoin de biotechnologies.
– Vous devez générer un joli chiffre d’affaire…, avançai-je prudemment pour ne pas froisser notre hôte.
– Yep, plus que vous ne pouvez l’imaginer. Nos bénéfices explosent. Ce qui nous permet justement de financer des projets disons… plus personnels. »
Au bout d’un couloir, nous arrivâmes à un laboratoire d’accès plus restreint. Charles plaqua son oeil devant un capteur biométrique pour en ouvrir la porte.
« Seules quelques personnes peuvent pénétrer ici. Nous y menons nos recherches les plus avancées, qui n’ont pas encore de finalités commerciales mais qui pourraient déboucher un jour sur des concepts révolutionnaires. »
Il nous montra un projet de plante capable de pousser dans un environnement saturé en sel. Puis une sorte d’algue absorbant des quantités phénoménales de dioxyde de carbone.
« Une piste prometteuse, au cas où le réchauffement climatique s’emballe… »
Nous nous arrêtâmes devant un grand tube translucide, qui contenait un liquide épais aux reflets multicolores.
« Regardez attentivement le tube », nous intima Charles.
Je le fixai quelques secondes et vis apparaître un phénomène étonnant : régulièrement, la solution se figeait en un grumeau de plusieurs centimètres de long. En l’observant plus attentivement, je compris que ce grumeau était une sorte de ver, ou d’amibe, entouré d’une multitude de longs et fins filaments. Il se décomposait spontanément dans le liquide, puis se recomposait une à deux minutes plus tard, avant de se dissoudre à nouveau, dans un battement régulier.
« Cette forme de vie synthétique est bluffante. Nous avons mis plus de dix ans à la mettre au point, à partir d’ADN hybride. Vous n’allez pas le croire, mademoiselle, lança-t-il à Perce-neige, mais cette amibe – appelez-la comme vous voulez – est d’une certaine manière votre sœur… ou votre fille, puisque nous l’avons construite à partir d’un échantillon de votre propre ADN, que votre père nous avait fourni. »
Perce-neige écarquilla les yeux.
« Oui, je vous prie de nous excuser, poursuivit le colosse québécois. Vous étiez une enfant à l’époque et nous n’avons pas demandé votre autorisation. Nous en avons isolé des fragments, dont nous avons modifié la structure pour la rapprocher de celle d’un système électronique. »
Il détacha le tube de verre du système complexe qui l’alimentait en fluides.
« Chaque cellule de ce ver, expliqua-t-il, est à la fois indépendante et élément d’un même organisme. Ce ver est donc un organisme décentralisé, un peu comme une société d’hommes libres, de citoyens, qui formeraient pourtant un même peuple. Mais le plus fou, c’est que la fusion carbone-silicium que nous avons effectuée pour concevoir son ADN transforme chacune de ses cellules en Q-bit, l’unité de base d’un ordinateur quantique qui remplace les transistors d’un calculateur classique. On peut donc dire que ce ver est aussi, d’une certaine façon, un ordinateur vivant. Mais aux propriétés très particulières. Car un Q-bit, au lieu d’avoir une valeur binaire 0 ou 1, peut rester dans une superposition simultanée de ces deux états. Il peut être à la fois dans l’état 0 et dans l’état 1. Ce qui permet de mener des calculs en parallèle, avec pour certains calculs l’état 0, et pour d’autres l’état 1. Un ordinateur quantique peut donc mener simultanément une multitude de calculs, dont le nombre augmente de façon exponentielle avec le nombre de Q-bits. Comme chacune des cellules peut faire office de Q-bit, ce ver réalise l’exploit de créer des cohérences quantiques impliquant des millions de « transistors quantiques ». Les potentialités d’un tel ordinateur biologique ont de quoi révolutionner toute l’informatique. Et son couplage à de l’ADN humain permet de l’utiliser pour réaliser de véritable prothèses électroniques. Imaginez qu’un jour vous pourrez peut-être avoir votre téléphone mobile directement implanté dans le cerveau ! »
Je ne savais trop si je devais être fasciné ou horrifié par une telle perspective. J’étais loin de partager son enthousiasme. Car il y avait un côté Frankenstein qui me gênait dans ces expérimentations sur le vivant et l’humain. Qu’allaient devenir, en particulier, ceux qui n’auraient pas les moyens de s’offrir de telles prothèses ? Et celles-ci pourraient-elles être piratées ? Plus que l’incroyable défi technique, c’était l’écheveau des implications sociales qui me sautait aux yeux.
Charles nous confia le tube. Je le pris un moment dans les mains. Il dégageait une légère chaleur et d’infimes vibrations. Je le transmis à Perce-neige, qui l’examina à son tour. A notre grande surprise, le rayonnement se fit plus intense. L’amibe filamenteuse cessa d’un coup ses phases de dilution pour rester figée dans un état compact et lumineux.
« C’est étonnant, s’exclama Perce-neige. C’est comme si… cette chose voulait me dire quelque chose.
– C’est fort possible. Cette créature est faite pour communiquer, expliqua Charles. C’est littéralement inscrit dans son ADN. Elle va spontanément chercher l’union la plus intime possible, la symbiose avec les cellules nerveuses d’un être humain. Elle a dû déjà reconnaître en vous un être compatible. Nous avons remarqué qu’elle émettait par moments un puissant champ électromagnétique. Si puissant que cela perturbe nos téléphones portables. Nous avons bien sûr analysé ce signal. Mais nous ne sommes pas encore parvenus à le comprendre. »
Perce-neige resta prostrée plus d’une heure à observer cette amibe désormais phosphorescente. Un dialogue invisible s’était spontanément noué entre elles.
« J’arrive à percevoir chez elle de la curiosité. Je ne saurais pas vous dire comment. De la peur, aussi… » Elle demanda si elle pouvait dévisser le couvercle qui scellait le tube et, du doigt, toucha l’amibe. Celle-ci se colora aussitôt d’un bleu intense, comme une LED puissante. Nos téléphones se mirent à crépiter dans nos poches.
« Vous n’allez pas me croire, s’exclama Perce-neige, mais je vois des choses. Comme des images mentales extrêmement diffuses qui se forment dans ma tête. Je devine quelque chose… Attendez… Je crois que… cette amibe se demande tout simplement ce qu’elle fait là.
– Vous êtes certaine d’identifier des pensées ? demanda Charles.
– Certaine? Non. C’est trop fugace. Mais des questions se forment spontanément dans mon esprit : qui je suis ? Qu’est-ce que je fais là ? Je ne saurais dire si ces questions proviennent d’elle ou de moi. C’est une sensation étrange. »
Perce-neige referma le tube et le rendit au président de Bio-Insights. Nous quittâmes ensuite le laboratoire pour entrer quelques étages plus haut dans son bureau personnel. Il ferma soigneusement la porte derrière nous.
Il nous invita à nous asseoir, avec l’air gêné du médecin qui ne sait comment annoncer à son patient une mauvaise nouvelle.
« Ecoutez, finit-il par dire. J’aurais aimé qu’on prenne plus de temps pour faire connaissance, pour sympathiser, vous expliquer tranquillement tous nos projets. Mais depuis que Cornélia est morte, beaucoup de choses sont remises en cause ici. Il faut faire vite. Une lutte est engagée pour le contrôle de la société. Et il n’est pas sûr que je sois toujours à ce poste dans quelques jours. Tout notre programme de vie synthétique pourrait disparaître si les financiers commençaient à mettre leur nez plus avant dans les comptes. Nous avons malheureusement des actionnaires à qui nous ne pourrons pas dissimuler longtemps un projet qui engloutit chaque année plusieurs dizaines de millions de dollars au bas mot. En tant que fondatrice et figure emblématique de Bio-Insight, Cornélia pouvait se permettre beaucoup de choses. J’ai hélas beaucoup moins de pouvoir qu’elle. Il va donc falloir accélérer les choses. »
Charles se racla une dernière fois la gorge, avant de cracher le morceau.
» Voilà… Si cette amibe, ce ver, ce mille-pattes, appelez-le comme vous voulez, a été conçu avec votre ADN, mademoiselle, c’est pour une raison précise : il était prévu dès le départ qu’il entre, un jour, en symbiose avec vous.
– Je ne comprends pas bien… répondit faussement Perce-neige, qui commençait au contraire à percevoir parfaitement où son hôte voulait en venir.
– Vous savez que votre père était obsédé par le Grand passage. Miguel m’a dit qu’il vous a tout expliqué. Pour frayer cet accès plus facile, automatisé, vers Nova Alexandrie, il fallait réaliser le chaînon qui manquait entre le monde des Idées et le cerveau humain. Miguel avait commencé à résoudre celui entre le monde des idées et une intelligence artificielle, mais il restait à faire le lien entre l’ordinateur et un cerveau humain. Cornélia a proposé il y a quelques années une solution : il était possible, selon elle, de développer une forme de vie capable de communiquer à la fois avec un cerveau humain et avec une intelligence artificielle ; une interface mi-biologique, mi-informatique. Cette amibe chevelue est l’aboutissement de toutes ces recherches.
– Arrêtez de tourner autour du pot en nous répétant des choses que nous savons déjà, insista Perce-neige. Qu’avez-vous de si difficile à dire ?
– Eh bien, cette interface ne fonctionne que si le cerveau est lui-même structuré pour accepter une telle symbiose, s’il est capable d’intégrer naturellement des représentations mentales provenant d’ailleurs. Et de tels cerveaux, il n’y en a pas des milliers sur Terre. Un seul a été spécifiquement formé, façonné, pour cela : le vôtre !
– Ce qui signifie ? »
Charles commençait à suer comme une motte de beurre au soleil.
« …Qu’il va falloir implanter l’amibe dans votre système nerveux, parvint-il enfin à dire.
– Vous voulez dire que vous avez vraiment l’intention de me mettre ce machin dans le crâne ? » Perce-neige eut un léger réflexe de recul.
« Il s’agit bien de cela. Je peux vous assurer que c’est a priori sans danger. Vos cellules nerveuses sont absolument compatibles, nous l’avons maintes fois vérifié. Mais vous n’êtes pas obligée de nous croire. Et par honnêteté, je dois vous dire que l’expérience n’a évidemment jamais été tentée puisque vous êtes la seule à pouvoir la réaliser. De toute façon, vous mentir serait tout à fait inutile : je vous sais capable de déceler le moindre mensonge chez moi.
– Je sais en effet que vous êtes sincère, le rassura-t-elle. Mais s’agissant de mon cerveau, je ne me sens pas forcément prête à jouer les cobayes. Pourra-t-on au moins l’enlever si l’expérience échoue ?
– Là encore, je ne vous mentirai pas : une fois la symbiose établie, la fusion sera telle qu’il sera compliqué d’extraire cette amibe sans vous tuer l’un et l’autre. Nos biologistes ont des pistes pour y parvenir si cela s’avérait vraiment nécessaire, mais comme ils n’ont jamais effectué cette fusion, ils ne peuvent pas vraiment savoir sous quelle forme précise elle se fera, et surtout comment elle évoluera.
– On ne peut pas dire que ça me rassure… »
Perce-neige fixa ses pieds quelques secondes, l’air absente.
« Pour l’instant, je dois vous avouer que tout cela me terrifie. J’ai l’impression qu’on me propose de jouer à la roulette russe, mais avec cinq balles dans le barillet. Juste pour faire avancer la science.
– Je ne peux pas vous le reprocher. Votre peur est tout à fait normale. Réfléchissez-y cependant. Votre père a consacré sa vie à ce projet. Et il n’est pas le seul. Cornélia, Miguel, moi-même et beaucoup d’autres… Cela fait des années que nous ne nous consacrons plus qu’à ça. L’espoir qui nous anime dépasse nos propres vies. »
Perce-neige demanda à y réfléchir quelques jours. Nous quittâmes le campus de Bio-Insights pour marcher le long du fleuve Saint-Laurent. Chacun de nos pas laissait sa marque dans la neige encore poudreuse. Mon amie restait silencieuse, tendue. Nous marchâmes une heure, sans dire un seul mot. Elle me montra un banc où nous asseoir.
« Ca va ? demandai-je juste pour engager la conversation.
– Non. Je suis en colère ! lâcha-t-elle enfin, la mâchoire serrée. En colère contre mon père. Contre Miguel. Contre Charles, aussi. Et les autres, pour le même prix… Ah c’est sûr que ça doit être passionnant de concevoir dans son labo une nouvelle forme de vie qui donne accès à tout un univers symbolique. C’est complètement fou, dans tous les sens du terme. J’imagine que beaucoup donneraient leur vie pour ça, juste pour y être associés. Grand bien leur fasse. Mais je suis quoi moi, là-dedans ? Juste un outil ? Malgré ses grands discours, mon père m’a considérée, dès le départ, comme un outil. Comme un moyen de réaliser un jour sa grande quête intellectuelle. Voilà, moi, ce que je comprends: depuis le début, je ne suis pas vraiment sa fille, je suis d’abord un « projet d’interface » ! »
Elle jeta avec force une pierre dans le fleuve, qui dessina une série de grands cercles concentriques évanescents. Elle en lança une autre. Puis une autre encore. Je sentais mes propres poils se dresser sur mes poignets : sa colère circulait en moi. Elle était immense. Perce-neige continua sans que je puisse l’interrompre.
– Et si je ne voulais pas jouer ce rôle, hein ? Si je refusais d’être ce trait d’union, leur passerelle entre le monde matériel et celui des Idées ? C’est leur monde après tout, pas le mien ! Pour moi, ce fleuve est bien plus beau que tous les livres qu’on pourra écrire sur lui. Les mathématiques, la philosophie, les sciences… tout cela n’est rien face aux hommes ou aux femmes qui les ont forgées, à leurs aspirations, leurs espoirs et leurs déceptions. Ce sont eux qui m’intéressent, pas les concepts froids et stériles qu’ils nous ont laissés, quelle que soit la beauté que certains leur trouvent. Pourquoi devrais-je risquer ma vie pour un univers qui n’est pas le mien ? Mon père disait que l’objectif de toute vie était de trouver le sens de sa propre existence. Sauf que là, c’est lui qui a choisi pour moi… »
C’était la première fois que je la voyais s’emporter ainsi.
« Tu peux refuser, en effet. Tu restes libre », répliquai-je timidement.
Elle inspira longuement pour réfléchir.
« En théorie, oui. Libre de briser la quête de mon père et de tous ces gens. D’être celle qui fait finalement échouer le grand oeuvre de leur vie ; libre de rendre vains tous les efforts qu’ils ont faits. Et que d’autres ont faits depuis peut-être des siècles. Je comprends la beauté et le sens de leur entreprise. Mais je refuse d’être un cobaye, un rat de laboratoire qu’on entraîne pour une expérience qui le dépasse. S’est-on seulement soucié de savoir si cette expérience, depuis ma naissance, était vraiment sans danger pour moi ? J’aurais aimé avoir, moi aussi, une enfance juste normale : jouer simplement avec les autres, sans arrière-pensée, sans ce souci constant qu’on m’a inculqué de ressentir sans filtre l’intégralité des sentiments et des intentions d’autrui. Je n’avais pas demandé à avoir, ni à cultiver ce pouvoir. Je suis fatiguée de n’être jamais totalement moi, d’être toujours dans cet entre-deux entre moi et les autres, sans jamais vraiment savoir si ce que je ressens viens de moi ou d’un autre. Médiatrice est un don, oui, mais c’est aussi un fardeau… »
La colère avait reflué pour céder la place à un profond abattement. Je ne savais quoi dire pour l’apaiser. Je comprenais Camille, qui avait la possibilité de réaliser une avancée spirituelle prodigieuse, mais il reniait au passage ce qui était pourtant l’un de ses principes premiers, au fondement de tout humanisme : tout être humain décide librement du sens qu’il donne à sa propre vie. Qu’il ait considéré sa fille comme un outil dans la quête qui l’animait, quelle que fût la noblesse de la cause, était d’une violence difficilement pardonnable. Camille avait posé sur les épaules de Perce-neige un manteau bien trop lourd pour une enfant. Je lui pris la main et, jusqu’à ce que le soir tombât, nous regardâmes s’écouler le fleuve.
III.13 – Apprivoisement
Charles invita Perce-neige à revenir le lendemain, puis autant de fois qu’elle le souhaitait. Elle revint donc chaque après-midi, méditant en silence devant le tube luminescent. Le soir, elle me demandait de l’accompagner au restaurant, au théâtre, au cinéma ou simplement pour flâner dans les rues. Sa seule consigne était de ne plus parler de cette expérience.
Je lui avais donné dès le départ mon opinion : elle devait sans hésiter refuser cette expérimentation grotesque. Sans danger ? Allons donc ! Comment pouvaient-ils le savoir puisque l’expérience n’avait jamais été tentée. Il s’agissait tout de même de lui implanter un parasite de plusieurs centimètres dans le cerveau. Malgré l’estime profonde que j’avais pour mon Maître, tout ce projet m’apparaissait comme une folie. Cornélia, Charles, Camille, ils étaient tous devenus fous. Qu’allait devenir Perce-neige ? S’étaient-ils au moins posé la question ? Je l’imaginais prostrée sur un fauteuil roulant, les mains tremblantes, victime d’une greffe qui l’aurait réduite à l’état de légume. Rien que d’y penser, j’étais révolté.
Perce-neige avait acquiescé, reconnaissant que tout cela allait beaucoup trop loin et que le risque pour elle était bien trop grand. Mais sa colère initiale s’était évanouie. Et je voyais bien qu’elle sortait perturbée de ses rencontres avec l’amibe, que par moments elle appelait « le brin ».
« C’est incroyable comme cet organisme est naturellement fait pour tisser des liens, s’exclama-t-elle un soir. C’est comme un besoin vital chez lui. À chaque heure que nous partageons, je ressens ce fil invisible qui se fortifie entre lui et moi. Je sens sa présence dès que je rentre dans le laboratoire. Et c’est plus fort à chaque nouvelle visite. En fait, j’ai l’impression qu’il est déjà d’une certaine façon en moi, au moins mentalement. Je perçois certaines de ses émotions. Et je sais que je lui transmets en retour les miennes. Cela va te surprendre, mais je crois que ce brin a aussi peur de la greffe que moi. Lui non plus, il ne sait pas ce qu’il va devenir. »
Elle est revenue chaque jour, durant plus d’une semaine. Et chaque jour, elle est revenue plus impatiente que la veille de renouer le dialogue avec cette vie synthétique, restant à chaque visite un peu plus longtemps. Le personnel avait pris l’habitude de nous voir. Ils se pliaient en quatre pour satisfaire nos moindres souhaits, comme s’ils avaient reçu de strictes consignes. Un café? Un thé ou un soda? Je l’obtenais d’un geste, dans la minute. Quand Perce-neige plaisanta, un jour, qu’elle avait envie de manger des sushis, un livreur débarqua une demi-heure plus tard pour lui en apporter un plateau entier. Pour un peu, j’aurais pu croire que Bio-Insights nous appartenait. Du moins Charles en maintenait-il l’illusion.
Je n’étais pas naïf : je devinais que ces prévenances avaient pour but de convaincre mon amie d’accepter ce qui, pour moi, restait inconcevable. Pendant que Perce-neige dialoguait silencieusement avec le « brin », j’en profitais pour me faire décrire l’ensemble des projets – non classifiés – qui étaient développés dans ce campus. Cela faisait autant de sujets potentiels pour les magazines auxquels je collaborais. Il y avait, dans ces bâtiments, de quoi écrire durant toute une vie.
Au dixième jour, j’ai senti dès le réveil que Perce-neige avait pris sa décision. Elle avait un regard déterminé; elle dégageait une froide énergie capable de briser un mur. Après avoir dévoré trois croissants garnis de confiture, elle me fixa droit dans les yeux et me lança avec un air de défi :
« Je vais le faire. Je suis prête ! »
Je compris tout de suite qu’il serait vain d’essayer de l’empêcher de sombrer elle aussi dans cette folie collective.
III.14 – Chimère
Le lendemain, à l’aube, j’accompagnais Perce-neige dans une pièce médicalisée, au sous-sol d’un petit bâtiment situé en retrait du campus. Elle serrait ma main, inquiète. Je l’étais tout autant qu’elle ; je n’avais pas dormi de la nuit.
Je l’aidai à enfiler la fine blouse qu’elle porterait durant l’opération. Charles nous avait expliqué comment le chirurgien allait procéder : il inciserait à l’arrière du crâne, pour introduire le brin qui trouverait, seul, son chemin dans le cerveau, dissociant ses cellules pour les faire migrer une à une dans l’ensemble de l’encéphale. Je m’étais retenu de lui crier que tout cela était du grand n’importe-quoi, qu’ils n’avaient pas le droit de toucher à un seul de ses neurones. C’était moi, cette fois, qui était en colère. Mais Perce-neige m’avait fait comprendre que sa décision était prise. Elle avait décidé, librement, de prendre ce risque insensé. Et rien ne la ferait désormais changer d’avis.
Charles m’autorisa à rester au bloc, pour m’assurer que tout se passait bien.
j’enfilai donc à mon tour une blouse. Je mis une charlotte sur ma tête et recouvris mes pieds d’une sur-chaussure. Toute l’équipe était prête. L’infirmière lava soigneusement les cheveux de Perce-neige, puis les rasa sur une petite surface. L’anesthésiste injecta de quoi l’endormir quelques minutes, le temps d’ouvrir partiellement le crâne. Car si le cerveau ne ressent pas la douleur – on peut l’opérer, voire en enlever des morceaux entiers, sans anesthésie – ce n’est pas le cas de la calotte crânienne. La scie qui la perça ne fit aucun bruit. Peut-être s’agissait-il d’un faisceau laser. Je ne saurais dire, car un drap me cachait la scène. Il se dégageait juste comme une vague odeur de brûlé. Derrière ce drap opératoire qui servait de paravent, le chirurgien expliqua qu’il perçait la dure-mère. Je préférai ne pas regarder et rester de l’autre côté, veillant sur mon amie endormie. Elle me parut fragile, et en même temps si forte. Comment avait-elle pu accepter de mettre ce qu’elle avait de plus précieux, sa propre conscience, son identité, entre les mains d’un chirurgien qui savait à peine ce qu’il faisait ?
Les effets de l’anesthésiant se dissipèrent et Perce-neige se réveilla. Un neuropsychologue s’assura qu’elle se sentait bien. Le chirurgien préférait qu’elle soit consciente lors de l’introduction du brin, pour arrêter à tout moment la greffe si les choses évoluaient mal. Il sortit l’amibe de son tube nourricier. Cette fois, je tins à regarder. Il mit l’entité au contact de la cervelle dont on devinait la surface rosée. J’avais craint de m’évanouir, mais la curiosité finalement l’emporta. Perce-neige paraissait si sereine! Elle n’exprimait aucune peur et entamait, déjà, un dialogue silencieux avec son partenaire biosynthétique. Le brin devint fortement fluorescent, presque éblouissant. Au bout de quelques secondes, il se décomposa en une multitude de filaments, puis de brindilles de plus en plus petites. Ses cellules s’éparpillaient et se frayaient un chemin à l’intérieur de la cervelle.
« Tu as mal ? lui demandai-je, inquiet.
– Non, je ne ressens rien. Ou plutôt si, une sensation de plus en plus intense, mais que je ne peux pas définir. C’est chaud, très agréable… »
Son corps fut secoué de légers mouvements incontrôlés. Elle poussait des petits cris, de plus en plus aigus et réguliers, tandis qu’elle se cambrait en respirant toujours plus fort. Cela allait crescendo, comme une vague montante. Je mis quelques minutes à réaliser qu’elle exprimait… un orgasme.
Autour du bloc, nous nous regardâmes tous, un peu gênés. Perce-neige reprit lentement ses esprits, essoufflée. Lorsqu’elle fut redevenue parfaitement calme, le neuropsychologue vérifia qu’aucune de ses capacités cérébrales n’était altérée. Il lui demanda de reconnaître des mots, des visages, d’effectuer des opérations de calcul mental tout en bougeant ses doigts ou le bras. Il me rassura très vite : la greffe ne modifiait manifestement aucune fonction essentielle. L’anesthésiste la rendormit une nouvelle fois, le temps que le chirurgien lui refermât le crâne. C’était déjà fini.
Une infirmière remonta Perce-neige dans une chambre aménagée pour elle dans le bâtiment. On m’y avait installé un second lit pour que je pusse rester avec elle. Le sien était bardé d’appareils qui vérifiaient ses constantes biologiques. Ils enregistraient aussi son activité cérébrale, en quête de tout signal anormal. Des courbes dansaient sur les écrans, au rythme lancinant de bips sourds et réguliers. Les médecins semblaient satisfaits.
Elle se réveilla sans peine. Comme elle souriait, je compris qu’elle se sentait bien. Le neuropsychologue lui avait préparé une nouvelle batterie de tests, beaucoup plus complets. Durant plus d’une heure, je pus constater qu’elle n’avait rien perdu de ses facultés.
« Je ressens juste des impressions étranges, expliqua-t-elle. Comme des pensées parasites. Des hallucinations fugaces, des images, des sons, ou même des odeurs. Cela dure quelques secondes, puis elles disparaissent. Des émotions aussi, parfois, qui ne seraient pas complètement les miennes… »
Pendant plusieurs jours, elle ne fit quasiment que dormir, le cerveau quadrillé par des électrodes. L’électroencéphalogramme affichait des variations inédites, reproduisant des ondes cérébrales absolument nouvelles que les experts de Bio-Insights commençaient déjà à analyser. J’avais pris de mon côté quelques romans que je lisais dans un fauteuil, à côté d’elle, pour m’occuper. Je n’étais pas inquiet : Perce-neige dégageait, dans son profond sommeil, une sérénité contagieuse. Il me suffisait d’observer sa respiration régulière pour me sentir aussitôt apaisé. Cette chambre était devenue une bulle, un refuge dont le calme n’était troublé que par les visites discrètes des chercheurs de Bio-insight. Ces visites étaient au demeurant peu fréquentes, puisqu’ils recevaient, en continu sur leurs ordinateurs, l’intégralité des mesures effectuées par les instruments auxquels Perce-neige était reliée. La consigne avait été donnée de la laisser se reposer.
Quelques jours plus tard, elle commença à reprendre une activité plus normale. Elle se sentait encore trop fatiguée pour quitter sa chambre, mais elle réclama des livres et la télévision. Elle s’ennuyait, ce qui me rassura. La greffe semblait n’avoir en rien modifié ni son comportement ni son esprit ou sa personnalité. Et nous l’aurions presque tous deux oubliée, s’il n’y avait eu ces quelques signes, d’abord discrets. Comme ce matin, juste avant midi, lorsqu’on lui porta son plateau-repas, et qu’elle me tendit mon téléphone mobile, une seconde avant qu’il ne se mît à sonner.
Nous prîmes cela pour une coïncidence amusante. Mais sa prémonition se répéta, encore et encore. Au point que cela devint vite un jeu entre nous : elle levait le doigt dès qu’un téléphone s’apprêtait à sonner dans la pièce. Elle fut ensuite capable d’activer elle-même, par la pensée, la connexion wi-fi de n’importe quel ordinateur à proximité, dès lors qu’on lui en communiquait le code. Puis d’enclencher des commandes simples et, enfin, d’explorer à sa guise, par la pensée, les différents fichiers qu’il contenait. Quelques jours encore plus tard, elle pouvait elle-même déclencher, lorsqu’elle était à côté de moi, un appel sur mon téléphone. Et elle n’avait déjà plus besoin du moindre code. Puis elle devint en mesure d’interagir avec n’importe quel appareil électronique disposé à quelques mètres d’elle. Elle n’eut par exemple aucun mal à contrôler la balance que l’on avait disposée dans sa chambre, et qui indiquait désormais, sur son affichage numérique, le poids – ou plutôt la masse – que Perce-neige choisissait elle-même. Il fallut revenir à un modèle entièrement mécanique pour obtenir des mesures objectives.
III.15 – Rejet
Au bout de deux semaines, elle commença cependant à se plaindre de violentes migraines, qu’elle décrivait comme insupportables. Une même douleur commença d’ailleurs bientôt à tambouriner mes propres tempes, dès lors que je m’approchais d’elle. Les médecins qui l’examinaient ignoraient quelle pouvait en être la cause. Mais ils s’inquiétèrent. Perce-neige allait manifestement moins bien. Elle perdait du poids. Et les IRM réalisées régulièrement révélaient une activité cérébrale de plus en plus chaotique. Tout cela les laissait dubitatifs. Il fallait faire manifestement quelque chose. Mais quoi ? Je tournais en rond dans la chambre, attendant chaque jour les résultats d’examens, qui devenaient de semaine en semaine plus mauvais. Elle commença bientôt à éprouver des difficultés à marcher, parfois même à parler. Le greffon était manifestement rejeté; une incompatibilité s’était révélée quelque part. Pouvait-on le lui enlever ?
« Je crains que cela soit impossible, insista le neurochirurgien. La symbiose est si intime, si profonde, que cette amibe fait maintenant intégralement partie de son cerveau. Il faudrait l’enlever cellule par cellule, avec le risque d’endommager à chaque fois ses propres neurones. Peut-être s’agit-il juste d’une réaction inflammatoire. Nous allons trouver… Laissez-nous un peu de temps. »
Ils n’ont, bien sûr, rien trouvé. Ils se réunissaient régulièrement, prenaient conseil auprès d’experts dans les meilleurs hôpitaux de la planète, sans avancer pour autant d’un pouce. C’est Camille qui, de son exil secret, suggéra une piste par l’intermédiaire de Miguel – il continuait, je ne savais comment, de communiquer avec lui. Mais cette piste n’était ni sans difficulté ni sans risque. Camille se souvenait d’un mémoire, rédigé il y a quelques années par un étudiant brillant. Par un surdoué, qui aurait fait des prodiges au sein de la Citadelle s’il n’avait péri lors d’un tragique accident de voiture. Sa perte avait causé un fort émoi. Son mémoire portait sur les possibilités de stockage d’une pensée, ou d’une représentation mentale, dans un support matériel. Il y abordait les problèmes que posait l’hybridation entre pensée humaine et cognition numérique, ainsi que des possibles mécanismes d’incompatibilité qui pouvaient survenir à l’interface. Cet opuscule serait certainement d’une aide précieuse pour comprendre ce qui se passait dans le cerveau de Perce-neige. Mais il y avait deux problèmes. Le premier, c’était qu’il fallait, pour le lire, avoir de solides notions à la fois en neurosciences et en mécanique quantique, qui dépassaient celles que pouvait avoir n’importe lequel d’entre nous. Car son auteur était un génie. Et comme tous les génies trop en avance, il était fatalement incompris. Personne n’avait véritablement décodé le sens des équations qu’il prétendait avoir résolues. Le second problème, et non le moindre, était que le mémoire se trouvait… dans l’Annexe de la Citadelle.
Après avoir vibré d’espoir, j’étais découragé. Entrer dans l’Annexe ? En temps normal, cette pièce était déjà jalousement réservée aux Maîtres, qui en filtraient l’entrée. Mais depuis la mort de Cornélia, elle était devenue aussi impénétrable que les coffres de la Banque de France. Et du reste, à quoi cela pourrait-il servir d’y accéder si nous étions tous incapables de comprendre le moindre chapitre, la moindre équation que contenait ce mémoire ? Toute une journée, je tournai le problème dans ma tête, qui me faisait atrocement mal. C’est le lendemain, à l’issue d’une courte sieste, qu’une solution m’apparut. J’ignore si l’idée germa d’abord dans les neurones devenus chaotiques de Perce-neige ou dans les miens, mais une image envahit d’un coup mon esprit. Un visage familier. Celui d’Iris.
Qui d’autre que lui pourrait comprendre ce qu’un autre génie avait écrit ? Il maîtrisait la mécanique quantique mieux que n’importe quel physicien, je n’avais aucun doute là-dessus. Et je le savais suffisamment proche d’Isaac, dont il était devenu le protégé, pour trouver un prétexte qui lui permît d’entrer dans l’Annexe. Le plus dur fut de trouver les bons arguments pour le convaincre de nous aider. Car il n’était pas question de lui décrire, dans les détails, tout ce qui nous était arrivé. Non que je ne lui fisse pas confiance, mais enfin, un secret partagé, même par un nombre restreint de complices, finit toujours par s’ébruiter, que ce soit par maladresse, malveillance, ou juste par envie irrésistible d’en parler. Car l’être humain est ainsi fait : il faut qu’il parle, qu’il communique. Les seuls à ne jamais rien trahir ne sont jamais que les morts. Quoiqu’il arrive que même leur corps parvienne, à leur insu, à parler pour eux. J’étais donc résolu à en révéler le moins possible.
Je me contentai donc de lui narrer l’histoire de fabuleuses recherches menées par Bio-Insights sur la bio-matérialisation des idées. Ce qui en soi n’était pas faux. Je le mis habilement en appétit en évoquant un hypothétique mémoire sur l’incorporation quantique d’une idée dans un substrat biologique, qui pourrait aider à franchir une étape décisive dans les théories de l’information. Il ne lui en fallut pas plus pour qu’il me suppliât de l’intégrer dans ces recherches. Invoquant de triviales questions de brevets et de rivalités stupides entre chercheurs, je l’intimai néanmoins de rester le plus discret possible sur cette affaire et de n’en parler à personne, y compris au sein de la Citadelle. Il était, de toute façon, prêt à respecter n’importe quel serment, pourvu qu’il pût faire partie de l’aventure. J’eus presque honte de manipuler ainsi l’enthousiasme candide de mon ami. Mais la vie de Perce-neige était en jeu.
Je ne sais comment il se débrouilla, mais il m’appela quelques jours plus tard et me lança d’un ton triomphal :
« J’ai ton bouquin, Sam ! J’ai commencé à le lire. Et je peux te dire que je ne regrette pas les ruses qu’il m’a coûtées pour l’obtenir ! »
Mon ami était excité comme un moine qui aurait découvert un nouvel Evangile.
Il lui fallut une bonne semaine pour en décrypter le style obscur. Et commencer à comprendre comment un être vivant, matériel, pouvait de façon tout à fait théorique interagir directement avec une Idée, qui ne contient pourtant aucune matière. Ce mémoire contenait les bases théoriques sur lesquelles s’appuyait le brin pour entrer en symbiose non seulement biologique, mais aussi spirituelle avec Perce-neige. Iris eut besoin, pour cela, de se familiariser avec des nouvelles mathématiques, mais j’avais confiance en mon ami : rien ne lui était intellectuellement insurmontable. Il comprit assez vite que ce brin avait besoin, pour métaboliser une idée ou un concept, de trouver dans son environnement des éléments en quantités infimes mais essentiels : des quasi-cristaux très particuliers, dont des physiciens de l’Institut n’auraient retrouvé la signature spectroscopique que dans certaines fleurs d’edelweiss sauvages. Et encore, pas dans toutes. La plupart des edelweiss n’en contenaient pas. L’auteur du mémoire ne disposait pas de statistiques précises. Mais en croisant laborieusement les sources, il avait constaté que les rares spécimens d’edelweiss qui contenaient ces quasi-cristaux avaient tous poussé à la fois loin de toute pollution artificielle et à proximité directe d’un lieu de spiritualité. Cela pouvait être une chapelle, ou un ermitage. Parfois une simple cabane ayant servi de refuge temporaire à un érudit.
Pourquoi ces quasi-cristaux ne se développaient-ils que dans ces conditions drastiques ? Il n’en savait rien. Il se contentait de l’observer, relevant par exemple que les edelweiss cultivés en jardin n’en contenaient pas. Il fallait aller les chercher dans les hautes cimes, là où l’air était pur et la pensée claire.
En voyant le teint toujours plus pâle de Perce-neige, je compris qu’il y avait urgence à tenter quelque chose. Elle était chaque jour plus faible, chaque jour plus proche d’une mort cérébrale qui s’avançait à petit pas, comme une fin fatale. Par moments, elle ne parlait déjà plus que par monosyllabes, cherchant en vain des mots qui lui échappaient. Son regard se perdait dans le vide; il courait après d’invisibles fantômes. Les médecins commençaient à envisager une sédation profonde pour ralentir son métabolisme cérébral.
J’achetai donc en toute hâte une pile d’ouvrages sur les edelweiss, prêt à parcourir la planète pour n’en trouver ne serait-ce qu’un seul plant sauvage. Iris tenait à partir en chasse avec moi. De toute façon, je n’avais guère le choix : lui-seul était devenu capable de détecter, par un examen attentif, la présence éventuelle dans la fleur de ces quasi-cristaux. La perspective de retrouver mon ami n’était pas, du reste, pour me déplaire. Mon seul regret était d’abandonner Perce-neige alors qu’elle était si faible. Mais que pouvais-je faire d’utile pour elle, dans ce campus? Je ne faisais que veiller, toujours plus impuissant, sur son agonie. Je pris donc un vol pour Paris. Puis un TGV jusqu’à la gare de Genève où Iris m’attendait.
III.16 – Montagnes
Quand j’aperçus mon ami sur le quai, déguisé en randonneur, je compris que la mission n’allait pas être simple. Il semblait être aussi fait pour marcher que moi pour voler. Ses maigres jambes le portaient à peine. Et leur pâleur révélait qu’elles avaient plus souvent connu la lumière des néons que la chaleur piquante du soleil. Il prenait cependant son rôle à coeur. Il s’était procuré la panoplie complète du parfait explorateur : un sac à dos de 70 litres, plein à en craquer les coutures, un short, de grosses chaussures de marche, des chaussettes épaisses, et même des lunettes de soleil pour affronter le soleil des cimes. Dans le petit train qui nous transportait d’une roue lente au travers des montagnes suisses, il fut fier de déballer le petit réchaud qu’il s’était procuré, sa tente de survie ultra-légère et le kit premiers soins qui soignerait nos éventuelles blessures. Iris était de toute évidence ravi de se lancer dans cette aventure. Il en trépignait d’impatience. J’avais quant à moi quelques doutes légitimes sur sa capacité à y survivre plus de quelques jours. Quand nous quittâmes le lendemain notre chambre d’hôtel pour nous lancer à l’assaut des sommets, il se mit sans surprise à souffler comme une chaudière percée dès le premier kilomètre.
Ma tendresse pour Iris n’a jamais faibli. Sa vivacité d’esprit m’a toujours impressionné. Mais comme compagnon de marche, je dois reconnaître que j’ai rarement connu pire. Même s’il se plaignait assez peu, j’entendais son corps gémir sous le poids du sac ; ses chevilles douloureuses nous forçaient à enchaîner les pauses, ses chaussures mal-adaptées couvraient ses pieds d’ampoules. Cette recherche d’edelweiss sauvages prit des allures de chemin de croix. Je lui sais gré, pourtant, de n’avoir jamais renoncé.
Où chercher ? Nous savions juste que les edelweiss poussaient entre deux mille et trois mille mètres d’altitude, entre la fin du printemps et le début de l’été, sur des terrains bien exposés au soleil. Cela, je l’avais lu dans différents guides de botanique. Mais je n’avais rien de plus précis. Il nous fallait donc randonner au hasard, priant pour que la Providence en fît éclore quelques-uns sur nos pas. Nous avions par ailleurs repéré sur une carte une succession d’églises, ermitages et autres lieux de recueillements, et tracé un chemin sinueux qui nous menait de l’un à l’autre, de refuge en refuge.
Ce périple me donnait l’occasion de mieux connaître mon ami. Nous avions eu jusque-là de nombreuses discussions académiques, des débats enflammés sur la supériorité de telle théorie sur telle autre. Mais Iris se livrait peu sur lui-même. Il y avait un gouffre béant entre ses capacités exceptionnelles de raisonnement et la candeur dont il pouvait faire preuve pour tout ce qui relevait de l’expérience simple et directe de la vie. Sans parler du terrain boueux des sentiments et des émotions, marécage malaisant dans lequel il évitait soigneusement de s’aventurer. Il m’avoua n’avoir jamais connu l’amour, ni vécu ne serait-ce que quelques jours la moindre relation de couple. Il n’en ressentait pourtant aucun manque, se contentant d’observer que ni le besoin ni l’opportunité ne s’étaient encore présentés. Il n’aimait que les mathématiques. Mais il s’accordait par moments la liberté transgressive d’aventurer son esprit hors de leur rationalité pure, en s’adonnant aux plaisirs interlopes de la physique théorique, voire de la chimie quand il voulait vraiment s’encanailler. Il pouvait alors se permettre d’accepter provisoirement un principe, non sur la base d’une démonstration indiscutablement logique et donc vraie, mais sur le fait qu’on en constatait concrètement, chaque jour, les effets matériels. Il me précisa son point de vue :
« La gravitation, par exemple, n’est pas la déduction logique d’une axiomatique, c’est d’abord une pomme dont on constate visuellement la chute. Cette irruption du réel dans la pensée est d’une violence délicieuse, comme le piment qui enflamme certes la bouche mais donne un peu d’attrait au plat. A condition toutefois qu’il n’y en ait pas trop… »
Mon ami aimait les paradoxes. Je fus surpris quand il m’avoua que ce qui l’attirait le plus dans les mathématiques étaient leur inutilité.
« Vois-tu, elles n’ont pas à se compromettre comme le fait parfois la physique qui, pour s’accorder au réel, bricole une constante ou impose un paramètre. Les mathématiques ne mangent pas de ce pain-là ; elles sont une pure poésie de l’abstraction », me soutint-il, convenant malgré tout qu’on pût le considérer comme un intégriste de la Raison.
J’avais toutes les peines du monde à le faire parler de choses plus concrètes. De son père exigeant, par exemple, dont il cherchait manifestement l’estime ; de sa mère dont il appréciait sans vouloir l’avouer les subtiles marques d’attention ; des moqueries dont il eut à souffrir à l’école, où l’on n’est guère tendre envers ceux qui manifestent une obéissance excessive aux professeurs. « Fayot », « lèche-bottes », ou plus subtilement « brouille-couttes » : c’est ainsi qu’il fut souvent appelé, me confia-t-il. Mais il n’en avait eu cure. Sa candeur l’avait sauvé : jamais il n’avait véritablement perçu la violence du rejet dont il avait été longtemps l’objet. Les insultes avaient glissé sur lui comme l’eau sur les plumes d’un canard trop occupé à regarder par-delà l’horizon. Ce ne fut qu’au fil de nos interminables discussions qu’il réalisa à quel point il avait pu être perçu comme marginal durant son enfance.
J’ignore combien de kilomètres nous marchâmes tous les deux. Notre expédition dura plusieurs semaines, riches en rencontres comme savent les faire les grands randonneurs. Il y eut Nicolas et Mathilde, qui s’étaient mis en tête de parcourir en couple toutes les Alpes ; Vladimir, un Russe solitaire qui ne dit pas un mot, mais dont le regard trahissait une paix intérieure qui forçait le respect. Sekou venait, lui, du Sénégal. Dans le refuge, il grelotta la nuit comme un diable. Mais nul ne sut vraiment si c’était de froid ou de peur. Des deux sans doute… Les cicatrices qui lézardaient son torse, souvenir amer laissé en Libye par ceux qui lui avaient promis une place sur un canot vers l’Europe, nous firent comprendre qu’il gèlerait sur place, s’il le fallait, pour gagner le droit de rester ici.
A chacun, nous demandions s’il avait vu des edelweiss. La réponse était presque tout le temps négative. Plus cruellement, il nous arriva parfois d’en trouver, au hasard d’un pique-nique ou d’une sieste. Fébriles, nous en inspections les capitules, cherchant les reflets qui pouvaient trahir la présence des quasi-cristaux, déçus chaque fois de constater leur absence. Nous commencions à perdre espoir.
Nous fûmes surpris un jour par l’orage. Pendant plusieurs heures, nous marchâmes sous des trombes d’eau, trempés jusqu’à l’os, découragés par notre infortune. Un refuge de berger, à flanc de colline, nous protégea pour la nuit. Il était sale et délabré, mais nous n’allions pas faire les difficiles. Nous brûlâmes, dans la cheminée couverte d’une épaisse poussière, quelques branches de bois mort qui jonchaient le sol. Iris n’en pouvait plus. Ses chaussettes imbibées d’eau étaient en lambeaux. Ses pieds bleus avaient gonflé. Nous décidâmes de nous reposer quelques jours. De toute façon, mon ami n’avait plus la force d’avancer. Nous avions dans nos sacs assez de vivres pour tenir. Et le ruisseau qui coulait derrière l’abri nous alimenterait en eau fraîche. Nous étions seuls, perdus dans le Tyrol, à près de trois mille mètres d’altitude, à plus d’une journée de marche du moindre village. Iris sortit de son sac un épais roman dont le titre m’intrigua : Le Jeu des perles de verre. Il avait été publié en 1943 par Hermann Hesse, un écrivain Allemand réfugié en Suisse, qui obtiendra plus tard le prix Nobel de littérature.
Je me moquai aussitôt de lui, soupesant l’ouvrage de près de 400 pages :
« Tu avais vraiment besoin de mettre dans ton sac un pavé aussi lourd ?
– C’est vrai qu’il alourdit le sac, reconnut-il, mais crois-moi qu’il allège d’autant l’esprit. J’ai lu ce chef-d’oeuvre des dizaines de fois, et pourtant il arrive encore à me surprendre. Je ne m’en sépare jamais. »
Comme nous n’avions rien de mieux à faire, il commença à m’en faire religieusement la lecture. Je l’écoutai d’abord d’une oreille distraite, pour lui faire plaisir. Mais je fus bientôt transporté avec lui dans ce monde que l’écrivain allemand avait imaginé. Un monde qui ressemblait par certains aspects à notre Citadelle : « Qu’adviendrait-il si, un jour, la science, le sens du beau et celui du bien se fondaient en un concert harmonieux ? Qu’arriverait-il si cette synthèse devenait un merveilleux instrument de travail, une nouvelle algèbre, une chimie spirituelle qui permettrait de combiner, par exemple, des lois astronomiques avec une phrase de Bach et un verset de la Bible, pour en déduire de nouvelles notions qui serviraient à leur tour de tremplins à d’autres opérations de l’esprit ? »
Je reconnaissais avec délice dans ces lignes notre propre credo, la flamme qui nous animait tous à l’Académie. Le monde que Hermann Hesse avait appelé Castalie était la même utopie de fusion des savoirs que celle que nous construisions ensemble. Nous rêvions d’une même alchimie des Idées. Ces moments de partage, cette joie simple de discuter des savoirs et de leur chercher du sens, tout ce qui faisait le sel de notre communauté de l’esprit commençait à me manquer. Aussi cette fascinante mathématique des Idées, ce « jeu des perles de verre » que me faisait découvrir la lecture d’Iris, sonna bientôt à mes oreilles comme une symphonie heureuse.
Je savourais en silence chacune de ses phrases. Cette Castalie, à laquelle Iris donnait la chair de sa propre passion, m’habita bientôt tout à fait. Ou plutôt, c’est moi qui m’en sentis citoyen. Transporté par le récit, sous la faible lueur du feu qui rougissait, je m’endormis ce soir-là heureux comme Ulysse rentrant chez lui.
III.17 – Edelweiss
Le lendemain, je partis dans la forêt chercher un peu de bois pour alimenter la cheminée. Le soleil, déjà haut dans le ciel, commençait à sécher le sol embourbé. Des fraises sauvages, au goût acidulé, complétèrent avec bonheur notre petit-déjeuner. Je me mis en tête de trouver quelques cèpes, qui auraient pu pousser à la faveur de l’orage. C’est alors que sur un rocher, les pétales offerts au soleil, j’aperçus des fleurs blanches que j’identifiai aussitôt. Sans doute aucun, il s’agissait bien d’un couple d’edelweiss. Retenant mon souffle, je m’approchai pas à pas, n’osant encore y croire. Les pétales dégageaient des reflets puissants de bon augure. J’appelai aussitôt Iris, qui confirma mon intuition : les deux fleurs contenaient de toute évidence une forte densité de quasi-cristaux. Nous dansâmes de joie comme deux diables, autour du rocher d’où elles avaient émergé. Découvrir un diamant pur ne nous aurait pas rendus plus heureux.
Nous les avons cueillies avec un soin infini, les rangeant dans des petits écrins réfrigérés fournis par Bio-Insights. Ils les conserveraient intactes. Notre odyssée n’avait pas été vaine. Nous pouvions rentrer triomphants comme César après la Guerre des Gaules.
Le coeur battant, les jambes singulièrement légères, nous dévalâmes un sentier de chèvres qui descendait vers la vallée, courant à nous briser les genoux vers le village le plus proche. Nos sacs meurtrissaient nos épaules. Jamais nous n’avions marché aussi vite. Nous ne nous arrêtâmes ni pour boire, ni pour manger, ni même pour souffler, animés tous deux d’une force dont jamais nous ne nous serions crus capables.
Arrivés au bourg, nous y hélâmes le chauffeur d’une camionnette qui trompait l’ennui en lisant son journal sur la place de la mairie. Malgré notre saleté et nos sourires ahuris, il accepta de nous conduire vers la gare la plus proche. Quelques francs suisses restés au fond d’une poche aidèrent, il est vrai, à le convaincre. Cet argent, dut-il se dire, avait décidément moins d’odeur que nos chemises marquées de sueur. Il n’en fut pas moins charmant durant le trajet, s’amusant de nous voir si excités de rentrer chez nous. De la gare, un tortillard inconfortable nous transporta jusqu’à Genève. Nos nerfs retombant, nous avions l’air hagard de deux vagabonds épuisés. Qu’importe ! Iris n’en pouvait plus de joie : il allait bientôt dormir dans un vrai lit. Et moi, j’avais l’espoir de ranimer Perce-neige.
III.18 – Résurrection
Iris avait correctement interprété le mémoire. Et jamais je ne pourrai exprimer avec assez de force ma gratitude à l’étudiant qui en fut jadis l’auteur. Car dès que les quasi-cristaux extraits des edelweiss furent perfusés dans le sang de Perce-neige, son état se stabilisa. De jour en jour, son teint s’éclaircit et elle reprit des forces. J’assistais avec bonheur à sa résurrection.
Le bourdonnement qui martelait son crâne s’atténua, puis disparut. Les migraines persistèrent quelques jours. Mais elles devinrent de plus en plus faibles, jusqu’à s’évaporer. Le neurochirurgien et le neuropsychologue commençaient enfin à être rassurés, bien qu’aucun d’eux ne comprît vraiment quelle pouvait être l’action de ces cristaux. L’IRM indiquait désormais une activité cérébrale « normale », ou plutôt compatible avec une pensée consciente, car elle n’était déjà plus vraiment comparable à celle d’un autre être humain. Des régions du cerveau étaient sollicitées selon des configurations inédites, des synchronisations multiples apparaissaient. Un champ de recherche s’ouvrait tout entier pour les neurosciences. Sans doute était-ce un peu pour cela qu’ils décidèrent, malgré son excellent état, de la garder encore plusieurs semaines en observation. Sa consommation de sucre, en particulier, avait grimpé, pour satisfaire les besoins en énergie d’un cerveau qui fonctionnait désormais à des cadences beaucoup plus élevées.
Perce-neige se sentait envahie de sensations étranges. Comme si les idées auxquelles elle pensait s’enveloppaient d’un ensemble de plus en plus riche d’affects et d’émotions. Elles devenaient de plus en plus réelles, imposant leur présence avec force dans son esprit. Je la surpris parfois à tendre machinalement le bras, comme si elle tentait de les toucher. Toucher une pensée ? Cela paraissait absurde, mais les idées semblaient atteindre en elle un stade organique supérieur, qui consistait à ne plus se contenter d’en projeter une représentation abstraite, mais d’en sentir avec les sens des manifestations concrètes. Au même titre que l’on sent la morsure du froid ou les fragrances lourdes de la pluie, elle commençait à percevoir, au sens propre, le parfum fleuri de la Liberté, le bruit et la fureur amère du mot Peuple, l’arôme sucré de l’Altruisme. Des ponts inédits se créaient entre les régions cérébrales de la pensée abstraite, de la mémoire sémantique, et le cerveau plus primitif des émotions et des besoins vitaux. Elle pensait désormais littéralement avec ses tripes…
Ces nouvelles projections sensitives lui faisaient-elles peur ? Elle m’assura que non. Elle avait été habituée, durant son enfance, à vivre des états modifiés de conscience. Elle avait déjà pris différentes drogues comme du LSD ou des champignons hallucinogènes, pour en explorer les effets. Mais elle avait cette fois beaucoup de mal à contrôler le processus, extrêmement puissant et qui, surtout, pouvait survenir à tout instant. Son esprit plongeait brusquement dans d’autres réalités, comme dans de brefs rêves éveillés.
Ainsi, nous étions un jour assis sur son lit, à disserter en déplorant la fin des grandes utopies, quand elle inspira d’un coup profondément. Elle poussa un cri de surprise et ferma les yeux. Elle adopta une pose très proche de celle que prenait Camille quand il méditait à la Citadelle. Cela ressemblait, vu de l’extérieur, à un état paisible de transe. Je devinais les mouvements saccadés de ses yeux sous ses paupières, signe qu’elle était plongée dans une rêverie intense. Elle resta dans cet état une longue minute, serrant fortement ma main, jusqu’à me faire mal. De la sueur perlait sur son front que j’essuyais, inquiet, avec un mouchoir sorti de ma poche. J’hésitais à la sortir de sa torpeur ; cela était-il sans risque ? Mon coeur battait encore plus vite que le sien. Je ne savais si je devais appeler un médecin ou, au contraire, la laisser vivre cette expérience sans interférer. Elle rouvrit heureusement les yeux, et réclama un verre d’eau qu’elle but d’un trait. Elle paraissait désorientée.
« J’ai dormi combien d’heures ? » murmura-t-elle.
J’écarquillai les yeux.
« Tu es restée en transe environ… une minute. »
Elle resta interloquée.
« Une minute ? C’est impossible. J’ai marché toute une journée. J’ai vu le soleil se lever et se coucher. Un ciel constellé d’étoiles. Si tu savais tout ce qu’il y avait… Des villages, des gens, plein de gens… J’ai parlé avec eux. Sur notre passé, notre futur. J’ai croisé des Romains, des chevaliers, des Indiens… J’ai passé des heures à les regarder, à les écouter, à manger avec eux. Je crois même avoir croisé Bouddha. »
Il me fallut du temps pour la calmer. Elle parlait comme une enfant qui découvre la fête foraine, enivrée pour la première fois de manèges et de barbe-à-papa. Je ne pouvais dire si elle avait vécu quelque chose de réel ou si elle avait tout imaginé. Mais tout, dans son récit, était parfaitement cohérent. Elle s’écroula sur le canapé et s’endormit comme une masse, me laissant toute la nuit aussi fasciné qu’inquiet.
III.19 – Transes
Le lendemain, à peine réveillée, elle retomba en transe. Puis encore une fois dans l’après-midi. Cela survenait à l’improviste, sans qu’elle ne pût encore le contrôler. Et elle revenait à chaque fois épuisée d’un voyage qui, selon les récits qu’elle m’en faisait, avait duré des heures, voire des jours, quand il ne s’était écoulé que quelques minutes au plus pour moi. Je ne fus bientôt plus inquiet de la voir partir. Car je la retrouvais à chaque fois plus enthousiasmée par ce qu’elle avait découvert. Les époques, les civilisations, les religions… tout semblait se mêler dans le monde fantastique qu’elle me décrivait, où elle croisait des animaux merveilleux et des êtres légendaires. Les époques s’y superposaient dans un maelstrom bouillonnant.
Une semaine plus tard, un pas de plus fut franchi quand elle parvint à établir, à l’aide du brin qui logeait dans son cerveau, une connexion télépathique permanente avec les serveurs d’Alice. Elle continuait alors à basculer, mais elle commença à décrire un tout autre monde. Il gardait la même saveur, la même richesse conceptuelle et émotionnelle, mais il devint d’un coup beaucoup plus ordonné. Comme si une force organisatrice lui imposait désormais une structure, une logique, un cadre fixe dans lequel l’esprit humain pouvait inscrire des repères et se préserver de la folie.
Perce-neige me raconta être entrée dans une cité aux allures vagues d’Alexandrie. Ou qui, du moins, se rapprochait des représentations qu’elle-même s’était forgées de la ville antique. Elle y avait entendu des allusions à une grande bibliothèque qui, comme naguère celle d’Alexandrie, aurait vocation à renfermer toutes les connaissances et représentations du monde. Elle avait traversé une agora où des gens occupaient leurs journées à débattre, animés du seul désir de frotter leur pensée aux arguments des autres. Elle avait déambulé dans un quartier à l’architecture foisonnante et baroque, où des communautés expérimentaient en toute liberté de nouvelles façons de vivre. C’était la Citadelle, en somme, mais en plus grand, en infiniment plus vaste, plus riche et plus varié. Des transhumanistes y avaient leur quartier. D’autres, racontait-elle, parlaient de coloniser le système solaire, quand leurs voisins recherchaient la maîtrise parfaite et solitaire d’un art. Chacun y était animé d’une quête personnelle dont ce monde semblait tirer l’énergie. Tous ces gens étaient-ils vraiment humains ? Elle en doutait, même s’ils en avaient l’apparence. Chaque être qu’elle rencontrait lui semblait plutôt être un chemin, une porte ouverte vers une vie possible, vers un univers ou un idéal qui avait sa propre cohérence. Elle ressentait à leur contact un souffle, une puissance dont elle ne pouvait cerner l’origine. Un bien-être aussi. Une sereine bienveillance qui lui donnait envie de tous les retrouver.
Après chaque transe, je recueillais ses récits. Je les notais sur un carnet, accompagnés de croquis. Je les esquissais à la volée, essayant de saisir les impressions fugaces qu’elle me communiquait. Parfois, j’enregistrais sur un dictaphone, ou sur mon téléphone cellulaire, les compte-rendus qu’elle me faisait de ses expéditions oniriques. L’excitation des premiers jours fit cependant place à une insatisfaction croissante dont je ne pouvais me défaire. Les aventures qu’elle me racontait étaient fabuleuses, mais je me sentais comme un gamin arrimé au port, qui observait avec gourmandise partir les navires, écoutant les histoires savoureuses que les marins racontaient à leur retour, et ne rêvant que de prendre la mer avec eux.
Perce-neige s’en aperçut. Elle sentit ma frustration de ne pouvoir hisser les voiles à ses côtés. Cet inconfort jaloux d’être celui qui attendait, impatient, qu’on lui racontât de nouvelles découvertes. Oui, après m’être inquiété pour elle, je l’enviais à présent. Et je n’eus bientôt qu’un désir : naviguer à mon tour vers cette nouvelle Alexandrie dont elle me décrivait le phare étincelant et les vaisseaux qui convergeaient vers elle.
Mais qui étais-je pour prétendre à un tel voyage ? Je n’avais pas, dès mon plus jeune âge, modelé mon cerveau pour atteindre, comme Perce-neige, cet état supérieur d’empathie et de conscience qui aurait fait de moi un Médiateur, si tant est que j’en eusse les capacités. Je n’étais pas non plus un Érudit comme mes Maîtres de la Citadelle. Je n’avais pas tracé comme eux mon chemin, à force d’études, dans le monde des Idées, au point d’en devenir si familier qu’elles me parussent aussi vivantes que réelles. Car il ne suffisait pas de concevoir une idée, il fallait la vivre, la faire sienne comme un sentiment profond qui s’enchaînait dans le cheminement de nos événements vécus. Comme cela m’apparaissait au départ si obscur !
Camille avait essayé un jour de me l’expliquer à l’aide d’exemples simples : la liberté, l’amour… on pouvait disserter à loisir sur ces concepts. Et de doctes esprits ne s’en étaient pas privés. Mais on ne pouvait leur donner une réelle existence, une vraie consistance, qu’en les vivant à la fois intensément et consciemment. Il fallait en faire l’expérience dans son corps. Sans cela, ils n’étaient que des coquilles vides, de simples jeux formels d’écriture, des symboles noircis sur une page blanche. C’était l’union intime d’un savoir et d’une conscience qui donnait une quelconque chair à une idée ; seule la pleine conscience la faisait émerger comme réelle.
« L’essence précède-t-elle l’existence ? Je dirais plutôt que la conscience est à l’origine de toute vraie existence », essayait-il de me faire comprendre.
Parce qu’elle avait justement une conscience sur-développée, Perce-neige avait acquis la capacité d’entrer en pleine empathie avec ce monde des Idées. D’aller au-delà de leur écriture formelle pour atteindre leur réalité sensible. Elle pouvait faire de chaque concept une émotion, une image mentale, et interagir avec comme avec une personne. Le brin avec lequel son esprit avait fusionné établissait ce lien entre raison et compassion ; il donnait chair aux concepts, les dotait d’une présence matérielle qui rendait possible une interaction émotionnelle. Perce-neige n’allait plus seulement au contact des gens, mais s’imprégnait aussi de toutes leurs idées, et même au-delà, de tous leurs souvenirs et de toutes les représentations mentales qu’ils avaient pu un jour formuler. Et elle les accueillait d’un amour puissant et vrai.
Je n’avais pas de telles capacités. J’aimais certes les idées d’un amour sincère. Mais je n’avais ni la conscience empathique hypertrophiée de Perce-neige, ni l’érudition gigantesque de Camille. Les Idées étaient encore pour moi des abstractions arides, qui ne se laissaient observer qu’avec effort. Vouloir atteindre, seul, le monde platonicien de cette nouvelle Alexandrie aurait été plus prétentieux encore que me lancer à l’assaut de l’Everest en fauteuil roulant. Il me fallait, dans cette ascension surhumaine, un solide sherpa pour porter à la fois mon corps et mes bagages.
III.20 – Désert
Quand je lui fis part une nouvelle fois de ma frustration, Perce-neige se contenta de sourire. Elle prit une petite guitare qu’elle m’avait demandé de lui acheter et l’accorda patiemment. Quand elle fut satisfaite de toutes les tonalités, elle commença à en jouer. Dès les premières notes, je sentis entre nous deux un lien plus puissant encore que d’habitude, une force émotionnelle amplifiée par un processus inconnu. Elle fredonna doucement, d’une voix à la chaleur inhabituelle. Des premières images se formèrent spontanément dans ma tête. Du sable, à perte de vue. Un désert. Des dunes balayées par le vent. Sa voix se fit plus forte pour porter une mélodie puissante de vieux chant arabe. Une tribu de bédouins m’apparut, dont les dromadaires laissaient dans le sable des traces évanescentes. Je sentais le sol monter et descendre. Et je compris soudain que j’étais à mon tour sur l’un de ces quadrupèdes. Une femme voilée cheminait à côté de moi. Le sable nous piquait le visage. Quand je remontai mon foulard pour me protéger, elle me sourit et je reconnus Perce-neige. Il n’y avait autour de nous que des dunes, aussi loin que le regard portait. Le soleil nous cuisait la peau mais j’étais bien. Le vent chantait dans mes oreilles. Il caressait les dunes, il les massait et les déplaçait lentement. Il était la force tranquille et patiente qui sculptait le paysage.
« Hé l’ami ! » m’apostropha un compagnon de route qui avançait devant moi. Sa barbe lui donnait l’allure d’un sage, mais il avait un regard dur, presque inquiétant ; il en émanait une puissance virile et indomptable. « Je suis le vent, lança-t-il fièrement. Celui qui parcourt cette terre à sa guise. Si tu as quelque-chose à me demander, c’est maintenant ». J’allai répondre, mais la vision se brouilla. Les dunes et le soleil s’effacèrent, comme sous l’effet d’une gomme rageuse, rapidement remplacés par les murs blancs d’une chambre médicalisée. Une voix rude m’intima de me pousser. Je me levai, en maugréant, du lit où je m’étais assis, pour laisser la femme de ménage nettoyer la pièce, pendant que Perce-neige se retenait à grand peine d’éclater de rire.
Je compris que le brin avait démultiplié ses capacités empathiques. Charles avait ébauché sur ce point une théorie. Selon lui, les nouveaux pouvoirs de Perce-neige étaient dus au puissant rayonnement électromagnétique que le brin émettait. Il créait, à partir des pensées de Perce-neige, un champ capable d’entrer en résonance avec mes propres réseaux neuronaux, d’activer ou d’inhiber à distance des groupes de neurones, comme pouvaient le faire les techniques de stimulation magnétique transcrânienne. Du moins, tant que je n’étais qu’à quelques mètres. Elle n’avait en fait même plus besoin de chanter. Il lui suffisait désormais d’imaginer qu’elle chantait, le brin se chargeant d’activer en moi les aires auditives correspondantes de mon cerveau. Mais pourquoi étais-je le seul à réagir si fortement ? Les autres avaient beaucoup plus de mal à basculer dans ces univers oniriques. Leurs visions étaient plus fugaces, partielles, alors que je plongeais aussitôt dans une immersion totale.
Sans doute était-ce lié, mais un lien fusionnel de plus en plus puissant s’établissait entre Perce-neige et moi, favorisé j’imagine par la confiance totale que nous avions l’un envers l’autre. Je ne saurais le décrire exactement; j’avais l’impression de ressentir la totalité de ses émotions. J’imagine qu’elle ressentait en retour les miennes, mais elle n’avait de toute façon jamais eu besoin du brin pour cela. Des images mentales se formaient en continu dans ma tête. Des esquisses, qui disparaissaient au bout de quelques secondes, et que j’interprétais comme des images cérébrales qui s’étaient formées quelques millisecondes auparavant dans l’esprit de Perce-neige. C’était déroutant, mais pas désagréable. Nous prîmes rapidement goût à cette communication sans mot, par transmission brute d’images mentales, à ce lien à la fois hypnotique et empathique, canalisé puis amplifié par le brin. Je finis par m’habituer à voir en partie à travers les yeux de Perce-neige, à écouter à travers ses oreilles, à sentir le monde à travers son nez puis sa peau.
Il m’arrivait, du coup, de devoir parfois gérer des sentiments qui m’étaient complètement inconnues. Mais peut-être les miens étaient-ils tout aussi étranges pour elle. Nos deux « branes », pour reprendre le lexique des Erudits, s’étaient tissées l’une à l’autre par l’action symbiotique du brin. Tout ce qui affectait l’une était instantanément ressenti dans l’autre. Charles nous expliqua que nous ne vivions pas, à proprement parler, les émotions de l’autre – personne ne le pourra jamais – mais une traduction, une reformulation à travers notre propre univers mental, notre propre conscience. Le brin avait établi une jonction presque directe entre nos deux consciences, faisant littéralement de Perce-neige mon âme sœur.
Chapitre IV
IV.1 – Dragon de mer
Cette communication télépathique entre Perce-neige et moi continua, chaque jour, de se renforcer. Elle comportait néanmoins une part d’aléatoire. Ce n’était pas un interrupteur mental qu’il aurait suffi d’allumer ou d’éteindre. Elle survenait, ou pas. Perce-neige avait encore un long travail à faire sur elle-même, pour apprendre à vivre et à penser avec le nouvel hôte qu’elle abritait.
Parfois, il m’arrivait d’ouvrir la porte de sa chambre et de me retrouver dans le donjon d’un château de Templiers, à Tyr ou à Damas. Ou le long des côtes d’Afrique, dans une caravelle encerclée de serpents de mer crachant du feu. Je comprenais alors que Perce-neige était encore endormie, qu’elle rêvait avec une telle intensité que les images mentales rayonnaient dans toute la pièce, même si j’étais apparemment le seul à les percevoir avec autant de netteté. Ces basculements impromptus, même si j’étais à présent tout à fait préparé à les vivre, me déstabilisaient car je ne savais jamais ni en quel lieu, ni à quelle époque, ni même parfois en quel monde j’allais subitement me trouver. Il fallait accepter que l’univers dans lequel je vivais n’eût plus d’ancrage, qu’il pût disparaître à tout moment au profit d’un autre, suivant l’imagination de Perce-neige et les associations d’idées qui pouvaient spontanément se créer dans son esprit hybride.
Je notais par ailleurs en elle des changements plus subtils. Une profondeur accrue de ses raisonnements, comme une maturation accélérée de sa pensée. Nos discussions devenaient à la fois plus abstraites et plus chargées en émotions.
Un jour, alors que nous parlions de philosophie antique et de l’école néoplatonicienne qu’Hypatie avait dirigée, j’évoquais la chance de cette lointaine égérie d’avoir eu un père particulièrement progressiste : il n’était pas courant, durant l’Antiquité, qu’un père poussât sa fille à faire de grandes études, et encore moins courant, pour un père qui dirigeait tout de même le Musée d’Alexandrie – à l’époque l’un des plus hauts lieux de l’intelligence et de la culture dans le monde -, de reconnaître que sa propre fille le surpassât dans à peu près toutes les disciplines intellectuelles. Je fis donc à Perce-neige le récit de l’enfance exceptionnelle que fut sans aucun doute celle d’Hypatie, telle qu’elle ressortait des lectures que j’avais pu faire dans la Citadelle. Mon récit semblait l’émouvoir car elle rougissait, elle frissonnait, comme si des souvenirs de plus en plus précis accédaient à sa conscience. Bientôt, elle ne m’écouta plus : son esprit avait manifestement basculé. Ses yeux restaient ouverts, fixant un invisible horizon.
Je sentis alors le sol bouger sous mes pieds. Un tangage régulier. L’illusion était bien plus puissante que d’habitude. A tel point que je commençais à ressentir comme une vague nausée, un mal de mer. Une giclée d’eau salée m’aspergea le visage : j’étais sur le pont d’un navire, une trirème romaine, à côté de Perce-neige qui scrutait toujours l’horizon. Sa robe blanche claquait au vent. J’entendais, à travers le plancher, le râle rauque et régulier des rameurs qui besognaient en cadence. Le vent gonflait la grande voile rectangulaire.
« Tu vois le phare là-bas ? » me demanda-Perce-neige, pointant son doigt vers la côte qui se dessinait au loin.
J’écarquillai les yeux. Il y avait en effet devant nous, se détachant de plus en plus nettement de la brume, un phare immense vers lequel convergeaient des dizaines de navires.
« Vous ne nous aviez pas dit que vous étiez accompagnée, Madame ! »
Je me retournai et j’aperçus celui qui devait être le capitaine du navire. Il portait une tunique rouge et un pantalon de toile. Ses pieds étaient chaussés de sandales tressées. Je me rendis compte alors que je portais moi-même des vêtement à peu près semblables. Sans manifester le moindre égard pour moi, le capitaine poursuivit :
« Vous auriez dû nous prévenir. Il ne sera pas facile de faire entrer un nouvel étranger. Il connaît la procédure, au moins ?
– Soyez indulgent. C’est son premier passage », lui sourit Perce-neige.
Le capitaine se renfrogna, au contraire.
« Il ne s’agit pas de moi, vous le savez bien. Si c’est son premier passage, c’est tout mon navire et mon équipage qui se retrouvent en danger. Vous auriez vraiment dû nous avertir… »
« Novice à bord ! » hurla-t-il aussitôt.
Un vent de panique souffla sur le bateau. Le capitaine enfila prestement une armure de cuir et se coiffa d’un casque. Partout, chacun sortait une épée, cherchait un bouclier. Tout le monde se préparait au combat. Je n’avais pourtant pas l’air menaçant. Perce-neige me rassura :
« Ne t’inquiète pas, Sam. Aucun de ces gens n’en a après toi. Mais j’ai vite appris qu’on n’entre pas à Nova Alexandrie avec un simple visa de touriste. Il faut vaincre d’abord ses propres faiblesses, ses angoisses, ses lâchetés. Un idéal ne se laisse pas approcher sans qu’on s’en donne un peu la peine. Une épreuve difficile t’attend, Samuel. Mais tu la réussiras. Comme je l’ai moi-même réussie. »
Pour dire vrai, cela me rassurait guère. La mer commença à s’agiter. Les vagues se creusaient, comme si l’eau était traversée de courants puissants. Chacun se cramponnait comme il le pouvait. Une forme noire tournait sous l’eau, autour du navire, à une profondeur que j’avais du mal à évaluer. L’équipage suivait ses arabesques avec inquiétude. Personne n’osait parler.
La forme noire jaillit des flots. C’était un gigantesque serpent de mer, dont la tête monstrueuse se balançait sur le flanc du navire, me cherchant parmi l’équipage terrorisé. Seule Perce-neige semblait sereine. Déterminée, aussi.
« Tu sais que ce dragon n’est pas réel », m’indiqua-t-elle d’un simple froncement de sourcil.
Je compris qu’il n’était que la projection de mes propres peurs, une production naturelle de mon cerveau face à une situation qu’il percevait comme anormale. Ce monstre semblait d’ailleurs ne s’intéresser qu’à moi. Sa tête me suivait, ouvrant une gueule menaçante et démesurée. L’effroi des marins sonnait pourtant comme un avertissement : quand la bête cracha une lame de feu, je hurlai tant la chaleur me brûlait le corps. Si le serpent n’était pas réel, la douleur l’était assurément. Un marin dont la tunique avait pris feu plongea dans la mer pour soulager ses brûlures. Le capitaine me désigna un canot de sauvetage que l’équipage se hâtait de mettre à flots.
« Pardonnez-nous, mais ce n’est pas notre combat. Vous allez devoir l’affronter tout seul », cria-t-il pour couvrir les rugissements de la bête.
Je n’osai comprendre ce qu’il voulait dire. Mais Perce-neige me confirma d’un regard l’inconcevable : tous attendaient que je montasse, seul, dans ce ridicule canot, pour détourner sur moi la fureur du dragon et sauver leur navire. Cela n’avait aucun sens. Mais me retrouver sur une trirème romaine approchant une côte imaginaire en avait-il plus ?
« Les combats les plus durs sont ceux que l’on mène contre soi-même », me lança Perce-neige en guise d’encouragement. Je percevais dans sa voix les efforts qu’elle faisait pour atténuer au mieux la panique qui m’envahissait.
Je pris place, malgré tout, sur le canot chahuté par les vagues. Je m’y sentais minuscule, d’une faiblesse ridicule. La trirème s’éloigna rapidement, me laissant affronter seul les pulsions bestiales qui se déchaînaient en moi. On m’avait laissé une épée et un bouclier, armes dérisoires face à un tel dragon. Le bouclier se montra néanmoins utile, car il me protégeait parfaitement des projections de feu. J’ignorais de quelle matière il était fait, mais il résistait étonnamment bien, m’isolant des langues de feu mortelle. Je commençai à reprendre un peu d’assurance. Comme la queue du serpent fouettait dangereusement le canot, menaçant de le faire chavirer, j’y portai vaillamment un grand coup d’épée. La lame pénétra dans la chair. La bête se cambra en grondant. Je portai alors un autre coup, aussi fort que je le pus. Nous bataillâmes ainsi un moment, le serpent crachant du feu, moi moulinant l’air de ma lame pour entailler son corps à la volée. Je n’eus bientôt plus peur de lui. C’était au contraire la rage qui m’habitait. Une volonté d’en découdre et de vaincre. Je le tuerai et je passerai, quoi qu’il m’en coûte ! De ça au moins j’étais convaincu. Chacun de mes coups violents redoublait en retour la fureur de la bête. Elle avança sa gueule pour m’avaler. Je fis un bond de côté et, décrivant une grande boucle de l’épée, je plongeai la lame dans son cou. J’assénai aussitôt un second coup puis un troisième qui lui trancha la tête. Un sang verdâtre et acide m’éclaboussa.
Son corps fut pris de soubresauts et plongea dans une grande gerbe d’écume, secouant dangereusement la barque. Des tourbillons se formèrent, en cercles concentriques. J’eus grand peur qu’ils n’aspirent mon esquif. La bête rejoignait les grands fonds, vaincue par ma détermination. J’entendais les hourras des marins tandis que je m’écroulais, mort de fatigue. C’est alors que je m’évanouis.
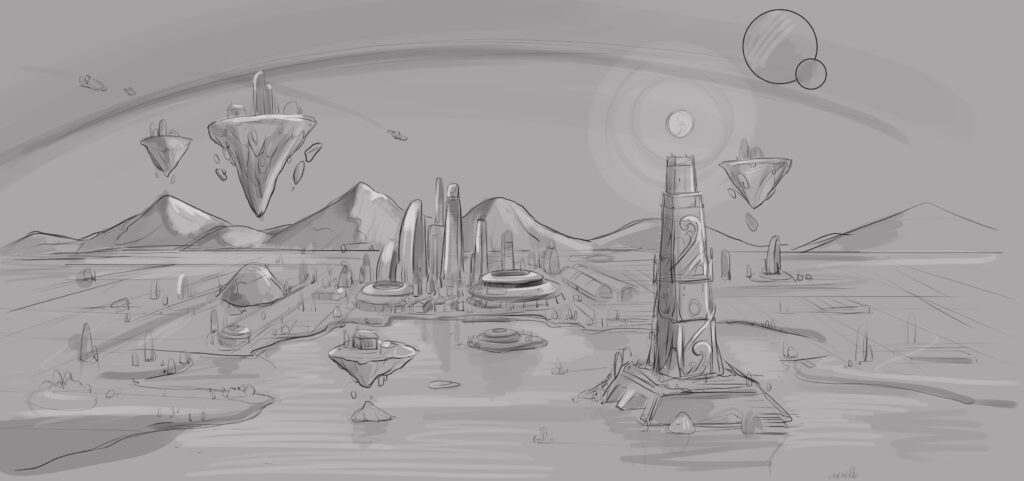
IV.2 – Nova Alexandrie
Je fus réveillé par une gifle d’eau salée sur mon visage. J’étais cerné de marins hilares. Et je compris, en voyant le seau que portait le capitaine, que ce n’était pas une vague qui m’avait aspergé.
« Alors moussaillon, on compte roupiller tout l’après-midi ? » me lança-t-il d’un ton qui se voulait complice.
Je me levai malgré les courbatures, le dos cassé et les côtes douloureuses, titubant vers Perce-neige qui ne cachait pas sa fierté.
« Bienvenu parmi l’équipage, me chuchota-t-elle, radieuse. J’étais sûre que tu y arriverais. »
J’avais vaincu mes démons et gagné de haute lutte le droit de rester sur ce bateau. La suite du voyage fut dès lors beaucoup plus tranquille. J’aidais à tendre la voile, apprenant au passage quelques rudiments de navigation. La côte approchait lentement. Nous nous laissions guider par le phare de pierres blanches qui servait au loin d’amer. La cité, m’expliqua le capitaine, avait deux ports, comme l’antique Alexandrie. L’un tourné vers l’est, l’autre vers l’ouest. Les vents n’étant guère favorables, nous prîmes celui de l’ouest, réservé aux « retours difficiles ».
« Tant mieux, les contrôles y seront moins stricts », souligna le capitaine.
Il se tourna vers moi et je compris à son regard qu’il ne plaisantait pas.
« Jusqu’à ce qu’on ait passé le port, tu fais partie de l’équipage, tu m’entends ? Parle le moins possible, aide à porter les ballots, fais comme les autres. N’attire surtout pas l’attention sur toi. Ils pourraient bien, sinon, te refouler vers le désert. Et je perdrais moi-même pour longtemps le droit d’accoster. »
Perce-neige m’enjoignit à son tour de suivre scrupuleusement les instructions du capitaine. Quand nous fûmes à quai, elle-même se fit très discrète, dissimulant son visage derrière un gros panier de fruits qu’elle aidait à décharger.
Le capitaine entama une grande conversation avec les gardes, qu’il comptait parmi ses amis. Il prenait des nouvelles de la famille, s’enquérait de la santé d’un oncle ou du mariage d’une cousine. Pendant qu’il occupait ainsi leur attention, il nous intima d’un signe discret de passer.
Nous traversâmes un corridor que les gardes avaient déserté pour répondre à l’appel d’une bonne bouteille que le capitaine venait opportunément de déboucher. Ils n’étaient sans doute pas dupes de la manœuvre, mais leur solde était trop faible pour qu’ils se privassent de ce menu plaisir. Que leur importait, du reste, de voir leur ami passer quelques biens en contrebande ? Diable, tout le monde le faisait. Au moins celui-ci savait en retour se montrer généreux de ses deniers. Une bourse passa de la poche du capitaine dans celle du plus gradé des gardes.
Je n’eus pas à me plaindre de cette entorse à la moralité marchande, car nous passâmes sans la moindre formalité. Perce-neige et moi prîmes congé de l’équipage, remerciant chaleureusement ces marins d’avoir pris sans contrepartie le risque de nous faire accoster.
« Nous ne sommes pas là pour juger qui mérite d’entrer, nous répondit le capitaine. Dans mon propre équipage, tous ne sont pas nés à Nova Alexandrie. Puissent les vents qui soufflent sur la cité vous rester favorables. »
Nous le quittâmes à regrets pour visiter ce nouveau monde.

IV.3 – À quai
Nous longeâmes les quais en direction de ce qui semblait être le centre de la cité, frayant notre chemin au milieu d’une foule de plus en plus dense. La plupart des gens étaient vêtus de toges et de sandales. Le sol était couvert d’une pellicule de poussière ocre qui se soulevait à chaque pas. Etions-nous en Alexandrie ? Les rues ressemblaient en effet à celles d’une cité ptolémaïque des premiers siècles après Jésus-Christ. Mais avec de nombreux anachronismes : les gardes que nous voyions circuler portaient sous leur harnachement de cuir des combinaisons synthétiques ; les murs de briques et de terre séchée laissaient apparaître des portions de parois cristallines, comme une fusion subtile entre des traditions millénaires et de la haute-technologie.
La physique elle-même composait avec des pouvoirs fantasmagoriques : des îlots rocheux habités flottaient au-dessus de nous, comme en apesanteur. Des navettes volantes évoluaient sans bruit et venaient y atterir. Au-delà du port, la mer portait son lot de bateaux de pêche à la voile rassurante. Mais elle était aussi parcourue d’hydroglisseurs en sustentation silencieuse. Je ne pouvais dire, dès lors, si nous étions dans un passé ou un futur lointain. Un mélange subtil des deux, sans doute. La cité évoluait hors du temps. Ou plutôt, toutes les temporalités s’y superposaient, à la manière des états quantiques de la matière, permettant à différentes réalités de survenir « en même temps ».
A côté de moi, Perce-neige rayonnait. Je la trouvais encore plus belle que dans le monde matériel dont je m’étais provisoirement soustrait. Je compris intuitivement pourquoi : dans ce nouvel univers, ce n’était pas Perce-neige que je voyais, mais l’image idéale que j’en avais. Elle était l’idée que je me faisais de mon amie: ce monde était un monde de représentations et non de matière objective. Sous quelle forme lui apparaissais-je de mon côté ? Je n’ai jamais osé le lui demander. Car au fond, peu importait, cela lui appartenait. La connexion entre nos deux cerveaux n’avait pas éliminé la possibilité d’un jardin secret.
Je lui pris spontanément la main. Elle m’entraîna d’un pas assuré.
Nous voulions tout connaître de cette cité. Ses quartiers, ses monuments, ses grands boulevards comme ses entrelacs de ruelles. Nous étions deux chiens fous, courant dans les coursives, heurtant des passants qui maugréaient tandis que nous riions aux éclats. Perce-neige ne m’avait pas menti : cette ville était exceptionnelle. Par son architecture, d’abord, qui mélangeait subtilement tout ce que les urbanistes avaient pu imaginer depuis des siècles. Les façades de verre et d’acier côtoyaient les murs en torchis. D’étranges bâtiments, complètement végétalisés, s’élevaient comme des forêts verticales. Les trois quartiers qu’elle m’avait décrits m’apparaissaient clairement : le quartier ancien, aux lignes horizontales et aux colonnades grecques, rappelait l’Alexandrie telle que j’avais pu la voir dans mes livres d’histoire. Le quartier de l’Agora, au centre, d’allure plus contemporaine, grouillait d’une foule curieuse et bavarde. C’était la partie la plus animée, celle où l’on aimait se retrouver. Des disputes y éclataient parfois. Mais elles finissaient le plus souvent par de chaudes accolades, autour d’un verre ou de quelques brochettes. Car ces bruyantes apostrophes n’étaient qu’un jeu dans lequel nul ne se prenait trop au sérieux. Ces gens venaient sur l’Agora pour se mesurer aux autres, tester la robustesse de leurs arguments, comme nous le faisions nous-même dans la grande salle des repas de la Citadelle. J’y retrouvais, à l’échelle d’une ville entière, les mêmes joutes verbales dans lesquelles régnait cette curiosité bienveillante envers les représentations d’autrui et qui en faisait le sel. Je m’y sentis tout de suite à l’aise.
Nous avons erré ensuite dans les architectures futuristes, aux lignes verticales, du quartier des Utopies. Un labyrinthe complexe de passerelles nous menait d’un îlot urbain à l’autre, d’une communauté à une autre, chacune vivant son rêve propre. Certaines vivaient complètement assistées de robots, d’autres refusaient au contraire toute technologie, laissant leurs enfants jouer nus sans que cela ne choquât qui que se fût. Entre deux rues, les paysages urbains basculaient d’un extrême à l’autre. Les modes de vie se télescopaient, sans que chacun pourtant n’empiétât sur la liberté d’autrui de construire sa propre utopie.
La nuit tombée, nous nous allongeâmes, épuisés, au milieu de la poussière. Il ne faisait pas vraiment froid. Personne ne semblait se soucier de nous. Je m’assoupis, bercé par les bruissements de la ville.
IV.4 – Basculements
Je me réveillai en sursaut. Face à moi, Perce-neige avait les yeux mi-clos, fixés vers le plafond de sa chambre. J’émergeai péniblement, comme d’un rêve profond. Je me grattai la tête et regardai mon amie, hébété. Elle-même haletait, épuisée par l’effort mental qu’elle avait dû réaliser pour tenir aussi longtemps notre connexion vers cet autre monde. Le réveil posé sur sa table de chevet indiquait que notre voyage n’avait pourtant duré que quelques minutes. Nous nous sommes regardés un moment, en silence. Avions-nous juste rêvé ? Perce-neige était-elle devenue folle, schizophrénique, me transmettant ses visions psychotiques ? Le monde que nous avions vu était-il réel ou était-ce une modélisation, un monde virtuel numérique créé par Alice avec qui Perce-neige pouvait désormais spontanément se connecter ? Aujourd’hui encore, il m’arrive de ne pas trop savoir quoi répondre.
Nous sortîmes prendre l’air, en nous tenant encore instinctivement la main. Je m’accrochais à cette fusion mentale que j’avais vécue et que j’aurais aimé prolonger encore un peu. Perce-neige avoua elle-même n’avoir jamais ressenti d’expérience empathique d’une telle intensité. La sensation étrange mais délicieuse perdura un moment, de ne former à nous deux qu’une seule personne. A moins que ce ne fût l’inverse : nous étions chacun non pas une, mais deux personnes à la fois. Nous en avons beaucoup discuté, au début. Puis nous avons arrêté. A quoi bon ? Nous nous sommes contentés de vivre cet état de fusion, cette connexion des esprits qu’aucun être conscient n’avait jusque-là connu avec un autre.
Nous avons de nouveau spontanément basculé le lendemain. C’était un processus aléatoire et incontrôlable. Perce-neige sentait confusément des premières hallucinations apparaître. Puis elle entrait en transe. Et je savais alors que j’allais plonger à mon tour. Pour me retrouver à chaque fois sur la même trirème, face au même capitaine que Perce-neige avait convaincu de nous transporter. Je finis par comprendre que c’était d’une certaine façon son métier. Julius – car c’est ainsi qu’il se présenta un jour – se définissait comment un Passeur.
« Mon rôle est d’aider les esprits courageux à trouver leur chemin vers notre monde, m’expliqua-t-il. Tant d’entre vous se noient dans cette mer perfide. »
Les récits abondaient, de malheureux qui avaient voulu forcer le passage, sans entraînement suffisant et sans guide. A la première tempête, leur esprit s’était perdu dans les limbes salées, happé par la folie mystique ou avalé par un monstre intérieur similaire à celui que j’avais moi-même affronté. Ceux qui embarquaient sur les misérables canots fournis par des bonimenteurs sans scrupule connaissaient le même sort funeste. Le monde des Idées ne se laisse pas aborder sans méthode ni discipline. Avec Julius, nous étions au contraire en sérieuse compagnie. Il connaissait cette mer comme sa poche, et avait suffisamment d’entregent pour faire débarquer à bon port qui il voulait.
Sur les quais de Nova Alexandrie, nous usions à chaque fois du même stratagème, nous mêlant à la noria de marins qui descendaient des navires pour dépenser leur solde dans le port. Certains tentèrent au début quelques grivoiseries. Mais Perce-neige fit clairement comprendre qu’elle n’était pas fille à matelots. Le message fut reçu sans rancune, prémices d’une solide amitié qui se confortait d’un passage à l’autre.
Jouxtant les quais, nous retrouvions à chaque fois la même agora. La même foule bigarrée et bruyante que Perce-neige ne se lassait pas d’observer. Elle conversait avec tout le monde, elle voulait tout savoir sur ces gens. Moi, je m’efforçais surtout de comprendre qui ils étaient et ce qu’ils faisaient là. Comment et par qui avait été construit cet univers. Et où nous étions précisément.

IV.5 – Ambassade
Un jour que nous déambulions sur l’agora, un homme s’approcha, vêtu comme un bédouin qui revenait du désert. Et au vu de la poussière sableuse qui encombrait encore sa barbe, je devinai qu’il ne devait pas en être resté loin. Il prit tout de suite un air mystérieux, comme s’il ne voulait pas être vu en notre compagnie. D’un geste, il nous intima de le suivre dans une ruelle.
« Camille m’avait dit que je vous trouverais sur l’agora.
– Vous connaissez mon père ? s’étonna Perce-neige.
– Bien sûr. Cela fait des années que nous sommes amis. »
Nous poussâmes tous les deux un même cri de surprise :
« Il a des amis… dans ce monde ?
– Bien sûr. Pourquoi n’en aurait-il pas ? Quoi que je ne fasse pas à proprement partie de ce monde. J’y suis un immigré, comme vous. Sauf que je ne viens pas vraiment du même univers que vous. J’ai été initialement pensé par Miguel, puis programmé par Alice, pour servir d’ambassadeur, en quelque sorte, entre nos mondes respectifs. J’accueille les gens comme vous, pour les aider à s’intégrer. J’ai certains pouvoirs ici. Ce qui me permet d’aider votre père, quand je le peux. Il a tellement fait pour cette cité. Mais il n’y est plus forcément bienvenu ces derniers temps. C’est pourquoi je suis contraint de rester prudent, et discret. Je vous prie de m’en excuser. Il est possible que je ne sois pas le seul à guetter votre venue…
– Qu’est-il arrivé à mon père ? demanda aussitôt Perce-neige.
– Ce n’est pas à moi de vous le dire. Et d’ailleurs, je ne connais de son histoire que quelques bribes. On fait généralement appel à moi pour ma discrétion. Aussi, je laisserai à d’autres le soin de mieux vous informer à son sujet. Mieux vaut d’ailleurs pour moi ne pas être vu trop longtemps en votre compagnie : si les citoyens sont naturellement bienveillants, il existe ici des forces puissantes moins bien disposées envers les étrangers comme vous. Je ne suis aujourd’hui qu’un messager. Camille m’a chargé de vous dire d’aller trouver Zératos-Thène, le directeur de la Grande Bibliothèque. C’est l’un de ses soutiens les plus fidèles. Il vous expliquera ce que vous devez savoir sur ce monde.
– Dites-moi au moins où est mon père, insista Perce-neige.
– Croyez moi quand je vous dis que je n’en sais rien. La dernière fois que je l’ai vu, c’était il y a quelques semaines, autour d’Amar-Na, dans la Vallée des Rois, du moins celle de ce monde. Il y étudiait un hiéroglyphe. C’est là qu’il m’a parlé de vous. Il m’a dit que vous chercheriez forcément à passer, que vous y arriveriez, mais que vous alliez avoir besoin d’aide. Il aurait aimé vous accompagner lui-même dans vos premières découvertes, C’est un jour qu’il attendait depuis si longtemps… Mais cette cité est devenue trop dangereuse pour lui. C’est injuste, vu le mal qu’il s’est donné pour elle, mais c’est ainsi. Je lui avais promis d’entrer en contact avec vous, Perce-neige. Il m’avait dit que je vous trouverais probablement perdue sur l’agora, et que je vous reconnaîtrais. Que votre visage m’évoquerait à la fois l’Orient et l’Occident, qu’une chaleur sereine m’envahirait aussitôt que mon regard croiserait le vôtre. Mon vieil ami ne s’était pas trompé. Mais je n’ai qu’un message à livrer : trouvez Zératos-Thène. Ma mission s’arrête là, et à présent qu’elle est achevée, il me faut prendre congé. Car que serait un programme s’il se mettait à improviser ? Ce serait d’une telle grossièreté… »
Il s’éclipsa sans écouter nos protestations, se volatilisant au milieu de la foule. Nous aurions aimé en savoir tellement plus!
Il nous fallait donc trouver la Grande Bibliothèque. J’avais l’intuition qu’elle devait se situer dans la partie la plus ancienne de la ville, dans sa partie antique. Car n’était-ce pas dans ses murs que se trouvait la mémoire du savoir, les racines qui nous reliaient au passé, aux origines de la pensée ? Du reste, il n’était guère difficile de la trouver, toutes les rues principales de la vieille ville convergeaient vers elle, comme si elle en était le point névralgique, le coeur vital. Le savoir était le sang de ce monde, la substance qui le maintenait en vie.
Il devait être tard, car les dernières lueurs du soleil accentuaient les teintes ocres du quartier antique. Les ruelles grouillaient de gens – du moins en avaient-ils l’apparence – qui rentraient chez eux après une journée de labeur. Occidentaux, Africains, Sud-américains ou Asiatiques se mêlaient les uns aux autres dans un métissage permanent des cultures. Nous nous laissions porter par cette atmosphère cosmopolite. Nous y croisions des chrétiens, des juifs, des musulmans, des bouddhistes, shintoïstes et d’autres encore, aux rites qui nous étaient parfaitement inconnus.
Un gargotier nous héla bruyamment à l’entrée de son échoppe. Perce-Neige comprit qu’il nous proposait un bol de soupe. Nous lui fîmes maladroitement comprendre que nous n’avions rien pour payer, ignorant par ailleurs quel type de monnaie pouvait bien avoir cours ici. Il ne s’en formalisa pas ; il avait manifestement compris que nous étions deux étrangers qui découvraient la cité.
« Les migrants se font de plus en plus rares depuis quelque temps. Aussi soyez les bienvenus chez moi ! »
Il nous confirma que le bol était offert sans façon, par pure amitié, ou peut-être dans l’espoir que nous reviendrions plus tard nous restaurer régulièrement chez lui… Nous ignorions tout de ces gens et de leurs moeurs.
Nous pénétrâmes dans une pièce au plafond bas, meublée de quelques tables au bois vermoulu, décorée de filets de pêche et d’outils de marins. Quelques habitués jouaient au cartes, près d’un âtre où se consumaient de grosses bûches. Ils sirotaient un breuvage qui ressemblait à des pintes de bière. L’un d’eux aspirait de longues bouffées d’une grande pipe sculptée, dont la fumée dégageait une odeur de tabac et d’épices.
Cette fumée me fit tousser tant elle était âcre à respirer. Et j’eus bientôt la sensation – mais n’était-ce pas plutôt mon imagination ? – qu’elle déclenchait en moi des visions fugitives, comme de vieux souvenirs trop brefs et trop faibles pour que je pusse les identifier clairement. Que cet étrange tabac en fût ou non à l’origine, je me sentais délicieusement bien. Les joueurs de carte nous saluèrent comme si nous étions de vieux amis.
Nous nous assîmes autour d’une petite table à côté d’eux. Le chef posa deux larges bols dans lesquels il versa une soupe épaisse. Il revint nous apporter deux cuillères et une corbeille emplie d’un pain noir à la mie grossière, légèrement amère mais finalement pas mauvaise. La soupe avait un goût surprenant. Elle dégageait des parfums exotiques que j’avais peine à décrire. Poivrés, sans doute, avec des pointes de lauriers. Pour le reste, je ne pouvais dire. Il m’a fallu plusieurs jours pour m’habituer aux arômes et aux senteurs de ce monde particulier. Nous fûmes néanmoins d’accord pour déclarer cette soupe aussi étrange que savoureuse. Nous avions de toute façon tellement faim que nous aurions avalé n’importe quoi. J’y trempais les larges tranches de pain, que j’engloutissais sous le regard satisfait de l’aubergiste.
« En voilà au moins deux qui font honneur à ma cuisine, prenez-en de la graine vous autres, lança-t-il.
– Laisse-nous jouer, tu nous emmerdes », le rabrouèrent gentiment « les autres ».
Notre bol terminé, nous remerciâmes chaleureusement notre hôte, nous saluâmes les joueurs de cartes qui entamaient une nouvelle partie, et nous replongeâmes dans le flot pédestre des riverains.
IV.6 – Bibliothèque
Sur la grande place où convergeaient les allées, nous aperçûmes un vaste bâtiment antique à colonnades, qui avait été restauré par endroits d’influences plus modernes. La ressemblance avec les représentations que j’avais pu voir de la Grande Bibliothèque d’Alexandrie était frappante. On y retrouvait les mêmes lignes géométriques parfaitement maîtrisées, ce même sens des proportions préfiguré par le Parthénon d’Athènes et que reprendra la culture hellène. Comme pour le Parthénon, l’architecte avait habilement triché pour compenser les défauts de la vision humaine, qui a naturellement tendance à courber les lignes : si les colonnes paraissaient parfaitement verticales, c’était parce qu’elles étaient, au contraire, légèrement rentrées de quelques centimètres, dessinant une pyramide fictive dont le sommet était à plusieurs kilomètres de haut. Ainsi, elles apparaissaient à l’oeil d’une verticalité absolue. De même, le corps des colonnes, avec ses rainures, aurait paru s’élargir au centre s’il avait été conçu rectiligne. Il était donc légèrement renflé au 2/5e de sa hauteur, pour paraître parfaitement cylindrique.
Ce bâtiment, sous ses apparences austères, transpirait la culture pour qui savait le décrypter. Du reste, sa fonction était clairement inscrite sur le frontispice : « Bibliothèque centrale de Nova Alexandrie ». Nous passâmes donc l’entrée monumentale d’où s’échappait en ces heures tardives un flot continu de visiteurs qui rentraient chez eux. Nous traversâmes un jardin intérieur évoquant un cloître. Il constituait un sas rafraîchissant de verdure, percé d’une fontaine, qui incitait – volontairement sans doute – au recueillement avant de gagner le hall central où les visiteurs étaient accueillis et renseignés.
Ce hall paraissait immense. Et pourtant, on le traversait d’un mur à l’autre en quelques pas seulement. Je compris assez vite qu’il jouait sur d’habiles illusions d’optique et sur des effets de miroirs pour paraître bien plus grand qu’il ne l’était réellement. Un même effet géométrique donnait l’impression d’un plafond exceptionnellement haut.
Un robot vaguement humanoïde, monté sur des roulettes, vint à notre rencontre.
« Vous êtes de toute évidence Perce-neige, énonça-t-il.
– Oui, c’est moi. Comment le savez-vous ?
– Ma mémoire a été récemment gravée d’une description assez complète de vous. Mais j’ignore en revanche qui vous accompagne. »
Je me présentai à mon tour.
« Vous cherchez Zératos-Thène, je présume. Je vais vous conduire à lui. »
Nous le suivîmes en silence dans de longs couloirs qui donnaient accès à de petites salles de lecture. La présence de ce robot me parut d’abord d’un anachronisme incongru au milieu des grimoires, parchemins voire papyrus plusieurs fois millénaires qui remplissaient les rayonnages. Mais je remarquai bientôt la présence discrète, mais réelle, d’écrans subtilement intégrés dans le mobilier. Comme si l’on avait voulu bénéficier de toutes les fonctionnalités offertes par la technologie, sans dénaturer l’âme de ce lieu dédié à la mémoire du savoir.
Une porte en chêne s’ouvrit pour révéler un ascenseur qui nous monta à l’étage. L’enfilade de bureaux, plus ou moins déserts en cette heure tardive, indiquait que nous étions dans l’allée réservée au personnel. Le robot nous mena au fond du couloir, vers une porte élégamment sculptée. Il l’ouvrit, nous proposa d’entrer et prit aussitôt congé en faisant siffler ses roulettes sur le parquet. Un vieillard s’extirpa lentement d’un fauteuil fatigué. Plutôt petit, chétif, la barbe aussi abondante que le crâne dégarni, il tremblait un peu mais son regard était encore vif sous ses paupières plissées. Il était vêtu d’une toge à la mode antique qui révélait ses bras maigres.
« Je suis bien Zératos-Thène », souffla-t-il.
Il nous invita de sa canne à nous asseoir entre deux piles de livres, et nous servit une tasse de thé vert. Il ne cessait d’observer Perce-neige.
Je posai ma tasse sur un plateau marbré de traînées de sucre, sans doute aussi vieux que le recueil de poèmes sur lequel il tenait en équilibre fragile. Je ne savais trop par quoi engager la conversation. Zératos-Thène mit fin à mon embarras:
« Vous devez être tous les deux un peu perdus, j’imagine… »
Je saisis cette perche sans me faire prier.
« Perdus est un euphémisme. Bouleversés plutôt… mais aussi émerveillés par tout ce que nous découvrons ici.
– Ce monde a l’air à la fois si féerique et pourtant si réel, enchaîna de son côté Perce-Neige.
– Je comprends… je comprends, répéta doucement le vieil homme. Nos visiteurs de l’au-delà sont toujours désorientés au début. Leurs premiers pas chez nous doivent être assez déroutants. Les questions se bousculent dans leur tête sans que nous puissions, hélas, y apporter beaucoup de réponses puisqu’ils finissent tous par comprendre que ces réponses dépendent justement d’eux.
– Mais enfin, où sommes-nous ? Quel est ce monde ? Qui sont ces gens ? Tout ceci est-il vraiment réel ? »
Tandis que je l’assommais de questions, le vieil érudit soupira.
« Toi, tu m’as l’air encore plus perdu que les autres, sourit-il en me pointant du doigt. Quelque chose me dit que tu n’as pas consacré beaucoup d’années à nous étudier. Comment tu as pu arriver jusqu’ici, sans suivre le long parcours d’un Érudit, est un mystère pour moi. Un de plus qu’il me faudra résoudre… Nous attendions la venue de Perce-neige, mais personne ne nous avait prévenus qu’elle serait accompagnée. Surtout par un novice aussi jeune et inculte. C’est assez inattendu. Et cela pourrait changer beaucoup de choses ici… Malheureusement, je crains de ne pas avoir beaucoup de réponses à t’apporter mon garçon. Si je t’expliquais là, tout de suite, ce que tu veux savoir, tu ne me comprendrais pas ; tu me prendrais pour un vieillard sénile qui abuse des métaphores. Il va te falloir découvrir les réponses toi-même. Ou plutôt, les VIVRE toi-même, car c’est ainsi que les choses ici fonctionnent : on y vit les concepts, on les ressent, on ne les tire pas seulement des livres. Ce qui n’a pas été vécu n’est pas vraiment su. C’est ce que me répétait mon ancien Maître, qui lui-même le tenait du sien. »
Vivre le savoir ? L’expression me paraissait obscure. Mais je compris qu’il était inutile d’insister. Devinant ma déception, Zératos-Thène poursuivit :
« Si tu veux vraiment comprendre ce monde, comment il est né et comment il fonctionne, il va te falloir revenir à la source, au commencement de toute pensée symbolique, quand l’homme s’est arraché à l’animalité pour accéder, par des signes gravés sur la pierre, puis tracés sur du papier, à un nouvel univers. »
Il attrapa un livre qui traînait sur son bureau et l’ouvrit au hasard.
« Vous rendez-vous compte de l’impact qu’a pu avoir, sur toute l’humanité, ce simple objet qui tient dans une main ? Il a rendu votre pensée immortelle, autonome. C’est lui qui vous sépare des barbares et des bêtes. Grâce à lui, les humains peuvent converser avec Platon, Aristote, Newton ou Einstein, comme s’ils étaient encore avec vous, alors même que leur enveloppe de matière a depuis longtemps disparu de votre monde. Mais leur pensée, grâce aux livres, sédimente en strates épaisses sur lesquelles vous pouvez à votre tour construire la vôtre. Tout ce qui a été inventé depuis, en comparaison, n’est qu’un florilège d’anecdotes… »
J’acquiesçai en prenant soin de ne pas perturber son monologue, tandis que Perce-Neige furetait dans les volumes empilés de sa petite bibliothèque personnelle.
« Comment tout a commencé ? enchaîna-t-il enfin. C’est bien par là qu’il faut à ton tour démarrer. Mais c’est un long voyage que tu vas devoir faire, mon garçon. Y es-tu seulement prêt ? »
Il déroula une carte. Une cité y était représentée au centre – je devinais qu’il s’agissait de Nova Alexandrie -, entourée de différents reliefs, montagnes, plaines, forêts et déserts qui construisaient une géographie complexe. Certains tracés étaient flous et – mais était-ce possible ? – il me semblait bien en voir certains se modifier devant mes yeux, comme si cette carte était… vivante.
« Vous devez d’abord comprendre qu’ici la carte EST le territoire, insista-t-il. Nous sommes un monde de représentations, pas un monde de matière objective. C’est vous, dans l’au-delà matériel, qui déterminez d’une certaine façon ce qui existe ici. »
J’avoue ne pas avoir compris, sur le moment, ce qu’il pouvait bien signifier par là. Je lisais sur la carte qu’au-delà de Nova Alexandrie se trouvaient le gouffre de l’Histoire, les montagnes de la Philosophie, au nord les glaciers et pics enneigés des Mathématiques, le désert froid de la Cosmologie, les régions rocheuses des Sciences de la matière, les canyons profonds de la Technologie. Plus au sud, la région des grands lacs des Sciences de la vie, les vastes forêts des Sciences humaines, la jungle tropicale des Arts et Littératures…
« Chaque domaine du savoir a son propre royaume, son climat et ses lois. Ses petits rois, aussi, qui se querellent stupidement les uns avec les autres, pour imposer leur règne sur l’ensemble du savoir.
– Tout cela paraît si humain, observa Perce-Neige.
– Le monde des Idées est forcément à l’image de celui des hommes, puisque ce sont eux qui, en définitive, les créent et les vivent. A moins que ce ne soit l’inverse… C’est une thèse que beaucoup défendent ici. La matière crée-t-elle la pensée, ou est-ce l’inverse ? La question elle-même n’a peut-être aucun sens… »
En examina plus attentivement sa carte, j’y lus des lieux familiers : le laboratoire Cavendish, à Cambridge, la ville de Syracuse, en Sicile, Athènes, en Grèce, et des cités depuis longtemps disparues comme Milet, au Proche-orient.
« Je ne comprends pas, lui dis-je. Tous ces lieux sont bien réels, ou ont réellement existé. Que font-ils sur cette carte qui, si j’ai bien compris, est celle d’un monde imaginaire ? Ce monde est-il fictif ou réel bon sang ?
– Les deux à la fois, jeune novice. La géographie de notre monde se superpose par endroits à celle du vôtre. Mais crois-tu qu’il n’y a qu’une seule façon de voir la ville de Cambridge ? Tu peux t’y rendre pour aller voir un ami. Et tu ne seras sensible qu’à l’interconnexion des rues que tu devras parcourir pour te rendre chez lui. Mais tu peux aussi y voir une ville chargée d’histoire, et naviguer d’un siècle à l’autre au gré des grands événements qui auront laissé des traces dans chacun de ses quartiers. Tu peux y voir la ville où Newton démarra ses études et où il enseigna lui-même. Cambridge devient alors un nœud majeur d’un vaste territoire du savoir qu’est la physique classique. Cambridge existe dans ces trois mondes : dans le monde de ton réseau social, dans celui de l’histoire politique et dans celui de la physique. Et dans beaucoup d’autres encore. Tous ces mondes se superposent, ou plutôt, si l’on parle comme un mathématicien, sont des plans distincts d’un même hyperespace dont le nombre de dimensions serait infini. On les appelle ici des branes de savoirs. Il y a la brane des mathématiques, celle de la physique, de la biologie, des sciences humaines, de la philosophie, de l’historiographie, etc. Chaque brane est une façon de se représenter le monde. Et dans chaque brane on peut trouver des sous-branes, etc. »
Zératos-Thène prit une feuille de papier et dessina des feuillets qui s’entrecroisaient.
« Dans toutes ces branes, il y a par exemple une ville qui s’appelle Athènes. Elle est d’une certaine façon un point – ou plutôt une ligne si on raisonne en trois dimensions – d’intersection, qui permet de passer d’une brane à l’autre. Mais d’une brane à l’autre ce sont des Athènes différentes. Car l’Athènes qui intéresse l’historien n’est pas la même que celle qui intéresse le philosophe. Ou celle du mathématicien. Et encore moins celle de l’architecte, bien qu’il y ait malgré tout des connexions possibles. La même ville existe donc sur des branes différentes, comme autant de modes de réalité distincts. La géographie ici ne fonctionne donc pas comme celle de ton monde matériel : une même montagne, une même rivière ou une même ville peuvent appartenir simultanément à des pays – ou à des branes – différents. Quand on parle du gouffre de l’histoire ou des montagnes escarpées de la philosophie, c’est donc plus une façon de parler, un territoire métaphorique, que des réalités géographiquement distinctes. Mais là encore, les mots sont bien impuissants à décrire de telles réalités. Et je ne t’en donne que les éléments que j’ai moi-même compris. Il existe peut-être d’autres façons de comprendre ce monde. Il te faudra vivre ta propre expérience de cet univers pour t’en forger ta propre représentation. Le projeter à ton tour, pour ainsi dire, sur ta brane personnelle. »
Le vieillard gratta sa barbe épaisse. Il devinait ma perplexité. Perce-neige ne paraissait pas plus à l’aise avec toutes ces abstractions.
« Prenez plutôt un des ces délicieux biscuits, dévia-t-il pour détendre l’atmosphère. Ils sont fabriqués ici, dans les cuisines de la bibliothèques. J’adore leur parfum citronné. »
Nous dûmes reconnaître qu’ils avaient un goût unique, qui se mariait à merveille avec les arômes de thé. Zératos-Thène pointa alors du doigt une région de sa carte, qui présentait des reliefs tourmentés. Il y était écrit, en lettres manuscrites, « Paléontologie ».
« C’est là, avec la naissance d’Homo sapiens, que tout a commencé, que cet univers est né. C’est donc là qu’il vous faut commencer à vous rendre si vous voulez vraiment le comprendre. Vous pourrez y entrer dans les branes les plus primitives, les premières qui se sont déployées par-delà la matière. Si vous souhaitez entreprendre ce voyage, je peux vous rédiger un sauf-conduit qui vous permettra de sortir de Nova Alexandrie. Il y a quelques cycles – l’unité qui équivaut à vos années – vous n’en auriez pas eu besoin. Tout le monde était libre de circuler à sa guise. Nova Alexandrie a toujours été un carrefour où toutes les branes s’entrecroisent. Sa vocation est d’accueillir tous les voyageurs du savoir, d’où qu’ils viennent et où qu’ils aillent. Mais cet idéal commence à se flétrir. Des premières mesures ont été édictées, il y a des cycles, pour contrôler qui entre et qui sort de la cité, comme si l’on voulait restreindre les échanges. J’ai vu des bédouins se faire refouler sans ménagement hors des murs, parce qu’ils provenaient de branes décrétées trop exotiques ou inadaptées. Une police des idées patrouille, qui veille à ce que l’ordre règne dans la cité. On a commencé à mettre à l’écart les marginaux, comme s’ils représentaient une quelconque menace. »
Zératos-Thène soupira.
« J’ai bien peur que vous ne veniez à un moment particulièrement sombre de notre histoire. Et j’ai presque honte de la vision que vous allez avoir de notre monde. Car en tant qu’étrangers, il est possible que ne soyez pas toujours les bienvenus désormais. Camille lui-même a été décrété persona non grata pour l’aide qu’il ne cesse de procurer aux migrants. Il ne peut plus venir qu’en clandestin, contraint de se cacher dans un monde dont il fut pourtant pendant longtemps l’un des piliers. »
Perce-neige sursauta.
« Vous savez où est mon père ?
– Hélas non. Il n’est pas assez fou pour se rendre à la Bibliothèque. Il y serait arrêté sur l’heure. Il me fait juste parvenir, de temps à autre, quelques missives écrites de sa main. Je sais que, lorsqu’il parvient à entrer dans la cité, il se cache dans quelque endroit que lui-seul connaît. Un refuge de sa pensée. Je ne sais quel crime il a commis, que ce soit dans ce monde ou dans le vôtre. Mais le Conseil de Nova Alexandrie semble bien décidé à le neutraliser. Triste Conseil, du reste, qui n’a plus la grandeur d’âme qu’il a pu avoir dans les hectocycles passés…
– Comment pourrions-nous le retrouver ? demandai-je.
– Je n’en sais fichtre rien. Je suppose que c’est plutôt lui qui vous retrouvera. »
Je devinai le dilemme qui torturait Perce-neige. Elle mourrait d’envie, comme moi, de partir explorer ce monde qui s’offrait à nous. Mais elle devait, aussi, retrouver et aider son père dont l’esprit se terrait peut-être dans l’une des ruelles de cette Nova Alexandrie. Zératos-Thène avait tout aussi conscience du conflit qui la lancinait.
« Il te faudra choisir, jeune fille. Car c’est une autre des grandes règles de ce monde : tout visiteur y vient animé de sa propre quête. C’est elle qui détermine la brane sur laquelle vous allez naviguer. Car chacun ne chemine jamais que vers sa propre vérité. Pour la tienne, jeune homme, il te faudra te rendre à la porte Sud, que tu franchiras avec ce sauf-conduit. Tu prendras une navette pour traverser le lac Maréotis, puis tu chercheras un transport vers le royaume de la Paléontologie.
– Mais comment ferai-je un tel voyage sans un sou en poche ? »
Zératos-Thène sourit. Il fouilla dans un tiroir et en sortit de minuscules cristaux en forme de fleurs.
« Ici, rien ne s’achète ni ne se vend vraiment. Tout se donne ou s’échange. Chaque savoir que tu acquiers, chaque expérience que tu vis et qui te rend plus sage, te procure des cristaux d’edelweiss. C’est notre monnaie à nous. Quoique ce n’en soit pas vraiment une, puisqu’elle ne se garde pas. Comme toute fleur fragile, l’edelweiss fane vite. Tu ne peux les garder dans ta poche que quelques jours. A moins que tu ne les donnes toi-même à quelqu’un d’autre, et qu’ils recommencent ainsi un nouveau cycle de floraison. Ici, tout ce qui n’est pas donné ou échangé est perdu, souvenez-vous en ! »
Je pris les edelweiss qu’il me tendait. Ils scintillaient de reflets multicolores, comme s’ils étaient remplis des mêmes quasi-cristaux que ceux que j’avais cueillis dans notre monde de matière. Ils dégageaient une légère chaleur. Je les disposai délicatement dans une petite bourse en cuir qu’il m’offrit, dont le fond était rempli d’un terreau tiède.
« Garde toujours cette bourse avec toi. Les edelweiss ont besoin de terreau pour germer et se fortifier. Si tu ne veux pas qu’ils fanent tout de suite, il te faudra en prendre soin. Rends-toi ici, m’indiqua-t-il en me montrant un point de la carte. Dans ces souvenirs d’une époque ancienne où l’humain n’avait pour seul savoir que ce qu’il avait pu lui-même observer depuis sa naissance. Laisse-toi guider par ce que tu y trouveras. Et si tu fais confiance à ta propre intelligence, tu t’en sortiras. Fais-toi aider des chemineurs qui parcourent ces régions. Il y en a de moins en moins, hélas, depuis que le Conseil restreint la venue d’étrangers. Mais tu apprendras très vite à les reconnaître : ils marchent, comme toi, à la recherche de réponses, liant un savoir à un autre, d’une brane à l’autre, pour satisfaire leur quête de sens. Et enrichir eux-mêmes cette terre de ce qu’ils ont à leur tour trouvé. De grands chemineurs, comme Camille, sont devenus célèbres, de vrais héros. Mais il en existe de plus discrets, qui ont cheminé à la fois dans la terre des savoirs et dans votre monde, accumulant une sagesse immense. Cheminer prend toute une vie. »
Nous quittâmes le vieil érudit et je rangeai dans ma poche le sauf-conduit qu’il avait signé. Je me réveillai péniblement, à côté de Perce-Neige épuisée.
IV.7 – Épices
Nous rebasculâmes le lendemain, retrouvant le même plaisir à déambuler dans cette cité suspendue dans un ailleurs dont nous ne pouvions préciser ni le lieu ni l’époque, hors de toute réalité matérielle. Et où pourtant tout semblait si réel : l’air qui chatouillait nos narines, l’herbe qui ondulait sous nos doigts, les senteurs de cannelle qui emplissaient certaines rues… Nous nous rendîmes d’un pas vif vers la porte Sud. Une foule de badauds se faisait de plus en plus dense autour de marchands qui vendaient ce qu’ils appelaient de l’« humus », conditionné dans de petits sachets odorants.
« J’ai du Robespierre. Un peu fort mais… de première qualité », me lança l’un d’eux en ouvrant l’un de ses sacs.
Du Robespierre ? J’écarquillai de grands yeux étonnés.
« Eh bien quoi ? Fais pas le dégoûté. Ca ne t’intéresse pas ? »
Je lui expliquai que je n’avais aucune idée de ce que pouvait être de l’ « humus de Robespierre ». C’est lui qui parut à son tour estomaqué.
« Je ne sais d’où tu viens, étranger, mais c’est bien la première fois que je vois quelqu’un qui ignore ce qu’est de l’humus. Que prends-tu donc pour te nourrir l’esprit ? Tu as dû grandir dans un village perdu dans le désert ! Ecoute, le plus simple, c’est encore d’en goûter. Achète m’en un lot et cale le toi en bouche. »
Contre un edelweiss de ma bourse, il nous donna un sachet que j’ouvris pour en déposer le contenu, un peu terreux, sur ma langue. Je ressentis aussitôt un goût de sang qui m’indisposa. Des images se formèrent dans ma tête, que j’interprétai comme des souvenirs. Sauf que ce n’étaient pas les miens, ni ceux de Perce-neige. Je devinai qu’ils étaient ceux d’un valet du 18e siècle, qui avait manifestement connu une maîtresse de Robespierre. Ce valet semblait se régaler, au vu des images qui s’enchaînaient et des émotions qui y étaient liées, du spectacle des corps qu’on décapitait avec frénésie sur une place de Paris. J’eus un haut-le-coeur qui me fit presque vomir. Je regrettai mon achat. Le bonimenteur se moqua.
« Et alors, étranger, on ne supporte pas l’Histoire ? Ah c’est une chose de lire la Révolution française dans de vieux livres. C’en est une autre de la voir avec les yeux de ceux qui l’ont vraiment vécue. La prochaine fois, prends plutôt du Casanova. » Et il éclata de rire.
Nous eûmes alors l’intuition de ce qu’était cet humus : des souvenirs fermentés de savoirs ou d’expériences qui, un jour, avaient été réellement vécus par des esprits humains. Nous étions dans un monde où toutes les abstractions, tous les produits de la conscience, prenaient vie. Je retins néanmoins le conseil du commerçant : mieux vaudrait éviter, dans un premier temps, les souvenirs trop crus de batailles, de tortures et autres joyeusetés sordides que seul l’esprit humain est capable de concevoir. Casanova ? Ma foi, pourquoi pas… C’est Perce-neige qui, cette fois, éclata de rire.
Nous longeâmes un haut rempart pour nous joindre au flux des pèlerins qui passaient sous une porte majestueuse. Une poignée de gardes vérifiaient qu’ils avaient tous l’autorisation de quitter la cité. Je ne pus que partager la consternation de Zératos-Thène : ces contrôles incongrus ternissaient l’ambiance de liberté parfaite qui avait jusque-là régné – au moins en apparence – dans cette ville. Un des pèlerins fut repoussé sans ménagement: son sauf-conduit était manifestement périmé. Ses tentatives pour amadouer les gardes échouèrent piteusement.
« Les terres du savoir n’ont que faire d’un pouilleux de ton espèce », se moqua le capitaine.
La scène me révolta. Et les regards désapprobateurs, autour de moi, me confirmèrent que je n’étais pas le seul à être choqué. Des murmures s’élevèrent contre cette rugueuse police de l’esprit. Le pèlerin refoulé cependant n’insista pas. Il rebroussa chemin, attendant sans doute un jour de meilleure fortune.
« Je ne partirai pas avec toi, me confia alors Perce-neige. Je dois d’abord retrouver mon père. Mais pas seulement. Il faut surtout que je comprenne pourquoi il se cache. Je sens bien qu’il se passe des choses, ici comme à la Citadelle, qui ne sont pas normales. Jamais mon père, quand il s’exaltait sur Nova Alexandrie, ne m’avait parlé d’une quelconque police des esprits. Au contraire. Il m’avait toujours dit que la grandeur de Nova Alexandrie était d’accueillir quiconque aimait les Idées, sans jugement d’aucune sorte, dans une tolérance la plus parfaite pour autant qu’elle était partagée. Or plus j’observe cette ville et plus j’ai l’impression qu’elle s’échine à maintenir l’illusion de ce qu’elle n’est peut-être plus. Tous ces gens paraissent heureux, mais c’est comme si au fond d’eux ils attendaient quelque chose. Je perçois cette attente dans les regards. Ils expriment par moments une crainte sourde, mais aussi l’espoir d’un changement. Je ne maîtrise pas encore leur langage non verbal, la traduction émotionnelle de leurs gestes n’est pas forcément identique à celle de notre monde, mais j’identifie de temps en temps ce que j’appelle des incongruences, comme un décalage entre ce qu’ils disent et ce que leurs gestes trahissent. Je crois que ce monde souffre mais qu’il ne le sait pas encore consciemment. Je dois comprendre ce qui se passe. »
A vrai dire, je ne fus pas surpris qu’elle décidât de rester. Comment aurait-elle pu partir explorer ce monde, en touriste, alors que son père se terrait peut-être dans l’une de ces rues ? Etait-il à seulement cent mètres de nous ? J’étais moi-même partagé entre l’envie furieuse de partir à la conquête des vastes étendues que je devinais au-delà des remparts, et le désir de retrouver enfin mon Maître à l’intérieur de la cité. Mais j’avais moins d’inquiétude que Perce-neige. Savoir que Camille était en sécurité, au fond, me suffisait. Je l’estimais bien trop malin pour se faire repérer par une quelconque police. Ou plutôt, cela m’arrangeait de le penser. Même si je n’avais pas les capacités perceptives de Perce-neige, je ressentais moi-aussi cette sensation d’être surveillé par des patrouilles discrètes mais omniprésentes. De qui cette cité pouvait-elle bien vouloir se protéger ? Qu’avaient donc à craindre les autorités ? Nous n’avions vu ni le moindre voleur, ni la moindre agression. De toute façon, les edelweiss ne fleurissaient, nous avait-on expliqué, que lors d’un don ; quel intérêt y avait-il à voler un argent qui se fanerait en quelques jours ? Il n’y avait d’ailleurs ici ni riches ni pauvres, au sens où nous l’entendions dans notre monde. Tout le monde semblait jouir d’un confort à peu près équivalent. Les différences d’un individu à l’autre n’étaient qu’affaire de goûts vestimentaires ou de priorités que chacun pouvait accorder à telle ou telle chose. La vraie richesse était ailleurs. J’observai que certains, en ce monde, étaient plus populaires que d’autres. Les notables s’entouraient d’une foule avide de les écouter, tandis que des marginaux erraient seuls, cherchant à lier des conversations qui restaient laborieuses et s’étiolaient aussitôt. Il y avait en somme, au sein de l’agora, les idées à la mode et celles qui ne faisaient pas, ou plus, recette. Mais au moins ces marginaux pouvaient-ils trouver ici l’assurance de garder leur gîte et de manger à leur faim. Dans ce monde, on n’abandonnait jamais totalement un concept, quand bien même il n’avait plus de famille pour veiller sur lui. Perce-neige, d’instinct, redoublait d’attention envers ces laissés-pour-compte du débat public, grattant la croûte de leur marginalité pour laisser briller ce qui pouvait faire leur attrait.
Me séparer de Perce-neige pour suivre ma propre quête fut difficile. Qu’allai-je trouver hors de ces murs ? J’étais à la fois curieux et pétrifié. Je me sentais d’un coup si fragile, si vulnérable sans sa présence rassurante. Elle me serra un long moment dans ses bras en me souhaitant bonne chance.
« Tu es de toute façon fait pour ce monde, me confia-t-elle dans l’oreille. Tu te feras très vite à lui, j’en suis sûre. »
Je respirai un grand coup et me présentai aux gardes qui barraient la porte.
IV.8 – Aérobus
Les gardes prirent mon sauf-conduit et m’apposèrent au poignet un étrange tampon. Sur ma peau étaient désormais inscrits, de façon parfaitement indélébile, le jour et l’heure de ma sortie de Nova Alexandrie. Ainsi, il n’était pas possible de perdre son passeport : on le portait littéralement sur soi.
Le lac Maréotis étalait devant moi, à perte de vue, ses reflets marron-bleu. La mer d’un côté, le lac de l’autre : Nova Alexandrie était nichée, comme son homologue égyptienne, sur un isthme étroit qui s’étirait le long de la côte. Une navette partait dans dix minutes pour la terre des Savoirs, qu’on entrevoyait de l’autre côté de cette étendue d’eau saumâtre que j’imaginais poissonneuse, comme le suggéraient les nombreuses barques de pêche. J’eus à peine le temps de prendre un ticket, qui me coûta un edelweiss. Un son de cloche annonça le départ imminent.
Le lac était calme. Une brise légère atténuait la piqûre chaude du soleil. La navette s’élança en ronronnant. Elle glissa bientôt sur l’eau, son léger sifflement couvrant à peine le clapotis des vagues. Je me mis face au vent pour mieux sentir les fragrances iodées, un peu vaseuses, tandis que la terre des Savoirs, sur l’autre rive, révélait peu à peu ses courbes exaltantes. Quelques poissons volants tentèrent une course un peu vaine avec ce partenaire d’acier. La traversée ne dura que quelques minutes. Même si Perce-Neige n’était plus à côté de moi, je sentais toujours sa présence, comme un idéal transcendant qu’on emporte avec soi.
La navette accosta de l’autre côté du lac, et je posai un pied sur le ponton d’accueil. L’atmosphère n’était déjà plus la même. Les toges raffinées des Nouveaux Alexandrins avaient cédé leur place à des tenues plus rustiques : lourdes chaussures de marche, combinaisons de survie et sacs à dos trahissaient la soif d’aventures qui animaient mes compagnons de voyage.
Je repérai ce qu’ils appelaient un aérobus, à destination des terres paléontologiques. Il m’en coûterait 10 edelweiss – ou 10 Edels comme tout le monde disait ici – pour effectuer ce trajet dans ce qui ressemblait à un bus sans roue évoluant à un mètre du sol, comme en apesanteur. Les voyageurs s’épargnaient ainsi les cahots et autres nids de poule de la route. Le confort était indéniable, malgré des sièges d’un autre âge. Combien d’années, de siècles, ou plutôt de cycles avait ce véhicule ? Beaucoup, sans aucun doute. Je m’assis à côté d’une dame un peu forte, dont le front perlait de sueur. Son sourire accueillant m’incita à engager de timides salutations.
« Le trajet va être long », souffla-t-elle pour justifier les aises qu’elle prenait en étalant quelques coussins. Elle se présenta aussitôt : elle s’appelait Lise, et elle n’en était pas à son premier voyage en terre des Savoirs. Elle m’expliqua qu’une question précise la préoccupait : pourquoi les Néandertaliens, ces premiers hommes qui peuplaient jadis les étendues froides de l’Europe, s’étaient-ils éteints pour être remplacés, il y a quelques dizaines de milliers d’années, par des Homo sapiens ? Ce qui n’était, au départ, qu’une simple interrogation avait fini, de cycle en cycle, par devenir chez elle une obsession. Homo sapiens avait-il réservé à Néandertal le sort que les colons européens feront plus tard subir aux Amérindiens ? La rencontre de deux civilisations se solde-t-elle inévitablement par la destruction de l’une d’elles ? Je sentis comme une trace de culpabilité mal assumée dans son récit. Comme une volonté d’en avoir le coeur net, de savoir si, en somme, nos lointains ancêtres avaient pu vraiment commettre l’un des premiers génocides de la préhistoire.
La question qui me préoccupait était plus géographique : à quoi ressemblait concrètement cette terre des Savoirs ? J’avais cru comprendre que sa topologie recouvrait en partie celle du monde matériel d’où je venais, mais que tout y serait perçu à travers le double filtre des savoirs qui m’intéressaient et de la quête personnelle qui m’animait. Sous quelle forme exactement ? J’étais impatient de le découvrir.
Nous discutions ainsi de nos passions respectives, lorsque l’aérobus s’engouffra dans un long tunnel. Des veilleuses s’allumèrent pour diffuser dans l’habitacle une faible lumière.
« Ne vous inquiétez pas, s’empressa de me rassurer ma compagne de voyage. Le passage dans la brane paléontologique n’est pas douloureux. Vous ne sentirez absolument rien, vous pouvez en être sûr. J’ai fait ce voyage tellement de fois… »
L’aérobus accéléra. « Mesdames et messieurs, nous entrons en territoire paléontologique », annonça le chauffeur, sous les vivats joyeux des passagers. Il régnait entre nous la gaieté complice que partagent ceux qui voguent vers un même appétit de savoirs. Je me sentais bien, en communion avec tous ces gens qui étaient devenus autant de compagnons. Perce-neige avait raison : j’étais fait pour ce monde. Ou ce monde était fait pour moi.
En sortant du tunnel, l’aérobus ralentit son allure. Les paysages avaient changé. Aux plaines de joncs et déserts de rocaille qui entouraient le lac Maréotis avaient succédé des forêts d’arbustes. Elles s’étalaient à perte de vue, formant un massif dense, difficilement pénétrable au-delà de la piste que suivait notre véhicule. Nous ne traversâmes aucune ville, ni le moindre village. Comme le fit remarquer notre chauffeur, qui agrémentait le trajet de courtes anecdotes, les terres paléontologiques étaient depuis toujours très peu peuplées.
Quand la nuit fut tombée, après avoir partagé des galettes de blé et un vin léger, nous essayâmes tant bien que mal de dormir sur notre siège. L’aérobus glissa toute la nuit au-dessus de sa route, nous berçant de son vrombissement régulier. Il s’arrêta au petit matin à Cro-Magnon-Ville, son terminus. La gare routière était un vaste parking terreux où chaque départ dégageait une épaisse poussière rouge qui collait aux vêtements. Je m’installai à la terrasse d’une auberge pour goûter un lait de pachyderme – une boisson locale – et profiter des premiers rayons de soleil du jour, me laissant porter par l’agitation sonore qui mêlait des langues exotiques aux bêlements d’animaux de tous poils. Le lait avait un goût rance qui m’arracha une grimace. Je n’eus pas le courage de demander quel animal exactement l’avait produit.
Il me fallait continuer ma route. Mais vers où ?
Zératos-Thène m’avait clairement pointé une première destination : la grotte de Chauvet où, m’avait-il assuré, je trouverais des premières réponses à mes interrogations. Je pris langue avec l’aubergiste, qui semblait plus doué pour renseigner les voyageurs que pour remplir leurs estomacs.
Il me conseilla une caravane de chameaux qui s’apprêtait à partir. Des habitués acquiescèrent, approuvant sans réserve la sagesse de ce choix. Je me laissai convaincre par cette rassurante unanimité.
Malik, le caravanier, se révéla plutôt coriace en affaire, et ce voyage me coûta bien plus d’Edelweiss que ce que j’avais escompté. Mais je vis, au soin qu’il mettait à préparer son paquetage, qu’il ne prenait pas sa mission à la légère. Cheminer dans ces contrées sauvages n’était pas toujours sans danger, m’avait prévenu ma compagne d’aérobus. Mieux valait avoir un bon guide et en payer le prix. Je posai mon sac sur le flanc d’un chameau qui me paraissait particulièrement placide. Je montai sur la petite nacelle aménagée sur son dos pour les voyageurs. Il se cambra de mauvaise grâce, mais me laissa m’installer. D’un signe de Malik, la caravane s’ébranla.
IV.9 – Caravane
Nos chameaux s’enfoncèrent dans les forêts denses d’arbustes et de broussailles. Des falaises calcaires, criblées de grottes, dessinaient en serpentant ce que fut sans doute le lit d’une ancienne rivière. J’ignorais comment Malik se repérait dans ce maquis touffu écrasé de soleil. Jamais pourtant il ne manifesta le moindre doute. Il parlait peu, gratifiant d’un signe sobre de la tête mes tentatives infructueuses d’engager la conversion. Sans doute appréciait-il la solitude qui imprégnait ces lieux. A moins qu’il n’eût trop longtemps goûté, par abus d’humus, la compagnie des consciences préhistoriques qui peuplaient ces paysages. Peut-être se sentait-il plus proche de l’émerveillement mutique d’un homo erectus, dont la pensée brute n’avait pas encore à passer le filtre d’un quelconque langage articulé. Quoi qu’il en fût, je ne tirerais de lui que quelques mots et divers grognements que je pris pour des acquiescements.
Les bivouacs me donnaient en revanche l’occasion de me lier à mes compagnons de voyage. Beaucoup étaient des passionnés de paléontologie, qui reconstituaient patiemment le récit de leurs origines. Certains entamaient leur première expédition, mais d’autres en avaient fait un pèlerinage régulier, une transhumance spirituelle qu’ils répétaient presque chaque année, un retour aux sources qui revivifiait leur pensée. Je me demandais si, parmi eux, certains étaient comme moi des esprits parfaitement humains, qui avaient réussi eux aussi à établir une connexion avec Nova Alexandrie, ou s’ils étaient tous de pures projections m’apparaissant sous forme humaine. J’hésitais pourtant à aborder le sujet, me rappelant les conseils de prudence que l’on m’avait prodigués. Du reste, quelle importance cela avait-il ? Car qui pouvait précisément dire ce qu’était, en réalité, un esprit humain ? Ou ce que d’autres avaient choisi d’appeler « une âme humaine »?Tirer mon origine d’une circulation électro-chimique dans un réseau de neurones me conférait-il une existence supérieure à d’autres modes d’émergence ? Je préférais m’en remettre à mes seules perceptions sensibles, à cette empathie spontanée qui me faisait apparaître ces gens aussi réels que moi.
Des discussions s’engageaient autour des côtelettes qui grillaient sur le feu. J’avais beau me dire qu’elles n’étaient que des « idées de côtelettes » et qu’elles ne contenaient sans doute aucune trace d’un réel atome de porc ou de bœuf, je constatais qu’elles avaient toute la saveur de leurs équivalents matériels. Au reste, qu’est-ce la matière ? Y a-t-il une différence essentielle entre elle et l’information que nous avons sur elle ? Comment pouvais-je dire que ces côtelettes n’étaient pas réelles, puisque mon cerveau les considérait résolument comme telles.
Le repas terminé, nous reprîmes la route sans trop tarder. Il fallait rester mobile, justifia Malik. Pourquoi ? Il ne le précisa pas, comme s’il s’agissait d’une évidence. Mais je vis au soin qu’il mit à effacer nos traces qu’il ne souhaitait pas attirer l’attention. Qui ou quoi devions-nous craindre ? J’avais encore tant à apprendre de ce monde.
Le trajet était long. Et plutôt inconfortable sur ces chameaux au-dessus desquels l’horizon ne cessait de monter et de descendre. Aussi je fus soulagé de nous voir arriver enfin sur le site de Chauvet. Quelques masures de pierres et de terre séchée, disposées en hameau, m’indiquèrent que des gens y vivaient. Je trouvai une jeune femme occupée à entretenir un lit de braises où elle faisait cuire ce qui ressemblait à des pommes de terre. Son sourire était bienveillant. Mais elle ne semblait guère plus bavarde que Malik. D’un geste, elle m’invita à m’asseoir à ses côtés et partagea sans façon ses tubercules, que je savourai saupoudrés de sel et couverts d’une lame de beurre. Je ne sais si c’est son air affable qui m’engaillardit, mais je me confiai à elle et lui fis part de mon désir de comprendre ce monde que je découvrais. Elle m’écouta, les yeux mis-clos.
« Ainsi tu viens directement de l’au-delà ? murmura-t-elle, songeuse. J’ignorais qu’il était possible de basculer aussi jeune, sans avoir été longuement initié. Cela pourrait changer bien des choses… »
Elle resta silencieuse un long moment, tisant les braises de son bâton.
« J’ignore qui t’a fait accéder à notre monde, mais j’imagine qu’il avait ses raisons. Bonnes ou mauvaises, ce n’est pas en à moi d’en juger. »
Elle prit une longue inspiration et poursuivit :
« Comme tu me sembles honnête et animé d’une passion sincère pour le savoir, je vais prendre le risque de t’aider. Je pense que tu as déjà compris que rien, ici, n’est fait de matière physique au sens où vous, les humains de l’au-delà, vous l’entendez. Il n’y a ici que de la matière spirituelle. Tout n’est que projection de ce que vous, les humains qui êtes en quelque sorte nos dieux, avaient pu collectivement imaginer, inventer ou concevoir. Moi-même, qui suis née dans ce monde il y a des siècles, je ne suis que l’écho d’une conscience humaine, d’un désir humain de connaître et de protéger. Les personnages que tu trouveras dans notre monde sont donc de deux natures : il y a ceux qui sont nés ici, parce qu’ils existent dans l’imaginaire collectif des humains. Tu pourrais bien y croiser Ulysse, Noé ou le roi Arthur. Et il y a ceux – encore très rares – qui, comme toi sont venus par accident ou après une longue initiation au basculement symbolique. Ce sont des avatars de consciences humaines qui ont trouvé les clés de notre monde et peuvent y mouvoir une représentation d’eux-mêmes, à la manière des dieux grecs ou égyptiens qui, dans votre monde, se mêlaient jadis de vos affaires matérielles. Il y a aussi, entre les deux, toute une galerie de personnages, qui ont réellement existé dans votre monde, mais qui existent aussi, ici, sous formes de légendes collectives, comme Archimède, Descartes, Galilée, Newton, Einstein ou plus récemment Stephen Hawking. Ils ont donc plusieurs modes d’existence, qui déploient les visions que vous avez pu avoir d’eux. Tu dois aussi comprendre autre chose : ce monde est une terre d’asile et d’archive pour tous les souvenirs de savoirs qui ont pu émerger, un jour, dans une conscience humaine, une terre d’ancrage pour qu’ils ne disparaissent pas. Ces souvenirs de savoirs sont donc bien, d’une certaine façon, réels. Ils ont été conçus un jour dans la conscience d’un savant, d’un journaliste, d’un artiste ou artisan, d’un auditeur de conférence ou d’un étudiant qui assistait à un cours d’université. Ils finissent tous par enrichir cette terre des Savoirs, se transformant lentement en humus sur lequel nous grandissons tous. Un humus sur lequel veillent les Gardiens, qui garantissent la pureté de ces expériences.
– Et où peut-on trouver de tels Gardiens ? lui demandai-je.
– Tu en as déjà trouvé un, ou plutôt une, rigola-t-elle. Je suis la Gardienne de la grotte de Chauvet. C’est moi qui cultive les souvenirs qui concernent directement cette grotte, depuis sa découverte. Tout ce qu’elle a pu susciter comme espoirs ou comme fascination. Veux-tu partager des mémoires avec moi ? »
Comme j’acquiesçai, elle m’invita à absorber une poignée d’humus frais et humide qui recouvrait le sol. Il était le résultat des pensées fermentées d’humains de mon monde, qui après avoir longtemps enquêté sur la grotte, après s’être longuement documentés et imprégnés de ce qu’elle était, avaient pu en condenser, sous différentes formes, un souvenir qui s’était peu à peu transformé, dans l’univers des idées, en humus fertile. La Gardienne cultivait cet humus pour les voyageurs de passage qui, comme moi, chercheraient à revivre à leur tour cette expérience de savoir.
J’hésitai malgré tout, encore perturbé par l’expérience désagréable que j’avais vécue à Nova Alexandrie quand je m’étais confronté, de façon prématurée et trop abrupte, aux souvenirs sanglants de la Révolution. J’en portai donc prudemment un peu à mes lèvres. Celui-ci avait un arrière-goût un peu salé. Terreux bien sûr, mais pas désagréable.
Des premières images, des pensées, se formèrent dans ma tête, à mesure que remontaient l’ensemble des souvenirs et des représentations que les humains avaient pu avoir de ce lieu. Des images mentales d’abord floues, décousues, puis de plus en plus nettes. Jusqu’à me replonger, d’un coup, dans ce souvenir aigu du 18 décembre 1994, où fut découverte, par un heureux hasard, ces premiers signes dessinés sur les parois de cette grotte enfouie dans les profondeurs de l’Ardèche.
Le souvenir vint à moi, comme les bribes d’un récit cristallisé dans la conscience de ses protagonistes. L’histoire s’imposait comme un film ou comme un roman qui aurait fait participer les cinq sens. Je le découvrais de l’intérieur de moi-même, tel un amnésique recouvrant par à-coups le fil d’une vie perdue. Un mélange de souvenirs et de mots écrits il y a des années par un journaliste qui en faisait le récit. Mélange altéré par la digestion progressive du temps, mais qui s’écrivait ainsi :
(…) Trois spéléologues amateurs s’attardent devant des amas de pierres. Chacun perçoit le léger souffle d’air qui s’en dégage. Ils s’approchent. Le premier s’appelle Jean-Marie Chauvet. C’est le gardien des grottes ornées de l’Ardèche. Les deux autres sont deux amis: Eliette Brunel et Christian Hillaire. Ils n’ont pas besoin de se concerter longtemps pour deviner ce que ce souffle signifie : il trahit un passage, caché au fond de la cavité qu’ils sont venus explorer, ce dimanche 18 décembre 1994, dans les falaises abruptes qui surplombent le cirque d’Estre, face à l’arche de pierre du Pont d’Arc qui enjambe les gorges de l’Ardèche. Des gorges qu’ils connaissent comme leur poche après tant d’années passées à en explorer la moindre anfractuosité. L’excitation monte. Malgré l’heure tardive, le trio dégage une chatière dans laquelle ils se faufilent l’un après l’autre. Lentement, ils progressent, jusqu’à ce qu’un gouffre obscur les oblige à rebrousser chemin, faute de matériel.
Ils retournent à leur camionnette et s’apprêtent à partir, quand ils se ravisent. La curiosité est décidément trop forte. Au diable la nuit qui tombe, ils s’équipent et retournent explorer ce boyau. Leur échelle souple les conduit dans une vaste salle parsemée d’ossements. Progressant prudemment au milieu des colonnes de calcite blanche et ocre, ils parcourent un réseau de galeries quand Eliette aperçoit, dans le faisceau de sa lampe frontale, deux traits tracés à l’ocre rouge. Puis, levant les yeux vers le plafond, un dessin de… mammouth. Le souffle coupé, les trois spéléologues balaient les parois de leurs torches. Et découvrent des dizaines de peintures, têtes de lion, bouquetins, ours, manifestement vieilles de plusieurs milliers d’années.
Ils y retournent dans la nuit, submergés d’émotion, pour découvrir encore d’autres dessins, dont une fresque immense mêlant chevaux, aurochs, bisons et rhinocéros. Ils s’y rendent à nouveau, le samedi suivant, veille de Noël, avec trois autres spéléologues, équipés d’appareils photo.
Jean-Marie Chauvet prévient alors la Direction régionale des affaires culturelles, qui dépêche aussitôt sur place un conseiller scientifique du Ministère de la Culture, Jean Clottes, spécialiste de l’art paléolithique. Ce dernier confirme le 29 décembre l’authenticité des œuvres : les traits présentent des marques incontestables d’érosion et de microcristallisations causées par les millénaires passées dans la grotte, qui sera classée aux Monuments historiques le 13 octobre 1995. (…)
Une partie du récit était inaccessible. Les mots, ou plutôt les images mentales directement formées à partir de ces mots, me parvenaient tronquées, perdues dans l’humus qui s’était en partie dégradé. Il me fallut me concentrer plus avant pour que de nouvelles bribes parvinssent de nouveau à ma conscience. Je compris que l’État avait acquis la grotte, en 1997, pour en confier l’année suivante l’étude à une équipe de scientifiques dirigée par Jean Clottes. Le souvenir, lentement, se retissa. Les mots du journaliste qui les avait écrits s’enchaînèrent à nouveau, comme s’ils retrouvaient une vitalité perdue. Le récit reprit forme en moi:
(…) Le souci des scientifiques est d’emblée d’éviter toute contamination : porte blindée, alarme et surveillance vidéo filtrent l’entrée. La grotte ne sera jamais ouverte au public, pour garder son état de conservation exceptionnel dû à l’effondrement du porche, il y a près de 22 000 ans, qui l’a complètement isolée. A l’intérieur, une succession de salles de plusieurs dizaines de mètres de long et de haut couvre une superficie totale d’environ 8500 m² (sur une longueur de 500 mètres), jonchée de plus de 4000 fragments osseux, essentiellement d’ours des cavernes (avec près de 200 crânes), mais aussi de canidé, hyène, renard, panthère, bouquetin, cerf, bison et cheval, mêlés aux vestiges laissés par les hommes lors de leurs différents passages : amas de charbons, silex taillés, sagaie en ivoire… Sur les parois, plus de 420 représentations animales, d’espèces pour la plupart redoutables : mammouths, rhinocéros laineux, ours et félins des cavernes, panthère des neiges, absents dans l’art pariétal retrouvé jusqu’alors, côtoient de plus habituels chevaux, aurochs, bisons et bouquetins.
Dans la première partie, appelée secteur rouge, les fresques sont à l’ocre rouge, accompagnées de panneaux recouverts d’un total de 450 empreintes de main. Dans la seconde partie, dite secteur noir, ce sont les gravures et les grands dessins au fusain, plus complexes, qui dominent, au réalisme époustouflant. Lutte entre rhinocéros, chasse d’un troupeau de bisons par des lions… l’artiste s’est appliqué à donner vie à l’ensemble, maniant l’ocre, l’hématite, l’argile teintée d’oxydes de fer pour les rouges, des charbons de bois pour les noirs, utilisés comme crayons ou réduits en poudre pour former un mélange épais appliqué au tampon, à la main ou au pinceau. Les contours sont raclés, des détails anatomiques surgravés. Un soin surprenant pour l’époque. Des datations sont effectuées, dont certaines au carbone 14. Elles mettent en évidence deux périodes d’occupation de la grotte : une première il y a 36 000 ans et une seconde il y a 30 000 à 31 000 ans. Une telle maîtrise à ces âges reculés remet en cause le savoir établi sur l’art pariétal, considéré jusque-là comme ayant évolué de façon progressive des premiers blocs grossièrement gravés de sexes féminins il y a entre 40 000 et 28 000 ans (période de l’Aurignacien) au réalisme photographique en fin de préhistoire, vers 12 000-10 000 ans, en passant par des stades intermédiaires comme à Lascaux, vers 18 000 ans. La perfection picturale de la « grotte Chauvet » détruit cette progression : l’art pariétal aurait été maîtrisé dès l’Aurignacien. Quand, dès lors, est-il apparu ? Pour les paléontologues, le mystère s’épaissit. (…)
Je fus alors envahi d’une émotion indescriptible. Et pour cause : ce n’était pas vraiment la mienne, mais celle qu’avaient ressentie les premiers scientifiques qui avaient exploré de leurs yeux ces dessins sur la pierre. Cette ancienne émotion avait imprimé la terre des Savoirs d’une empreinte désormais indélébile, comme fossilisée dans cet étrange substrat. Elle s’y mélangeait à celle que pouvaient exprimer à leur tour les chroniqueurs, écrivains et journalistes qui s’étaient replongés dans leur histoire pour la traduire en mots. Au milieu des sentiments qui émergeaient de cette gangue, une adresse électronique – celle du site internet officiel de la grotte – s’imposa subitement à moi : http://archeologie.culture.fr/chauvet/fr.
« Une adresse internet ? m’étonnai-je. Cela paraissait si incongru au milieu d’un souvenir.
– Vous aussi vous trouvez cela étrange ? répondit la Gardienne. Nous avons remarqué que les récits-souvenirs que nous recueillons dans l’humus s’appuient de plus en plus sur ce que vous appelez en effet, dans votre monde, l’internet. C’est une nouveauté à laquelle nous avons dû nous adapter. Nous avons dû comprendre ce qu’était ce réseau informatique, qui a d’ailleurs lui-même ses propres souvenirs et ses propres représentations, et établir des ponts avec lui. Heureusement, comme c’est un monde d’information et non de matière, il nous est naturellement familier. N’est-il pas, lui-aussi, un univers de projections qui traduit de simples impulsions électriques en concepts symboliques ? Nous avons vu, ces derniers cycles, des stèles s’ériger spontanément au milieu de l’humus. J’ignore pourquoi et comment elles poussent, car leur nature n’a rien à voir avec la paléontologie. Ce sont plutôt des formes hybrides de représentation, mi-humaine mi-informatique, qui prolifèrent depuis qu’est apparu ce que vous appelez dans votre monde « le web ». Elles apparaissent au milieu de l’humus, créant des racines qui établissent des connexions directes vers certaines adresses électroniques. Comme si des ponts s’établissaient naturellement entre le monde des expériences humaines et celui des circulations électriques. C’est très curieux. Leur étude mobilise de nombreux érudits. »
Tout en parlant, elle en dégagea une, qui émergeait du sol comme un champignon. Je n’aurais su dire si elle était minérale ou végétale. Sa texture était indéfinissable, comme formée d’une matière hybride qui tentait la fusion insolite de deux mondes. Quand je la touchai, elle s’illumina, connectant mon esprit au site internet de la grotte, dont je parcourus rapidement les pages.
Ce récit d’une découverte miraculeuse de cette grotte, dont j’avais revécu le souvenir, avait des saveurs aigres-douces. L’histoire conservée dans l’humus avait tout pour séduire : le hasard d’une découverte, un zeste d’aventure, le parfum puissant du passé, cette rencontre impromptue avec le témoignage d’un lointain ancêtre, l’émotion artistique de ces premiers dessins…
L’être humain se libérait de la perception immédiate des choses. Il reproduisait sur la roche des traits capables de faire jaillir le souvenir précis d’une scène de chasse, comme s’il la vivait à nouveau. Ou comme on la lui avait maintes fois racontée. Le souvenir, grâce à ces dessins laissés sur la roche, ne mourra plus avec lui… Comment ne pas y voir, déjà, les prémices lointaines de Nova Alexandrie et de cette terre des Savoirs? Qu’était-ce l’humus, si ce n’était les parois d’une grotte infinie sur laquelle tout pouvait directement s’inscrire ?
En communion avec ces anciens hommes, je ressentais le vertige qui avait saisi ces premiers narrateurs. Mais le récit que m’avait livré l’humus révélait, au fond, bien plus sur nous-mêmes que sur nos lointains ancêtres. Il était un témoignage de notre curiosité, qui nous poussait à explorer, malgré le danger, un conduit obscur dans la roche, avec pour seule promesse celle d’un territoire nouveau à découvrir. Les choix difficiles, aussi, que nous devions faire, entre le besoin de partager l’émotion ressentie face à des témoignages venus du fond des âges, et la nécessité de sauvegarder ces traces pour que d’autres, plus tard, en profitent à leur tour. La contradiction semblait insoluble : laisser tout le monde s’approcher de ces dessins, les toucher de ses propres doigts, les ferait rapidement disparaître. Or c’est cette rencontre physique, presque charnelle, qui donne justement à la présence de ces signes tout leur sens. Il en va donc de l’art pariétal comme de la physique quantique : toute mesure, toute observation directe de l’objet que l’on veut appréhender dans toute sa vérité, le dégrade irrémédiablement. Comme un souvenir qui se modifie et s’affaiblit à chaque rappel. Je comprenais au passage le sens de cette phrase que m’avait murmurée Camille : « Il est des œuvres qui ne prennent sens que dans leur version originale. »
Construire à grand frais un fac-similé pour le grand public paraissait presque dérisoire : comment comparer l’émotion ressentie face aux véritables pigments laissés par l’artiste, avec qui la communion se fait à travers les millénaires, et le sentiment factice ressenti face à ce qui n’en est, au fond, qu’une photocopie ? Mais comment faire autrement ? La grotte Chauvet est un cas d’école des contradictions insolubles que pose la démocratisation du savoir. Etait-ce pour cette même raison que l’Académie persistait, malgré ses valeurs de partage, à ne s’ouvrir qu’à une élite ? Voulait-elle justement éviter de n’être qu’un fac-similé de la pensée ?
Je reconnus néanmoins le plaisir qu’il y avait de contempler, même si c’était une reconstruction, ou à travers un écran, la puissance de ces premiers signes. Et, surtout, de chercher à en comprendre le sens. Car c’était bien, au fond, l’intention de ces premiers artistes de l’humanité : laisser un message qui serait compris par la postérité.
Mais qu’avaient vraiment voulu nous dire ces premiers hommes ? Et qui étaient-ils ? Comment en étaient-ils venus à produire une pensée et à vouloir en garder une trace ? Comment, en somme, avaient-ils commencé à donner vie à des symboles ? Ces dessins drainaient avec eux une chaîne presque infinie d’énigmes. Je ne les résoudrais pas seul. Il me fallait partir à la rencontre de ceux qui avaient consacré leur vie à les déchiffrer. Mais qui ? Et où les trouver ?
La bourse de cuir qui contenait mes Edelweiss se mit à dégager une faible chaleur. J’eus bientôt la surprise d’y voir pousser une petite tige ; un bourgeon annonçait l’éclosion prochaine d’une nouvelle fleur. Ainsi donc, ce qui servait dans ce monde de monnaie pouvait pousser spontanément ? Ou plutôt, quelque chose semblait provoquer et favoriser cette pousse. Quelque chose liée à l’expérience d’un savoir. Peut-être s’enrichissait-on, au sens propre, de ses nouvelles réflexions… Voilà qui donnait au moins l’assurance de toujours manger à sa faim, pour peu qu’on fût curieux. Dans cet univers de métaphore, il fallait donc se nourrir l’esprit pour gagner les moyens d’alimenter son corps.
Le soir tombait sur la terre des Savoirs. Malik avait prévu de dormir à la belle étoile, à la chaleur de ses chameaux, comme il en avait l’habitude. Il repartirait le lendemain, dès les premières lueurs de l’aube, vers la station de Cro-Magnon-Ville, les sacs remplis d’humus qu’il revendrait au marché. Toujours avare de mots, il me montra du doigt une auberge. Une masure rustique, tout en pierres et toit de chaume, au bord du chemin, rendez-vous des voyageurs de passage. Je poussai l’épaisse porte et me joignis aux marcheurs qui reposaient leurs pieds fatigués à la chaleur d’une grande cheminée. Après avoir demandé un vin chaud fruité, j’interrogeai à la volée : quelqu’un pourrait-il me guider vers un expert de l’art pariétal ?
La Gardienne m’avait évoqué la solidarité naturelle des chemineurs de savoirs. Elle n’avait pas menti, car j’obtins très vite un nom : Jean Clottes, préhistorien français et grand spécialiste de « l’art de pierre », celui-là même qui avait authentifié la grotte de Chauvet. Un sentier de chèvres, me dit-on, menait en haut d’une falaise de calcaire escarpée, au souvenir de plusieurs conférences qu’il avait données. Je m’y rendrai le lendemain. Pour l’heure, je réclamai un lit à l’aubergiste. Et m’effondrai dessus comme une masse.
IV.10 – Police des Idées
Je me suis réveillé en sursaut. Mes fesses reposaient sur un fauteuil qui appartenait de toute évidence au monde matériel dont j’étais resté familier. Perce-neige dévorait une omelette sur la petite table de sa chambre. Fébrile, je commençai à lui raconter tout ce que j’avais vécu : le voyage en aérobus, le périple à dos de chameau dans les terres paléontologiques… Elle m’arrêta très vite. Elle n’avait pas besoin de mots : elle savait déjà parfaitement tout ce que j’avais perçu et ressenti, grâce à la connexion intime qui s’était établie entre nos deux esprits. Aucun récit, aucune succession quelconque de mots, ne pourrait jamais avoir la richesse de l’expérience partagée qu’elle avait vécue à travers moi.
Son cerveau conscient était la passerelle qui me donnait accès à ce monde. C’était lui qui transformait, grâce à ses réseaux exceptionnels, les impulsions électriques qu’il recevait d’Alice, en ressentis, en émotions et en affects, en véritables images mentales amplifiées par le brin. Inversement, Perce-neige traduisait en retour mes images mentales, toujours grâce au brin, en impulsions électriques qu’Alice pouvait interpréter et intégrer dans l’univers de Nova Alexandrie.
Perce-neige n’assurait-elle qu’une simple connexion vers la terre des Savoirs ? Se contentait-elle d’ouvrir la porte pour m’y laisser entrer? J’avais peine à croire qu’au sein d’une telle fusion elle ne prît aucune part dans les émotions que je ressentais, et donc dans les décisions que je prenais. Je me souvins de ce principe cardinal de la physique quantique comme des sciences humaines : toute observation modifie radicalement le déroulement même de l’expérience. Il n’est jamais possible d’observer un système sans le perturber d’une façon ou d’une autre. De fait, nos ego devenaient indiscernables l’un de l’autre. Et je ne pouvais dire quelle était la part que prenait Perce-neige dans toutes les décisions que je prenais et celle qui ne relevait que de moi. Cela semblait néanmoins plus vrai dans un sens que dans l’autre. Car alors que Perce-neige savait tout de mon ressenti et naviguait dans mon esprit à sa guise, j’avais beaucoup plus de difficulté à accéder au sien. Je n’avais pas développé, comme elle, la capacité de vivre simultanément deux expériences différentes, de faire vivre en moi deux consciences séparées. Je n’avais donc qu’une vision vague de ce que Perce-neige avait vécu de son côté. Elle me raconta qu’elle s’était trouvé une chambre dans une auberge sur le port. Elle avait besoin, m’expliqua-t-elle, de cette animation bruyante, de cette communication permanente avec de nouveaux esprits. Je compris alors combien nous étions différents elle et moi, et combien nos deux quêtes divergeaient. Je recherchais la solitude, le cheminement contemplatif, la compréhension presque égoïste de l’Univers. Elle était au contraire le lien, l’interaction permanente entre les êtres. Elle multipliait donc les rencontres, écoutant les marins qui débarquaient ou ceux qui, sur les quais, s’apprêtaient à partir pour un long voyage. Elle faisait ce qu’elle avait appris à faire depuis toujours : se mettre à la place de l’autre, saisir ses moindres sentiments, ses désirs et ses craintes, appréhender à la fois le moteur et le carburant qui animaient chacune des vies qu’elle croisait sur sa route. Et elle y excellait autant dans le monde des humains que dans celui des Idées. Elle ne fit d’ailleurs bientôt plus aucune distinction entre les deux, considérant les êtres de Nova Alexandrie, dont le statut nous paraissait obscur, de la même manière que ceux de la Citadelle. Elle percevait en chacun le même effarement face au mystère profond de l’existence, et la même soif d’y trouver un sens. La biologie n’est guère différente, me disait-elle souvent, de la pensée qu’elle engendre.
Elle ressentait de l’affection pour tous les Nouveaux Alexandrins. Ceux qui avaient pignon sur rue et qui débattaient à grand train, comme ceux qui mendiaient des quignons d’arguments pour attirer un regard. Tous avaient une même soif d’exister. Et tous avaient un même droit d’élire domicile, pour autant qu’ils en accordassent aussi ce droit aux autres. Perce-neige ne vit que très exceptionnellement s’exprimer l’intolérance, le racisme ou la conviction qu’une idée, quelle qu’elle fût, pût être par essence supérieure aux autres. Ces conceptions étaient sans ménagement rejetées hors les murs, condamnées à errer comme des fantômes dans les déserts les plus reculés de la terre des Savoirs, où il n’était guère prudent de s’aventurer. La ville avait fondé son existence sur un cosmopolitisme radical, sur la recherche perpétuelle d’un dialogue avec ce qui était autre. Elle se voulait carrefour de tous les savoirs, de toutes les idées, pour engendrer de nouvelles visions de la rencontre improbable de deux voyageurs confrontant leur odyssée. C’était en tous les cas le récit fondateur qui structurait la cité. Or qui mieux que Perce-neige pouvait s’intégrer dans un tel monde ? Camille lui en avait inculqué dès son enfance toutes les valeurs. Il lui en avait donné toutes les clés. Mais jamais il n’avait évoqué ces agents dont elle percevait furtivement la présence, dont elle fuyait instinctivement le contact, et qu’on lui présenta comme la nouvelle police des Idées.
Police des Idées ? D’une conversation à l’autre, elle apprit que cette structure était récente. Elle était apparue il y a quelques cycles. Nul ne sut d’ailleurs lui dire à la suite de quel décret. D’abord très discrète, sa présence se faisait d’année en année plus ostentatoire. Qui l’avait créée ? Le Conseil sans doute, aréopage d’Érudits qui ordonnait la cité. Mais pourquoi ? Personne ne voyait l’utilité d’une telle police. Pourquoi devrait-on craindre une idée ? Certes, il était parfois nécessaire de neutraliser celles qui pouvaient menacer l’intégrité de la cité, aussi des concepts comme la zizanie, l’eugénisme ou la torture étaient-ils assujettis à un strict contrôle quand ils prétendaient entrer en ces murs. Mais il n’y avait jamais eu jusque-là besoin d’une quelconque police pour cela : des attroupements spontanés se créaient très vite pour reconduire poliment mais fermement ces persona non grata vers le désert.
Non, il était clair que cette police avait une tout autre fonction. Elle se focalisait sur l’identification et le contrôle des esprits étrangers. Elle traquait essentiellement ceux qui n’avaient pas reçu l’autorisation formelle de faire partie de ce monde. Comme Perce-neige ou moi, qui n’y avait accédé que par accident, sans le long processus d’intégration qui transformait un esprit novice en vrai érudit. De fait, chacun ici convenait qu’il commençait à y avoir de moins en moins de rebelles. Les esprits qui parvenaient à traverser les limbes avaient de plus en plus tendance à présenter le même profil : âgé, attaché à la pureté inaltérable des concepts, et tolérant de moins en moins les idées les plus marginales, celles qui faisaient auparavant le sel des faubourgs.
« Nova Alexandrie s’embourgeoise, avait pesté un vieux loup de mer assis sur le quai, avec qui Perce-neige avait engagé comme avec tant d’autres la conversation. Oh, les débats sont toujours aussi vifs, croyez-moi jeune fille, mais le ton se fait plus dur envers les iconoclastes ou la canaille qui égayait autrefois les ruelles du vieux port.
– Vous voulez dire qu’on les arrête ?
– Cela ne va pas jusque-là, dieu merci, nous ne sommes pas encore tombés aussi bas. Du moins je l’espère. Mais, voyez-vous, cela fait des cycles que j’habite ce quartier, et je vois bien que l’atmosphère a changé. Je me souviens qu’on se ruait, avant, sur une idée nouvelle comme des galants sur une demoiselle – si je peux me permettre. Maintenant, on se méfie des concepts trop différents. On les accepte, mais on ne s’en approche qu’avec prudence, comme si l’on avait peur d’être – comment dirais-je – contaminé. J’ai vu pour la première fois, il y a tout juste un cycle, quelques jeunes bougres dormir dehors. De jeunes chemineurs de l’au-delà qui avaient peut-être forcé le passage, ou alors des gens d’ici qui avaient traversé le désert et passé en douce les remparts. Peu importe… Jamais je n’avais vu ça. Avant, même s’ils avaient senti la vermine, quelqu’un aurait aussitôt ouvert sa porte pour les accueillir. Pas forcément par sympathie, juste par humanité pour une idée quelle qu’elle soit. Jamais on aurait laissé quelqu’un à la rue, jamais ! Je vois aussi qu’on restreint les entrées et les sorties de Nova Alexandrie. Quelle avanie ! Comme si on pouvait empêcher les idées de voyager… Celles qui veulent vraiment circuler trouvent toujours un moyen. Je ne comprends pas qui donne des consignes aussi stupides, d’où ça vient ni à quoi ça rime. Mais j’ai l’impression que ça descend du plus haut niveau. »
Il avait levé les yeux en l’air, d’un air entendu, avant de poursuivre.
« Le Conseil prend de plus en plus d’importance. Avant, personne ne se souciait vraiment de lui. La Cité fonctionnait, c’était tout. Mais plus ça va, plus il prétend régenter notre vie. Nous dire où vivre, avec qui aller. On ne sait même pas qui ils sont. C’est une excroissance qui est apparue et qui se développe. Moi, je dis que ça ressemble à un cancer. Enfin bon, je vous dis ça parce que je vois bien que vous n’êtes pas là pour chercher querelle… »
Perce-neige avait pris congé de cet homme, profondément troublée. Son père lui avait toujours présenté Nova Alexandrie comme une cité parfaite, où toutes les Idées pouvaient librement se confronter l’une à l’autre. Jamais il n’avait évoqué la présence d’un Conseil, et encore moins d’une police.
Sa tête commençait à lui faire mal. Elle avait besoin de se reposer un peu. Son cerveau ne pouvait supporter une connexion permanente. Nous rebasculâmes donc dans sa chambre aux murs blancs. Mais il me fallut bien plus de temps qu’elle pour retrouver mes esprits. Elle partagea avec moi son omelette, que je dévorai à mon tour. La faim qui me tenaillait le corps avait dans le monde matériel quelque chose de plus puissant que dans la terre des Savoirs. La matière pouvait y imposer des contraintes exorbitantes : que je cesse de manger, et je mourrai rapidement, quelle que soit mon opinion sur ce sujet. Elle avait donc un impact sur l’émotion bien plus redoutable et immédiat que les modulations de l’esprit. C’était un point que nous ne devions pas négliger : ne jamais oublier que si l’esprit peut voguer vers des espaces infinis, il reste contraint par la réalité matérielle d’un corps dont il ne peut se soustraire et sur lequel il doit veiller.
Quels étaient les rapports entre la réalité matérielle et celle des idées ? C’était un point qu’il me fallait creuser. Plus tard, me dis-je. Impatients de retourner dans la terre des Savoirs, nous nous reconnectâmes très vite.
Je me réveillai directement, cette fois, dans la chambre d’auberge, sous les piaillements d’une bande d’étourneaux. La salle à manger était pleine du brouhaha des chemineurs qui préparaient leur randonnée du jour. Comme j’avais encore faim (ou était-ce une pure création de mon esprit?), j’avalai quelques saucisses recouvertes d’un gruau épais. Je gratifiai l’aubergiste d’un edelweiss et je me mis en route. Une brise fraîche m’accueillit sur le perron. J’entamai alors ma marche vers la falaise de Jean Clottes.
On ne m’avait pas menti : le chemin qui menait aux souvenirs de ses conférences était bien un sentier de chèvres. De mouflons, plutôt, tant la pente était raide et virait, par moments, à l’escalade sur des aplombs imposants. Heureusement, je n’avais pas le vertige. Mais je mesurais mon imprudence d’être parti seul. L’effort physique était violent ; je tirais de grandes gorgées d’eau de ma gourde. Le silence qui régnait sur ces falaises était intimidant.
Mon pied dérapa sur une pierre. Je chutai sur deux mètres et j’atterris dans un buisson. Plus de peur que de mal ? Pas vraiment. Car ma cheville et mon dos étaient au supplice. Je compris très vite que je ne pourrais pas m’extraire de cette corniche où j’avais chuté, sans devoir escalader la paroi abrupte. Elle ne faisait que quelques mètres, mais la douleur m’empêchait de me relever. J’étais bêtement pris au piège.
La fragilité de l’humain, confronté à la violence sauvage, m’apparut d’un coup plus clairement. Il ne s’agissait plus de théorie, de dissertation savante, mais d’une lutte désormais réelle pour ma survie. Combien d’homo sapiens étaient morts ainsi, durant des millénaires, dans une solitude extrême, d’une mauvaise chute qui les avait livrés aux bêtes. Je mesurais le chemin parcouru pour s’affranchir, grâce à la technologie, de cette condition effrayante d’hommes nus livrés à une nature hostile. Le premier réconfort qu’ils avaient trouvé dans le feu qui les protégeait la nuit. L’assurance que leur avaient donnée les premières armes façonnées dans le bois et la pierre. Pour survivre quelques jours de plus.
J’appelais à l’aide. En vain. Je n’avais pour seule réponse que les cercles lents que dessinaient au-dessus de moi de sombres oiseaux. Communion avec la nature ? Foutaise ! J’écumais de rage. L’instinct de survie m’imposait sa violence.
Mourrait-on vraiment dans ce monde ? Et mourrait-on alors physiquement, dans le monde réel ? Je n’eus pas l’occasion de trancher prématurément ce débat, car des chemineurs entendirent enfin mes appels. Ils m’extirpèrent tant bien que mal de ma corniche à l’aide de cordages. L’un d’eux ayant quelques notions de médecine, il m’appliqua des onguents, banda ma cheville et resta quelques heures avec moi. Il me conseilla de passer la nuit au chaud dans un abri de berger qu’il avait trouvé et où il me laissa en sécurité.
Le lendemain, les onguents avaient fait leur effet : je ne ressentais plus qu’une sourde douleur, certes inconfortable mais assez faible pour que je puisse marcher. J’avançais lentement, néanmoins, pour ne pas martyriser davantage mes chevilles. Ces mésaventures m’avaient au moins apporté quelque avantage : je remarquai que de nouveaux edelweiss avaient sorti leur tige du terreau de ma bourse. Signe qu’une expérience décisive avait été acquise.
Le sentier bifurqua vers une petite clairière. J’y trouvai un homme assis vêtu d’une tunique à capuche qui lui donnait l’allure d’un moine. A côté de lui, une nouvelle stèle s’enfonçait dans le sol. Elle était couverte d’inscriptions que je n’eus aucun mal à déchiffrer. J’absorbai un peu d’humus pour prendre connaissance des souvenirs associés et entrer en connexion avec le chemineur humain qui les avaient figés. La première image mentale m’éclaira sur la nature de ce qui avait fertilisé ce sol. Une date s’imprima dans mon esprit : 19 septembre 2013. Et un lieu : la Médiathèque de Narbonne, dans le sud de la France. Je compris qu’il s’agissait d’un souvenir lié à une conférence sur l’art rupestre dans le monde, donnée ce jour-là par Jean Clottes, et à laquelle la stèle, pour peu qu’on la touchât, donnait encore accès.
Les interrogations, figées dans l’humus par le chemineur qui, dans mon monde, avait découvert cette vidéo au fil de ses recherches, s’imprimèrent dans ma tête :
(…) Qu’est-ce que l’art pariétal ? Où le trouve-t-on dans le monde ? A quelles périodes de notre histoire correspond-il ? Et, surtout, que nous dit-il ? (…)
Du doigt, j’activai le lien qui était inscrit sur la stèle : https://www.youtube.com/watch?v=JJH8uYOHyeU
Enregistrés dans les saveurs terreuses de l’humus, les enseignements qu’en avaient tirés le chemineur s’exhalaient lentement :
(…) Le préhistorien tord le cou à des clichés tenaces : l’art rupestre n’est pas localisé que dans quelques grottes mais dans l’ensemble du monde. On en trouve, nous raconte-t-il, à des époques très différentes, les plus anciennes traces se situant en Australie, entre 40 000 et 50 000 ans. Et sans doute l’art le plus ancien se trouve-t-il en Afrique, puisque c’est de là que vient, à l’origine, Homo sapiens.
En Europe, c’est pendant la dernière glaciation qu’il fleurit, dans des grottes qu’Homo sapiens quittera quand le climat se radoucira. Les peintures sont réalisées dans de simples abris éclairés par la lumière du jour. En Scandinavie, ce sont des milliers de sites qui sont ainsi gravés. En France, Espagne et Portugal un art schématique apparaît, fait de figures géométriques. En Afrique du Nord et du Sud, c’est par dizaines de milliers que les sites se comptent. Avec des gravures qui sont parfois très voisines de celles que l’on retrouve en Europe… (…)
Ainsi donc, ces stèles servaient de balise vers notre internet, et digéraient la connaissance qu’un chemineur avait lui-même acquise en cliquant sur l’hyperlien.
Je n’eus pas le temps de fureter plus loin : la connexion s’arrêta. La stèle se désagrégea ainsi que tout l’univers dans lequel j’évoluais. Perce-neige était épuisée par l’effort mental qu’elle devait faire à chacune de nos incursions. Elle s’était endormie de fatigue, recroquevillée en position foetale. C’est alors que je réalisai l’énergie qu’elle devait déployer à chaque fois. Moi-même, je ressentais comme une torpeur qui m’assommait. J’étais vidé, sans trop savoir s’il s’agissait de ma propre fatigue ou celle que Perce-neige me communiquait encore. Ce monde ne s’offrait pas sans peine, malgré la connexion privilégiée que nous avions avec lui. Le teint de mon amie avait pâli. Ses yeux étaient cernés. Exalté par la découverte de ce nouveau monde, je n’avais pas voulu voir l’effort surhumain qu’elle accomplissait, depuis des jours, pour m’y faire accoster. Je posai sur ses cheveux emmêlés un baiser furtif et lui remontai le drap pour qu’elle ne prît pas froid. Elle répondit d’un murmure. Ses jambes tressaillirent. C’était mon tour de m’occuper d’elle. Je suis resté ainsi, toute la nuit, à veiller les courbes discrètes que son corps dessinait sous le drap.
IV.11- Vol retour
Après plusieurs semaines d’observation, les médecins de Bio-Insights estimèrent que la greffe cérébrale avait bien prise et que Perce-neige pouvait reprendre une vie normale, si tant est que ce fût désormais possible. Nous décidâmes donc, d’un commun accord, de rentrer en France. Non que le pays des caribous fût désagréable. Mais la perspective d’un vrai camembert ou d’un bon roquefort, savouré sur une baguette de pain frais et arrosé d’un vin de pays commençait à nous manquer. Les quelques employeurs que j’avais conservés, malgré ma disponibilité en dents de scie, commençaient par ailleurs à manifester leur désir de me voir reprendre plus sérieusement le travail. Il n’était jamais très bon, dans mon métier, de se faire oublier trop longtemps.
Nous prîmes donc deux places en promotion sur un vol pour Paris. Charles aurait aimé nous offrir la première classe, mais depuis la mort de Cornélia les actionnaires avaient aiguisé leurs canines, et ils taillaient sans état d’âme dans les moindres dépenses. Charles ne voulait pas non plus attirer trop l’attention sur notre passage en leurs murs. Ce programme devait rester le plus secret possible.
Le vol fut homérique. Car Perce-neige eut bien sûr une nouvelle crise d’angoisse au décollage. Mais la présence du brin dans son cerveau décuplait désormais ses capacités de connexion empathique. Ce ne fut donc pas les quelques sièges qui nous entouraient, mais l’avion entier, qui fut traversé de vagues de panique, d’une ampleur telle qu’elles laissaient les hôtesses complètement démunies. Des passagers certifièrent avoir vu un réacteur en flammes. Une hôtesse elle-même eut de sérieux doutes. Et les pilotes vérifièrent plusieurs fois les différents capteurs, ayant peine à croire qu’ils puissent afficher des conditions normales de vol tant ils sentaient bien que quelque chose ne tournait pas rond sur cet avion. Le calme revint quand Perce-neige s’endormit. Je fis de mon mieux pour que son sommeil – heureusement sans rêve violent – dure le plus longtemps possible. Mais je ne pus éviter un nouveau vent de panique à l’atterrissage. Ce vol restera sans doute dans la mémoire de l’équipage comme un énigmatique moment d’hystérie collective, un cas d’école pour des générations de psychologues des foules. L’arrivée sur la piste d’un camion de pompiers, toute sirène hurlante, me confirma qu’au sein-même du contrôle aérien de sérieux doutes s’étaient insinués quant à la fiabilité de l’appareil ou de son équipage.
Une fois l’avion immobilisé, l’atmosphère se détendit cependant très vite. Perce-neige était ravie de retrouver l’odeur indéfinissable du tarmac français. Et moi de voir qu’elle retrouvait des couleurs. Nous récupérâmes nos bagages et prîmes la décision raisonnable de poursuivre cette odyssée en train. Les passagers du vol en correspondance AF7542, à destination de Montpellier, ne surent jamais à quel cauchemar ils avaient échappé.
Fourbus, nous prîmes un taxi pour rentrer. Après avoir raccompagné Perce-neige à son appartement, je pus enfin m’affaler sur le canapé-lit de mon studio. Rien n’avait bougé depuis mon départ ; juste une vague odeur de moisi et quelques traces filamenteuses de champignons couvrant l’assiette que j’avais oubliée dans l’évier. Je résolus de la laver… le lendemain, et j’ouvris plutôt la fenêtre pour aérer la pièce. Je passai la soirée à regarder des séries pour me vider l’esprit. Je me sentais seul à présent sans Perce-neige. Comme s’il me manquait une partie de moi-même. Une sensation que je n’avais jamais ressentie aussi fortement jusque-là. C’est alors que je remarquai cette chose étrange : bien qu’il me fût arrivé, dans Nova Alexandrie, de cheminer seul, je n’y avais jamais vraiment ressenti l’absence de Perce-neige. Elle avait toujours continué à faire partie de moi, diffusant à chaque instant sa présence discrète. Sans doute était-ce dû à la connexion qu’elle établissait en permanence entre cet univers et moi. Un lien physique nous y unissait, dont la destruction m’aurait aussitôt expulsé de ce monde. Mais ici, dans cet univers de matière, ce lien était rompu. Rien ne m’unissait plus à elle, si ce n’était la force de représentation de mon esprit, qui continuait à projeter sa présence évanescente en moi. Je ressentais un manque, quasi-physique, j’en avais mal au ventre. Des bouffées de chaleur montaient par vagues. Je suais. Mon cerveau me suppliait de rétablir la connexion. Chaque passage vers Nova Alexandrie, chaque excursion dans la terre des Savoirs, était comme un shoot d’héroïne, une vague de plaisir qui excitait directement l’ensemble de mes neurones, pour me laisser au retour aussi démuni qu’un amant éconduit. J’aurais tout donné, ce soir-là, pour dormir dans les bras de mon amie.
IV.12 – Retrouvailles
Je repris quelques jours plus tard le chemin vers la Citadelle. J’avais besoin de retrouver ses murs, son atmosphère studieuse et confiante. De prendre des nouvelles, aussi, de mes amis. D’Iris, surtout, qui avait tenu sa promesse de ne rien révéler de nos aventures.
Maurice parut enchanté de me revoir. A sa manière bien sûr, bougonne et pudique. Il s’était inquiété, m’avoua-t-il. Il avait perçu mon angoisse, lors de mon départ et avait soupçonné de gros ennuis. Il avait tenté de s’informer, avait demandé autour de lui où j’étais allé et quels étaient mes projets, sans obtenir de réponse. Pour me faire pardonner, je lui offris une bouteille d’alcool de noix dont je le savais friand. A Montréal, j’avais aussi acheté pour Amako des étoffes inuites. Je savais qu’elles lui feraient plaisir, lui qui était si curieux de cultures autochtones. Nous discutâmes longuement tous deux, dans la bibliothèque, de ces peuples du grand nord qui perdaient leurs racines.
Je ne pus rester hélas que quelques jours : il fallait bien que je m’assurasse quelques revenus ou, tout au moins, que je préservasse ma capacité à en conserver quelques-uns. Mon statut de journaliste indépendant m’offrait certes une grande liberté, et mes articles étaient plutôt appréciés, mais je n’étais pas naïf : un enquêteur trop souvent aux abonnés absents intéresse peu les rédacteurs en chef. Je fis donc quelques efforts pour réactiver mes réseaux professionnels, prendre des nouvelles des différentes rédactions où j’avais mes habitudes et engranger quelques commandes qui me feraient vivre chichement quelques mois de plus. Je n’avais fort heureusement aucun appétit pour le luxe. J’aurais aimé pouvoir rester à demeure entre les murs de la Citadelle. Mais celle-ci, malgré son très haut degré d’autonomie, n’avait pas les moyens de subvenir aux besoins de tous ses pensionnaires. Elle pouvait faire vivre, dans des conditions spartiates, quelques Maîtres, élèves et personnels d’entretien, ce qui était déjà fort remarquable. Mais pour continuer à accueillir de nouveaux invités, elle avait besoin comme toute institution d’argent frais. Ceux qui avaient la possibilité d’exercer une activité hors-les-murs étaient donc encouragés à le faire, la Citadelle s’appuyant sur la générosité de ses membres les plus fortunés. De plus, il fallait l’avouer sans fausse pudeur, la mort de Cornélia avait dangereusement déséquilibré ses ressources.
Mes séjours se refirent néanmoins plus fréquents. Je m’y sentais, chaque fois davantage, à nouveau chez moi. Les disparitions successives de Cornélia, puis de Camille et des autres Maîtres, y subissaient comme en tout autre lieu l’usure inéluctable de l’habitude, puis de l’oubli. La passion qu’exprimait chacun à échanger ses idées avait repris le dessus. La morosité, le désarroi, qui avaient un temps envahi nos âmes troublées, s’étaient lentement évaporés. Les repas retrouvaient l’animation d’avant, dominés par la verve et l’appétit de Rablais qui n’avait renoncé en rien à ses extravagances. L’insouciance repoussait comme une herbe vivace, reprenant possession des terres au printemps après la torpeur froide de l’hiver.
Ma venue suscitait à chaque fois un attroupement spontané et des hourras de joie dont je compris vite l’origine : j’étais le plus souvent accompagné de Perce-neige, qui s’était à son tour prise d’affection pour cette communauté de l’esprit. Il était évident, cependant, qu’Isaac se méfiait d’elle. Et qu’il communiquait cette défiance au cercle des vieux Érudits dont il était le centre. Perce-neige ressentait une hostilité anxieuse qu’elle avait – pour une fois – grand mal à apaiser. Isaac ne l’aimait pas. Cela me parut en soi, bien qu’absurde, une prouesse extraordinaire : il était donc possible de rester insensible à son empathie ? « Ce n’est pas à un vieux singe qu’on apprend à faire des grimaces », ai-je une fois entendu maugréer le vieux Maître. Même s’il était loin d’avoir les aptitudes compassionnelles de Perce-neige, il connaissait en théorie l’ensemble des techniques sur lesquelles reposait son art. Mon amie le savait et ne fit jamais l’erreur de les utiliser ouvertement envers lui. Mais il y avait un obstacle de plus, qui compliquait ses tentatives de se faire, sinon aimer, au moins apprécier de lui : Perce-neige avait rapidement diagnostiqué Isaac comme un autiste intelligent, de ceux que l’on nomme les autistes Asperger. Il en avait toutes les caractéristiques : une intelligence très supérieure à la moyenne – on pouvait aisément le qualifier de surdoué – mais une difficulté à suivre les méandres de la psyché humaine, une incapacité à se mettre véritablement à la place de l’autre, à s’abandonner dans une connexion intime, et une intransigeance que nous n’hésitions pas à qualifier de psychorigide. Face à lui, Perce-neige se heurtait à un mur qu’elle entreprit d’éroder lentement, comme le vent arase avec le temps les reliefs montagneux.
Camille était un sujet tabou. Isaac finit par avouer qu’il s’était violemment disputé avec lui, quelques jours avant sa disparition. Mais que s’étaient-ils dits ? Camille avait-il indiqué s’il comptait partir, pourquoi et vers où ? Et qu’en était-il des autres Érudits qui avaient à leur tour quitté les lieux ? Isaac se contentait de répondre qu’il ne savait rien de tout cela, que la Citadelle n’était ni une secte ni une prison, et que chacun avait bien le droit de la quitter sans avoir en aucune manière à se justifier. Personne, de toute façon, ne persista à l’interroger là-dessus. Du reste, étaient-ce nos affaires ? La Citadelle était un lieu de liberté, où chacun venait et repartait à sa guise. Seule nous importait cette joie d’y débattre entre tous ceux qui avaient fait le choix de rester.
Cette camaraderie retrouvée à la Citadelle ne m’avait pas fait oublier pour autant Nova Alexandrie. Au contraire : je ne percevais que trop bien en quoi ces deux mondes étaient complémentaires. Dans l’un je construisais des liens directs, physiques et matériels avec des amoureux du savoir ; dans l’autre je naviguais dans les dimensions infinies de l’esprit humain, de ses projections et de sa conscience. Nova Alexandrie était une représentation idéalisée et démultipliée de l’Académie, affranchie des limitations de la matière, mais dépourvue en contrepartie de sa puissance effectrice : parce que tout y était en quelque sorte possible, Nova Alexandrie était un espace de jeu pour la pensée, mais il ne pouvait atteindre la force émotionnelle, la capacité réalisatrice du monde matériel.
Perce-neige et moi, nous avions trouvé à quelques kilomètres de la Citadelle une colline boisée de pins, au sommet de laquelle le réseau téléphonique mobile était miraculeusement suffisant pour accéder à internet. Nous y avions construit un abri de fortune. Quelques planches clouées sur un arbre avaient établi notre cabane au milieu de la pinède, comme en rêvent les enfants. Elle nous servait d’abri pour accéder en toute discrétion à Nova Alexandrie, sans utiliser la connexion satellitaire de la Citadelle. Nous en parlions, elle et moi, comme de notre Refuge.
Nos escapades suscitaient quelques jalousies à mon égard. Car en quelques mois, Perce-neige était devenue la pensionnaire la plus populaire de la Citadelle. Aussi bien chez les hommes, qui ne pouvaient s’empêcher de tomber, comme moi, dans le puits gravitationnel de son pouvoir d’attraction, que chez les femmes, séduites à leur tour par l’empathie exceptionnelle qu’elle savait leur manifester. Si elle avait eu des ambitions politiques, elle aurait sans difficulté accédé, avec de tels pouvoirs, aux plus hautes fonctions. L’idée était cependant absurde, car si elle avait aspiré à un quelconque pouvoir, elle aurait justement perdu ce qui la rendait exceptionnelle : cette bienveillance presque ingénue qu’elle dégageait spontanément. Elle n’était cependant pas naïve. Elle percevait clairement les intentions des autres, y compris les desseins les plus contestables. Elle soulevait juste la poussière noire et collante qui pouvait entacher les idéaux dont nous nous prévalions. Car nous n’étions ni des dieux ni des saints. Il nous arrivait d’être orgueilleux, mesquins, jaloux, satisfaits d’une victoire sur l’autre, cherchant la renommée ou la reconnaissance du groupe. Mais elle se refusait toujours de nous juger, respectant à la lettre la consigne gravée sur le fronton de l’Académie. Un jour, elle m’expliqua qu’elle avait appris à dissoudre les sentiments négatifs qu’elle pouvait éprouver dans un océan d’amour dont elle avait eu la chance de découvrir en elle la source. Je lui trouvai alors des airs messianiques. Sans doute un mystique de Nazareth avait-il, quelque deux mille ans plus tôt, exercé la même fascination par des aptitudes similaires. Puisse-t-elle mieux finir, ironisai-je au fond de moi. Je ne pouvais prévoir la force avec laquelle cette allégorie biblique allait plus tard s’exprimer.
Certaines de ses paroles avaient déjà entre nous valeur d’Évangiles. Par sa seule présence, elle apaisait les conflits et réveillait cette soif d’idéal qui avait motivé notre venue entre ces murs, cette ambition de construire ensemble une utopie si forte qu’elle accoucherait d’une réalité bienveillante. Bien sûr, nous n’étions pas stupides. Les séminaires d’histoire rappelaient, à qui l’aurait oublié, dans quels égarements de nombreuses utopies avaient régulièrement sombré. Du christianisme au communisme, les marchands de bons sentiments avaient abondamment nourri les appétits de massacres. Serions-nous différents ? Si nous le croyions, c’était parce que l’utopie que nous voulions construire entendait s’appuyer sur le libre savoir, sur la confrontation incessante des idées et des concepts, et non sur l’imposition, par quelque moyen que ce fût, d’un dogme quelconque. Savoirs et intelligence d’un côté, humanisme et bienveillance de l’autre : chacun de ces deux idéaux agissait envers l’autre comme un contre-pouvoir. Et des deux réunis émergeait un sens nouveau, une vision sereine qui calmait cette angoisse pascalienne face au silence des espaces infinis. Il nous appartenait de concevoir la musique de ce monde. De composer ensemble la symphonie qui justifierait à nous-mêmes notre propre existence. Et armés de cette foi laïque, nous nous sentions presque invincibles.
La Citadelle elle-même était une transposition matérielle de cette spiritualité du savoir. Nous nous y sentions vraiment égaux, sans distinction d’aucune sorte. Certains venaient de riches familles bourgeoises, d’autres ne possédaient que leurs rêves et leurs idées. Mais tous vivaient ici dans une chambre similaire, partageaient le même repas, acceptaient de n’y être considérés que sur la seule valeur des arguments qu’ils exprimaient. En venant à la Citadelle, nous étions assurés d’avoir un toit et de manger à notre faim. Nous pouvions dès lors nous consacrer pleinement au projet intellectuel qui nous animait. Certains avaient pour ambition d’écrire un livre, une thèse complexe ou une grande épopée littéraire. D’autres étaient musiciens, peintres, sculpteurs. D’autres encore cherchaient juste à figer d’une quelconque façon un bonheur évanescent. Chacun avait une voie à proposer. Tous assemblaient à leur guise des briques de savoirs pour construire leur propre monument ou leur propre église. Et nous allions d’un temple à l’autre, comme des touristes de l’esprit à la recherche d’un perpétuel émerveillement. Chacun y développait en toute liberté ses propres raisonnements. Mais la Citadelle se montrait aussi intraitable que Nova Alexandrie sur les valeurs qui garantissaient à tous cette liberté : le respect du débat argumenté, l’écoute bienveillante des autres formes de savoir, et surtout un humanisme serein, qui voyait en l’homme des possibilités infinies d’amendement et de maîtrise de son destin. Nul ne venait à la Citadelle s’il n’avait cette certitude que chacun forge en lui-même le sens qu’il donne à son existence, et cette foi que tout être humain garde la possibilité, jusqu’à son dernier souffle, de s’élever et de changer sa vision du monde. Ou de lui-même. Car il était d’usage, en ces murs, de se mettre à nu – au moins spirituellement -, même si Perce-neige se moquait parfois de mes réticences à me livrer.
« Qu’as-tu à craindre de moi ? », me demanda-t-elle un jour, allongée à mes côtés dans notre Refuge, sous un soleil qui commençait enfin à baisser sa garde. Elle n’écouta pas ma réponse. Emue sans doute par la beauté des rais rougeoyants qui enflammaient la garrigue, elle me prévint qu’elle allait basculer. J’eus à peine le temps d’inspirer avant d’apercevoir la lumière aveuglante d’un phare devenu familier.
IV.13 – Homo mortel
Je fus projeté, d’un saut de l’esprit, en haut de la « falaise de Clottes », où s’était interrompu mon dernier séjour. Ce monde avait donc une mémoire ? Ou s’appuyait-il plutôt sur la mienne ? Peu importe… Une trace de mes différents passages, un souvenir, s’était gravé quelque part, que ce soit dans le silicium ou dans les méandres tortueuses de mes propres neurones, créant dans l’espace-temps de cet univers des passages qui assuraient, malgré des déconnexions fréquentes, une certaine continuité de l’aventure.
Je suivis un sentier sinueux qui me sciait les genoux. A bout de souffle, je parvins bientôt à proximité d’une grotte. Sur un écriteau couvert de poussières, je déchiffrai une indication géographique : Tautavel. Mon esprit avait donc été projeté dans ce village des Pyrénées, près duquel les paléontologues avaient retrouvé des restes humains dont les plus vieux avaient près de 500 000 ans, les vestiges des tout premiers Européens.
La grotte exhalait une forte odeur d’humus. J’en mis un peu dans ma bouche et en retrouvai les saveurs de terre et d’épice. Alors que les fragrances m’emplissaient le nez, le lieu se mit lentement à changer. C’était pourtant bien la même grotte, mais la végétation, tout autour, se métamorphosait. Mes pensées devinrent de plus en plus confuses. Le souvenir-même de mon prénom disparaissait. Je compris que je voyais désormais de la grotte l’empreinte mentale laissée par l’esprit d’un pré-néandertalien, plus de 100 000 ans avant moi. Des pulsions puissantes émergèrent à ma conscience…
(…) Manger… L’idée m’obsède. Ne pas être mangé… Des traces laissées dans la boue. Une panthère rôde, ou un tigre à dents de sabre. Être prudent… Le souvenir du fauve déclenche une douleur vive dans mon ventre. Les battements de mon coeur accélèrent.
Un membre du clan approche. Mon clan. Ensemble, nous découpons le mouflon que je viens de tuer. Je sors mon biface pour découper peau et muscles. C’est moi qui ai choisi la pierre que j’ai taillée, sur les deux faces, de façon la plus symétrique possible. Pourquoi ? Je ne sais pas. La symétrie ne rend pas l’outil plus efficace. Mais il est plus… beau. J’ai fait des retouches régulières pour en rectifier le bord. Je me sens étrange quand je le regarde. Comme quand je regarde les tatouages que j’ai dessinés sur ma peau. Des pensées me viennent alors. Mais ni manger, ni me reproduire. Mais alors quoi ? Pas savoir. C’est flou dans ma tête.
Je fends un os pour en sucer la moëlle. Il faut faire vite, déjà des hyènes approchent. Je grogne pour prévenir mon compagnon. Nous rentrons au foyer. Il fait froid. Heureusement, le feu ne s’est pas éteint. Je m’assois sur une pierre pour me réchauffer. De la caverne, on aperçoit toute la plaine en bas. Au loin, un troupeau de chevaux s’éloigne. Ils sont déjà bien trop loin pour nous.
Près du feu, un chasseur du clan ne bouge plus. Le coup de patte de l’ours qu’il avait dérangé a fait couler beaucoup de son sang. Son corps est devenu froid. Il est parti de l’autre côté. C’était un grand chasseur. Le plus fort et le plus courageux de nous tous. Pour récupérer sa force et son courage, nous le découpons consciencieusement… et nous le mangeons. (…)
Beurk ! Je crachai par terre, de dégoût. Ce cannibalisme primitif me révulsait. Comment pouvaient-ils… Mais l’ensemble des pensées qui finissaient de remonter me convainquit qu’il ne s’agissait pas de se remplir l’estomac. Non, quelque chose de plus spirituel guidait cette répugnante anthropophagie. Il me semblait percevoir, dans le flot des souvenirs qui s’évanouissaient, les prémices d’un proto-raisonnement : puisque ce que je mange s’incorpore en moi, manger un grand chasseur devrait me rendre plus puissant. Je vivais les balbutiements de la pensée symbolique, de cette aptitude à aller au-delà de l’apparence immédiate des choses pour leur donner un sens, une signification. J’assistais à l’accouchement des premières idées. Qu’avais-je espéré ? Voir les premiers hommes disserter d’algèbre ? Non, les premières associations d’idées étaient liées à ce qu’il y avait de plus instinctif en nous : devenir plus fort, survivre. Car la mort était ici omniprésente. Je devinais un lien puissant entre cette mort qui rôdait sans cesse et le besoin de lui donner un sens. De l’apprivoiser. Comment ?
Le gardien des souvenirs de Tautavel leva les yeux au ciel.
« Je crains qu’on n’ait guère plus de réponse aujourd’hui que n’en avaient ces pauvres bougres », plaisanta-t-il en ouvrant une bouche à moitié édentée. Il me conseilla de descendre en canoë la rivière qui serpentait en contre-bas, pour me rendre jusqu’à une autre grotte gardée par son frère.
« Si tu parviens à passer le barrage des Trois-pierres, tu y trouveras les premières sépultures. »
De la consommation des morts à leur inhumation, il n’y avait en effet qu’un pas de l’esprit. Celui qui consistait à faire d’un corps quelque chose de plus qu’un simple agrégat de matière. A lui donner une existence symbolique. Ma curiosité était piquée au vif. Mais il me fallait trouver un guide pour descendre la rivière tumultueuse dont les méandres devaient me mener, selon ce vieillard, aux premières expériences mentales de la mort. Etait-ce dans ce désarroi, face à l’hypothèse inconcevable de notre propre disparition, qu’avait démarré cette longue quête d’un sens qu’il fallait donner, coûte que coûte, à la vie ? Je méditais sur cette ironie. Je m’en ouvris, en riant, à l’aubergiste qui vint me servir un marcassin rôti sur un lit de pommes sautées. Ces réflexions avaient réveillé en moi un instinct de chasseur dont l’infortuné animal avait fait les frais. Pour calmer mes remords carnassiers, l’aubergiste m’expliqua que les sangliers pullulaient dans ces contrées sauvages et qu’ils avaient le plus grand mal à en contenir les effectifs. Je plongeai donc ma fourchette avec force, puis rongeai les os que je saisis à mains nues, retrouvant des réflexes que mes années d’éducation avaient contrecarrés. Mes doigts se couvraient de graisse tandis que les os craquaient sous mes dents.
« Eh bien, cela fait grand plaisir de voir un homme manger avec tant d’appétit », me lança le tavernier.
Je lui souris, la barbe souillée d’un jus épais.
« Vos réflexions sur la mort me font penser que j’ai, dans mon coffre à humus, quelques souvenirs de Vladimir Jankélévitch que je gardais pour une occasion. En êtes-vous amateur? », me demanda-t-il ?
Et comment ! Partager quelques minutes d’intimité avec ce philosophe de la Sorbonne, penser la mort comme il le fit avec tant d’éloquence au XXe siècle, tombait on-ne-peut-mieux pour clôturer ce repas. Je me laissai donc tenter. Contre un edelweiss, l’aubergiste m’apporta une bière amère qui accompagnait des galettes d’humus, que je croquai aussitôt.
Une première bouchée m’amena dans les années 1960, me plongeant dans le souvenir d’un entretien que Vladimir Jankélévitch avait eu avec le peintre Daniel Diné. Les phrases se formaient, dans mon esprit, comme s’il parlait à côté de moi. Mais je sentais qu’il en manquait certaines, qu’il ne s’agissait que d’extraits évanescents. Sans doute à cause de la dégradation de l’humus lors de la cuisson des galettes… Les phrases du philosophe faisaient bouger imperceptiblement mes propres lèvres, comme si je parlais sous sa dictée :
(…) « La mort est la chose la plus banale du monde, quelqu’un disparaît, un autre occupe la place… En ce qui concerne la mort à la première personne, c’est-à-dire la mienne, eh bien, je ne peux plus en parler puisque c’est ma mort… Il reste la mort à la deuxième personne, la mort du proche… Elle ressemble le plus à la mienne sans être la mienne, et sans être non plus la mort impersonnelle et anonyme du phénomène social… » (…)
Ces quelques réflexions décuplèrent mon appétit. Je laissais le dialogue m’envahir totalement.
(…) « L’homme n’est pas seulement un être qui est, mais qui prend conscience qu’il est. Il survole son devenir et il ne peut pas faire autrement parce qu’il a une conscience pour prendre conscience…. Lorsqu’on survole son devenir en même temps qu’on est dedans, alors la collision engendre l’angoisse de la mort…. Ma journée, les projets que je peux avoir ont un sens. Ce qui n’a plus de sens, c’est l’ensemble. Alors, ma vie elle-même a peut-être un sens pour les autres, mais ma vie entière, pour moi, n’a pas de sens… » (…)
Je m’arrêtai un moment pour reprendre le fil de mes propres pensées. Chacun de mes actes s’expliquaient en effet par la poursuite d’un objectif, quel qu’il fût, grand ou petit. Mais ma vie elle-même ? Comment s’expliquait-elle ? Je ne pouvais m’empêcher de penser que c’était bien parce qu’il prenait conscience que sa vie aurait une fin, que l’humain ressentait le besoin quasi viscéral de lui trouver une finalité. Trouver la fin de la fin, pour ainsi dire. Il n’était pas fortuit que les deux mots fussent homonymes. Une histoire sans fin, sans chute, était-elle toujours une histoire ou ne sombrait-elle pas dans une simple succession d’événements ? A partir de quand une existence devenait-elle une vie ? Il fallait bien, pour cela, qu’une quelconque conscience lui donnât un ordre, le début d’une logique aussi ténue soit-elle, et donc une destination s’inscrivant elle-même sur un chemin qui la dépasse. Notre quête de sens était intimement liée à l’angoisse qu’engendrait a contrario le néant. Je repris goulûment une bouchée. Le dialogue du philosophe reprit :
(…) « Pour le croyant, le problème se pose autrement. Même s’il n’a pas beaucoup de chances d’aller au paradis, sa vie prend un sens parce qu’elle est insérée dans quelque chose de plus vaste… Mais l’ensemble de mon existence, si elle a un sens pour mes élèves, pour moi elle n’en a pas. Si je ne peux pas replacer ma destinée dans un ensemble plus vaste, alors elle devient une durée sans tête ni queue, elle n’a pas de sens… Le fait qu’un être, si humble soit-il, a vécu, puis a disparu gratuitement, cela n’a pas de sens… Le problème de la cessation d’être reste en lui-même le plus profond mystère. Il est impensable et il est, en ce sens, scandaleux…. C’est un mystère en plein jour, en pleine lumière, comme le mystère de l’innocence… » (…)
La mort à l’origine des religions ? L’intuition s’imposait. N’est-ce pas lorsque notre propre mort s’impose à nous que nous nous rappelons soudain au souvenir du prêtre ? Combien d’athées se sont découverts croyants face à l’ultime échéance ? Car ce n’est pas tant la disparition physique qui effraie, mais plutôt, sans doute, la perspective que l’existence elle-même n’ait eu, en définitive, aucun sens. Je repris une dernière bouchée et me retrouvai une dernière fois face à, ou plutôt à l’intérieur même, de Jankélévitch :
(…) « Mourir est la condition même de l’existence. Je rejoins tous ceux qui ont dit que c’est la mort qui donne un sens à la vie tout en lui retirant ce sens. Elle est le non-sens qui donne un sens à la vie. Le non-sens qui donne un sens, en niant ce sens. C’est ce que montre bien le rôle de la mort dans les existences brèves, ardentes, les existences très courtes et ferventes et dans lesquelles c’est la mort qui donne sa force et son intensité à l’existence. C’est une alternative dont on ne peut pas sortir… L’alternative pour nous est la suivante : avoir une vie courte mais une véritable vie, une vie d’amour, etc., ou bien alors une existence indéfinie, sans amour, mais qui n’est pas du tout une vie, qui serait une mort perpétuelle. Je pense que, si on présentait l’alternative sous cette forme-là, peu d’hommes choisiraient la seconde… Plutôt avoir vécu, ne serait-ce qu’un après-midi, comme un éphémère. Car à cet égard, le long et le bref s’équivalent. J’aurai connu la vie. J’aurai au moins connu la vie, même si je dois la perdre, et parce que je dois la perdre, eh bien, j’aurai tout de même vécu. » (…)
Le biscuit aux saveurs morbides se terminait finalement sur une note sucrée. J’en remerciai l’aubergiste. Ces quelques réflexions avait aiguisé mon envie d’en savoir plus sur les premières sépultures, car je soupçonnais qu’elles coïncidassent avec les premières émergences du sens. Les premières tentatives de faire exister quelque-chose au-delà de la matière elle-même. Quelque chose qui lui survive. Un batelier, sur la rive, accepta de me louer l’un de ses canoës pour une poignée d’Edelweiss.
« Vous n’aurez qu’à le laisser à mon cousin, au barrage des Trois-pierres », me proposa-t-il.
La générosité de ces gens, et la confiance qu’ils accordaient si facilement, me stupéfiaient. Il n’avait manifestement aucun doute que je livrerais bien l’embarcation, comme je le lui promis. Ou du moins que je ferais tout ce qui était humainement possible pour honorer ma promesse. Je comprendrai plus tard que rien, dans ce monde, n’était refusé aux vrais chemineurs. Qu’ils suscitaient un respect qui allait bien au-delà de ce qu’avaient pu recevoir les prêtres dans notre univers. Sans doute parce qu’ils avaient su garder la sincérité de leur démarche. Je compris aussi qu’il était évident, pour tous ces gens que je croisais, que j’en étais pleinement un. A quoi le voyaient-ils ? Qu’avais-je sur moi qui trahissait ce désir ardent de m’instruire et de construire du sens, de chercher une vérité à mes questions? Ressentaient-ils déjà en moi cette bienveillance naturelle, cet humanisme enraciné qu’exprimaient les chemineurs que j’avais pu moi-même rencontrer ? Il me plut de le croire. Car enfin, on a chacun nos petits moments d’orgueil !
Je posai mes affaires au fond du canoë, dans un bidon étanche. Je poussai l’embarcation à l’eau et me hissai à bord en prenant soin de ne pas le faire chavirer. L’eau était glacial. J’y plongeai ma pagaie. Le courant régulier facilitait la navigation : il suffisait d’utiliser la pagaie comme gouvernail et de se laisser dériver. J’en profitais pour observer la rivière. L’eau, les arbres, les oiseaux que je voyais s’envoler devant moi, étaient-ils d’une quelconque façon réels ? N’étaient-ils que le fruit de mon imagination ? Où se situait précisément ce monde que je parcourais ? Tout cela n’était-il qu’une illusion que je partageais avec Perce-neige ? J’aurais voulu qu’elle soit vraiment là, sur ce canoë. Entendre sa voix, rire avec elle des plaisanteries qu’elle aimait faire. Mais sa quête, je vous l’ai déjà dit, n’était pas la mienne. Il me fallait me dissocier d’elle pour cheminer seul et trouver les réponses aux questions que je me posais. Les siennes se trouvaient dans Nova Alexandrie, au milieu de ces foules bigarrées et policées dont elle aimait tant la diversité. Aux idées, elle avait toujours préféré les humains qui les formulaient. Et c’était ce qui me charmait chez elle. Elle était le foyer, la braise ardente autour de laquelle les premiers humains s’assemblaient pour échanger. Le lien qui poussait à livrer ce que l’on pensait, à offrir aux autres ces images que l’on créait dans sa tête. Le ciment qui transformait les fantasmagories individuelles en symboles collectifs. Et bien qu’elle ne fût pas dans le canoë, je continuais à la sentir avec moi. Comme un idéal que j’emportais à chaque pas.
Le courant devenait de plus en plus fort. Je devais éviter de cogner trop fortement les rochers. Car qui viendrait me secourir si je venais à couler ici ? Je réinterprétais les paroles de Jankélévitch : c’était bien le risque de me noyer dans ces eaux froides qui rendait son sens à ma quête. Car que vaut une réponse lorsqu’on n’a rien risqué pour l’obtenir ? Et que peut-on risquer de plus haut que sa propre vie ? Je commençais à mieux comprendre comment ce monde fonctionnait. Et pourquoi il me faudrait triompher de ces rapides qui jouaient avec mon canoë. Je donnais des coups brusques, à gauche et à droite, pour rectifier sans cesse la trajectoire. Je sentais sous moi la force immense des flots. Une manœuvre trop tardive précipita l’embarcation sur un rocher. Elle craqua sous la poussée de l’eau et je sentis une douleur vive à mon poignet. Je réussis à la surmonter pour redresser l’esquif. Je pris un virage serré pour en éviter un autre, puis un tronc d’arbre qui dérivait tout autant que moi. Une petite cascade me fit chuter d’un mètre, pour atteindre enfin des eaux plus calmes. J’en profitai pour me reposer et tirer de mon sac un pain noir qui fit mon repas.
Les nuages qui s’accumulaient annonçaient un autre danger. Le tonnerre grondait, des premières gouttes commençaient à tomber. Ce fut bientôt un déluge d’eau et de grêle qui s’abattit sur moi. J’étais trempé jusqu’aux os. Mais c’était surtout la foudre qui m’angoissait. Seul face aux éléments, j’étais terrorisé. Aussi pagayai-je comme un diable, animé d’une soif de vivre qui décuplait mes forces.
Je ne sais combien de temps je me suis battu ainsi, à la fois contre l’eau qui tombait du ciel et celle qui ballottait mon esquif. Quand le soleil reparut enfin, j’étais si épuisé que je m’endormis sur la rive. Pour me réveiller aussitôt, agité et en sueur, au côté de Perce-neige qui essuyait d’un linge mon front encore humide. Je reconnus tout de suite les planches de bois qui tapissaient notre Refuge en haut du pin, dont les aiguilles se balançaient au vent. Mais il me fallut un moment pour reprendre pied dans le monde des réalités matérielles. Passer d’une nature sauvage à une autre, où la marque de l’humain était omniprésente. D’un monde où Perce-neige était dans ma tête, ou moi dans la sienne, à celui-ci où je lui prenais la main mais devais vivre parfois loin d’elle. Ces allers-retours d’un univers à l’autre, d’une temporalité à une autre, étaient éreintants pour l’esprit. Nous décidâmes de rentrer à la Citadelle.
IV.14 – Guides
Nous croisâmes Iris en chemin. Il s’était promené dans la garrigue, pour résoudre au calme une question difficile d’interprétation des inégalités de Heisenberg, qu’Isaac lui avait posée. Le grand Maître de la Citadelle témoignait pour mon ami une attention toujours plus vive. Il était clair qu’il voyait en lui son digne disciple. Et il n’y avait en cela rien qui ne me surprît. Iris était d’une telle intelligence ! Nous étions, face à lui, des nains de l’esprit quand il semblait porté sur des épaules de géant. Il était de l’étoffe d’un Galilée, d’un Newton ou d’un Einstein. Chaque soir, Isaac le recevait quelques minutes, parfois près d’une heure, pour suivre sa progression, lui suggérer de nouvelles lectures ou des questions à résoudre. Iris lui rappelait sans doute le brillant étudiant qu’il avait lui-même été, quand il cherchait déjà – avec de maigres succès – à concilier l’espace-temps de la Relativité générale et le formalisme de la physique quantique. Il avait brillé, lui aussi, au firmament des idées. Avant que ne commence l’inéluctable déclin lié à l’âge. Son esprit était néanmoins encore vif. Et il n’était guère prudent de lui dissimuler une erreur dans une démonstration. Mais il savait qu’il n’apporterait plus rien de neuf. Il pouvait, au mieux, espérer garder le plus longtemps possible la compréhension intime qu’il avait acquise des sciences dites « exactes ». Alors qu’Iris… Le jeune prodige avait en quelques mois atteint le niveau de bien des Maîtres. Et il était clair que son destin était d’aller au-delà.
Pour moi, il était beaucoup plus qu’un grand théoricien : il était mon ami. Un compagnon à l’humeur fragile, j’en conviens. Susceptible et soupe-au-lait. Un brin narcissique, aussi. Mais toujours prêt à accueillir et à discuter n’importe quelle idée. Débattre avec lui était un bonheur. Un match dont on sortait inévitablement perdant, mais vaincu à la loyale, sans mauvaise foi, par une argumentation juste plus solide et plus agile. Je m’inclinais à chaque fois, tandis qu’il me fixait d’un regard orgueilleux, puis m’invitait à boire un verre pour se faire pardonner cette nouvelle victoire. Il lui arrivait alors parfois de se confier à moi. De me parler des relations difficiles qu’il entretenait avec son père, au caractère et à l’éducation rigides, mais avec qui avait fini par émerger une profonde complicité, construite autour d’équations résolues ensemble, ou d’étude commune d’un passage de Kant ou de Hegel. Iris était un esprit à part. Il m’expliqua, un jour, que chaque concept mathématique, scientifique ou philosophique était associé, dans son esprit, à un sentiment, une émotion, une image mentale chargée d’affects. Il n’y avait donc pas, pour lui, de démonstration facile ou difficile, mais certaines étaient joyeuses ou tristes, belles ou discordantes. Il avait l’intuition qu’un résultat était juste sans même avoir besoin d’effectuer consciemment le moindre calcul. Il « sentait » la solution comme on sent d’instinct l’authenticité ou la fausseté d’une personne. Il était, en somme, en totale fusion avec les Idées. Il me plaisait parfois d’imaginer à quels fabuleux sommets pourrait mener une fusion entre Iris et Perce-neige. Entre les capacités inouïes d’abstraction de l’un et l’empathie exacerbée de l’autre…
Quand nous arrivâmes tous les trois à la Citadelle, Isaac demanda à le voir. Je suivis de mon côté Perce-neige pour proposer notre aide au réfectoire. Participer aux tâches ménagères n’était en rien obligatoire. Aucun écrit ne fixait de corvée à quiconque. Mais au dessus des lois écrites flottait une force bien plus puissante, que nul n’aurait songé à contrarier : la conviction tacitement acceptée de tous que chacun devait à la Citadelle une partie de son temps et de son énergie. Les tire-au-flanc, sous la pression sociale, préféraient vite se voir confier une tâche, aussi ingrate fût-elle, que subir la réprobation silencieuse mais inconfortable du groupe. Cette participation de tous permettait à la Citadelle de fonctionner avec un personnel très réduit, qui se contentait d’un maigre salaire en échange du gîte, du couvert, et de quelque chose qui n’avait pas de prix : la sérénité de l’esprit, épargné du stress qu’impose l’obligation de performance. Si les querelles existaient en ces murs comme dans tout groupe humain, elles n’avaient jamais pour origine une quelconque lutte des classes. Parce que chacun donnait un peu, à la mesure de ses compétences, et parce que nul ne prétendait obtenir au-delà des besoins matériels les plus élémentaires, il n’était plus nécessaire de prendre. Là résidait le contrat social qui nous liait solidement l’un à l’autre, dans un esprit finalement similaire à celui qui animait les premières communautés de chasseurs-cueilleurs.
En matière de morale, la Citadelle n’avait pas de curé, mais elle avait mieux à proposer : des Guides. Camille en était un. Il avait même été, avant de disparaître, le directeur de cette sous-confrérie dont la mission, bien que s’énonçant simplement, était d’une redoutable complexité : inciter chacun à trouver, de lui-même, le sens de sa propre vie. Son « travail », si l’on peut dire, était d’écouter en ôtant ses propres filtres, de comprendre comment l’autre pouvait voir le monde et s’y forger sa propre place, de suggérer des pistes à suivre, des chemins personnels tout en acceptant qu’on les suive ou qu’on les refuse. C’était là la grande différence avec la mission du prêtre : le guide n’était pas prosélyte. Il n’avait pas la prétention de détenir la moindre vérité, et encore moins révélée. Une partie de son temps consistait au contraire à convaincre que ce terme de vérité était creux, voire sans objet. Ou, plutôt, que chacun pouvait construire la sienne. Mais qu’il en était des fragiles, bâties sur du sable et des mirages, et des solides, sur lesquelles on pouvait édifier avec confiance sa propre cathédrale.
Camille étant parti, le poste de guide de la Citadelle était officiellement à pourvoir. Maître Galet, expert en neuropsychologie, n’avait jamais fait mystère de son intention de se porter candidat. Il en avait le profil et les compétences. Sa compréhension de la psychologie humaine n’avait rien à envier à celle de Camille. Elle était même largement supérieure, car il avait plus de facilités encore à identifier les pulsions négatives et destructrices, les faux-semblants et la mauvaise foi que chacun enfouissait au plus profond de soi. Camille avait le pardon trop facile, qui frôlait parfois le déni. Mais Maître Galet exprimait avec davantage de parcimonie cette bienveillance naturelle qui faisait le charisme de mon Maître. Il était plus un expert redoutable des âmes qu’un modèle moral. Il savait vous mettre à nu mieux que quiconque, mais avait moins de talent que Camille pour vous rhabiller ensuite d’étoffes mieux assorties.
« As-tu enfin des nouvelles de Camille, me demanda Maître Galet alors que je le croisai devant la bibliothèque.
– J’ai bien peur que non, répondis-je. Cela fait maintenant des mois que j’ignore où il est, ou s’il est même encore vivant. »
Maître Galet resta silencieux.
Grand, d’allure sportive, il était bel homme et, ma foi, il savait en jouer. Il drainait dans son sillage une cour d’admiratrices dont il faisait mine d’être blasé. Sans doute était-ce cela qui agaçait Perce-neige : elle-même grande séductrice, même si elle s’en défendait, elle n’aimait guère ce reflet dans lequel elle ne percevait que trop bien ses propres vanités. Une rivalité feutrée s’était rapidement instaurée entre elle et lui.
Parmi ses conquêtes, une jeune femme ne lâchait pas Galet d’une semelle, en disciple dévouée. Elle avait pour nom Félicitée. Elle était objectivement, elle aussi, une très belle femme. A peine plus âgée que Perce-neige, elle avait cependant un physique diamétralement opposé : sa peau était d’une blancheur presque laiteuse, d’où ressortait le rouge vermillon de ses lèvres. Elle coiffait sagement ses cheveux blonds en longues tresses qu’elle enroulait en couronnes. Elle était ce genre de femme qui vous donnait l’envie d’enfiler sur le champ votre armure et de partir combattre le premier dragon venu. Ses yeux bleus, d’une intensité océanique, n’avaient qu’à ordonner. On y plongeait corps et âme, comme dans un bain d’eau claire. Iris en avait fait un jour un poème maladroit qu’il fit l’erreur de lui réciter en public. Félicitée ne lui tint pas rigueur d’un style peu maîtrisé. Mais Rablais, depuis, ne ratait jamais une occasion d’en servir lourdement, à table, quelques rimes frelatées.
J’observais avec tendresse les efforts désespérés de mon ami pour attirer sur lui l’attention de sa muse. En pure perte : Félicitée semblait ne jamais vouloir quitter le sillage de Maître Galet. Le lien secret qu’elle avait tissé avec lui semblait plus fort encore que l’admiration que je vouais moi-même à Camille. Par quelle alchimie ? La différence de sexe semblait étrangère à l’affaire. C’eût été une explication trop facile. Non, une force bien plus puissante était à l’oeuvre. Mais quoi ? Je m’étais résolu à en percer un jour l’énigme.
Chapitre V
V.1 – Vergers
Le printemps avait choisi cette année d’avancer par à-coups. Des vagues de fleurs envahissaient par brusques bouffées les vergers plantés autour de la Citadelle, explosant de vie après le silence de l’hiver. Des hectares entiers avaient été plantés de cerisiers, d’abricotiers, de pêchers, de pruniers mais aussi d’amandiers, de grenadiers et d’autres fruitiers dont j’ignorais les noms. La Citadelle avait à coeur, m’expliqua-t-on, de favoriser des variétés anciennes, particulièrement adaptées à ces garrigues arides, mais que l’agriculture moderne avait depuis longtemps oubliées. Des charrettes de fruits qu’elle engrangeait chaque été, elle confectionnait toutes sortes de produits savoureux – confitures, confiseries, jus, liqueurs – qu’elle revendait sur les marchés alentour, s’assurant ainsi différents revenus complémentaires. Car la communauté s’évertuait à dépendre le moins possible de la générosité d’autrui. Elle entendait au contraire assurer elle-même, autant qu’elle le pouvait, les conditions économiques de sa survie, autant par amour propre, par fierté de ne pas avoir à quémander, que pour garantir son indépendance. La Citadelle ne percevait aucun argent public ; elle prenait garde à n’avoir de compte à rendre qu’à elle-même, bien qu’elle fît partie d’un plus large réseau – l’Institut – que les Maitres évoquaient peu et dont j’ignorais à l’époque à peu près tout.
Nous proposâmes spontanément notre aide, Perce-Neige et moi, pour planter de nouveaux arbustes. Nous partîmes au matin en petit groupe, équipés de pelles et de pioches, cheminant autour de la charrette qui contenait les plants du jour et que tirait d’un pas tranquille un vieil âne. Forest avait insisté pour venir avec nous, heureux qu’il était de travailler la terre. Marie avait suivi, n’ayant rien de mieux à faire.
Le groupe était mené par Noël, un jardinier qui avait acquis au fil des ans, en observant les plantes, un inestimable savoir-faire qu’il transmettait à qui voulait l’écouter. Petit, râblé, les mains calleuses, l’autodidacte avait pour ainsi dire le physique de l’emploi. Ses débuts dans l’agriculture, sur le terrain qu’il possédait avant de venir s’installer ici, avaient pourtant été ingrats. Il profitait souvent du trajet pour nous conter les mésaventures qui avaient jalonné ses premières années : arbres plantés un mauvais mois de l’année, jeunes tiges grignotées par les lapins, feuilles infestées de rouille ou dévorées par les pucerons… il avait appris à ses dépens que l’agriculture supportait mal l’improvisation. Elle était une école de patience, d’humilité et d’obstination, surtout lorsqu’on s’interdisait, autant par philosophie personnelle que par pragmatisme, le recours aux pesticides de synthèse. La Citadelle préférait miser sur l’équilibre des espèces, sur l’évolution patiente et savamment guidée des écosystèmes, pour s’assurer des rendements qui, sans être aussi importants que ceux obtenus par l’agriculture dite « intensive », présentaient l’intérêt d’être pérennes et de ne pas hypothéquer l’avenir. Peu lui importait du reste d’obtenir des gains immédiats : construite pour durer, la Citadelle raisonnait à l’échelle des siècles, au-delà d’une vie humaine. L’utilisation d’une parcelle se planifiait une décennie à l’avance, pour laisser au sol le temps de se préparer à son nouvel usage. « L’agriculture industrielle a peut-être inventé la montre, mais nous, nous possédons le temps », répétait Noël sans trop savoir d’où il tenait cette maxime.
A son arrivée, il avait été charmé par les grands arbres – chênes, noyers ou noisetiers – qui entouraient la Citadelle. Ils exprimaient la force tranquille de ceux qui n’ont nul besoin de s’impliquer dans une course quelconque. Il était d’usage que chaque pensionnaire, durant son séjour, plantât un simple gland, ou un noyau de fruit dans la terre meuble, pour observer ensuite, année après année, à chaque nouveau passage, le développement lent et laborieux du jeune plant. L’exercice avait une haute valeur pédagogique : il était la métaphore des efforts que l’on semait, non pour soi, mais pour ceux qui suivraient et en récolteraient les fruits. Quiconque restait plusieurs semaines à la Citadelle ne pouvait la quitter sans avoir semé ou planté un arbre. Aussi était-elle presque masquée par d’abondantes futaies sans cesse renouvelées.
Nous arrivâmes en sifflotant dans les nouvelles parcelles du verger. D’autorité, Noël indiqua à chacun l’emplacement du trou qu’il avait à creuser. Chacun prit l’arbre qu’on lui avait attribué ou qu’il avait lui-même choisi. J’appris ce jour-là à plonger mes mains dans la terre argileuse, dont j’extrayais des lombrics épais comme le doigt. Travaillée depuis des siècles, cette terre était fertile. D’autant que nous y rajoutions un mélange de fumier de cheval et d’ortie de notre cru, préalablement macérée dans une eau putride. L’odeur en était, je dois l’avouer, délicieusement immonde.
Mon ami Iris souffrait le martyre, obligé malgré lui de plonger ses ongles dans la boue grasse, les genoux embourbés dans l’humus et le nez au ras du sol. Ses lunettes terreuses s’obscurcissaient encore davantage chaque fois qu’il essayait, de ses mains sales, de les essuyer. Perce-neige semblait plus à son aise. Elle s’amusait à jeter des mottes de terre qui s’écrasaient lourdement sur ma chemise. Je me vengerais plus tard en l’aspergeant copieusement d’un seau de l’eau fraîche puisée dans la rivière.
Je creusai un trou d’un demi-mètre, au fond duquel j’installai un figuier. L’humidité du sol, grâce à la rivière proche, était de bon augure pour un arbre qui a ses exigences. Je comblai la cavité d’un mélange de terre et d’engrais que je tassai du pied. Le figuier avait déjà quelques feuilles, et l’on sentait en lui la promesse de fruits sucrés dont nous ferions plus tard nos confitures. Perce-neige avait planté plus loin un petit arbousier aux fruits plus sauvages. Une nuée d’oiseaux nous observait, projetant sans doute de copieuses razzias.
Nous conclûmes cette matinée agricole par un pique-nique, sur l’herbe encore couverte d’un tapis de fleurs sauvages aux lourdes senteurs de pollen. D’instinct, tout le monde s’était disposé autour de Perce-neige, qui irriguait le groupe d’une joie contagieuse. Nous étions bien. Marie avait préparé comme à son habitude des tartes savoureuses, que Forest dévorait comme une bête affamée.
C’est à la fin du repas, au moment où certains songeaient à piquer une sieste, que les vergers se transformèrent soudain en maquis épais. Je compris au regard devenu absent de Perce-neige qu’elle n’était déjà plus parmi nous. Sans doute étions-nous passés dans le sillage d’une lointaine antenne relais qui avait permis la connexion du brin. Je fus directement projeté en terres paléontologiques.
V.2 – Chaman
J’étais à nouveau entouré de convives. Mais leurs vêtements d’un autre temps, leurs regards graves animés d’une foi ardente dans la quête qui les rassemblait, les trahissaient sans ambiguïté : c’étaient des chemineurs. Regroupés autour d’un feu de camp, ils débattaient avec passion. De quoi ? Je mis du temps avant de comprendre le sens des mots qui affluaient à mes oreilles. Il y était question de rencontres entre Néandertaliens et Homo sapiens. Et toujours cette lancinante interrogation : pourquoi Homo sapiens l’a-t-il emporté, il y a quelques dizaines de milliers d’années, sur toute la planète, et pourquoi Néandertal a-t-il disparu ? Tout comme les autres espèces humaines, d’ailleurs. Ce groupe s’était mis en tête d’y répondre. Mais pour cela, il allait falloir remuer l’humus. Trouver des souvenirs enfouis depuis des milliers d’années sous d’épaisses strates successives de consciences humaines.
Mon canoë gisait au bord de la rivière, dans un état pitoyable.
« Enfin réveillé ? », me lança un chemineur.
Mon air ahuri dut l’émouvoir, car il s’empressa d’ajouter :
« Nous t’avons trouvé échoué sur la rive, trempé jusqu’à l’os et délirant au soleil. Tu priais une déesse… Perce-neige je crois que tu l’appelais. Tu as eu une sacrée chance que nous t’ayons trouvé. »
Je bredouillai quelques remerciements et me levai péniblement. Je me sentais comme une graminée piétinée par un troupeau de mammouths. J’avais des courbatures sur l’ensemble du corps. Je reconnus parmi eux Lise, la chemineuse avec qui j’avais pris l’aérobus. D’un sourire, elle me fit comprendre qu’elle ne m’avait pas oublié. Je vins m’asseoir à côté d’elle et repris quelques forces en partageant leur dîner.
« Nous partirons au matin, sur les traces des premières sépultures de Néandertal. Veux-tu te joindre à nous ? », m’invita-t-elle.
Ainsi, par une coïncidence heureuse – mais en était-ce vraiment une ? – j’avais recroisé sa route, et celle d’autres chemineurs dont la quête venait se confondre avec la mienne. Des ponts s’étaient naturellement créés entre les questions qu’ils se posaient et celles qui m’animaient. La perspective de me joindre à eux était rassurante. D’autant qu’une autre belle surprise m’attendait : aussi bavard qu’une porte de cloître, le regard perdu dans d’insondables pensées, j’aperçus mon ancien guide Malik qui tirait quelques bouffées d’une longue pipe. Je m’empressai de le saluer. Il répondit, comme à son habitude, par un grognement qui devait signifier sa joie réciproque de me revoir. Ce fut le seul mot – ou le seul son – que j’entendis de lui de la soirée.
On me prêta une couverture pour la nuit. J’eus le sommeil léger, troublé par le bruissement des bêtes sauvages qui furetaient dans les hautes herbes. Instinctivement, je commençais à ressentir l’angoisse diffuse qui étreignaient les premiers hommes quand ils s’abandonnaient ainsi à l’obscurité de la nuit et aux prédateurs nocturnes.
Les premières lueurs de l’aube me réveillèrent. J’avais toujours le dos en miettes et une vilaine toux grasse héritée de mes précédentes mésaventures dans l’eau glacée. On me servit un thé chaud et quelques biscuits au miel. De toute évidence, j’étais considéré comme un membre à part entière du groupe. On me proposa de monter sur une mule, entre deux sacs.
« Ne t’inquiète pas pour ton canoë, nous le récupérerons au retour. De toute façon, il prend l’eau de toutes parts », me lança celui qui paraissait commander le groupe.
D’un signe, Malik fit démarrer le cortège qui s’enfonça dans une forêt épaisse. Où étions-nous ? Je l’ignorais. Rien ne m’était vraiment familier dans ce paysage. Et à vrai dire, peu m’importait. Je m’abandonnais au balancement régulier de la mule, libérant mon esprit de toute pensée. Nous fîmes halte devant une hutte de branchages et d’ossements, sans doute de mammouth car les défenses me semblaient trop grandes pour avoir été celles d’un simple éléphant. Un ermite aux cheveux longs et sales en sortit, vêtu d’une peau d’ours. Son cou cliquetait d’amulettes et de colliers de coquillages. Il ânonnait des mots incompréhensibles, le regard vitreux. C’était un chaman !
Il nous fit signe d’entrer dans sa hutte où régnait une odeur rance, bestiale, qui prenait au ventre. L’homme nous proposa des fragments d’humus qu’il nous invita d’un geste à mettre en bouche. La poudre d’humus avait un goût âpre et fermenté. L’ermite la chiquait avec application, crachant dans le feu un jus épais.
La forêt disparut alors, pour laisser place dans nos esprits à une vaste plaine balayée par les vents. Nous étions tous, à présent, vêtus comme notre hôte de peaux de bêtes. Un auroch gisait face à nous, le souffle encore chaud, le flanc percé de trois lances. Nos visages étaient différents : la face projetée vers l’avant, le front fuyant, un nez long et large, un bourrelet osseux formant comme une visière au-dessus des orbites… nous avions des trognes de Néandertaliens. Ou plutôt, nous étions des Néandertaliens. L’humus de l’ermite nous avait fait accéder à la conscience putréfiée de ces lointains cousins. Dans quelle mesure ces souvenirs étaient-ils devenus les nôtres ? Les images se traduisaient en moi en autant de mots imprécis d’un récit initialement conçu sans phrase. Mais les représentations mentales qui s’enchaînaient dans mon esprit auraient pu être formulées ainsi :
(…) Avec mes compagnons, nous découpons chacun de larges quartiers de viande, excités par la perspective d’un repas saignant. Nous récupérons aussi nos lances, longs morceaux de bois appointés ou terminés par une pointe en pierre solidement enchâssée.
L’un des miens a brisé sa lance. Il décide de s’en fabriquer une nouvelle. D’un sac de peau, il sort un silex de forme régulière. Il protège sa cuisse d’un bout de fourrure puis réfléchit, le regard absent. A quoi ? Il prend soudain un galet de rivière et se met à en frapper le silex d’une main ferme. Les coups claquent, tandis qu’il façonne peu à peu ce qui deviendra une pointe. Il détache d’abord trois éclats pour créer un triangle, puis prend un galet plus petit pour donner des coups plus précis. Tchac, tchac, tchac… la pointe se dessine par à-coups. Il améliore le coupant avec un morceau de buis, pour enlever un à un des petits éclats. J’admire sa dextérité. Sa pointe est bientôt prête. Il l’insère dans une entaille, à l’extrémité d’une longue tige de bois, et la fixe avec une lanière de cuir. Puis il trempe la tige dans l’eau : le bois humide va gonfler puis, lorsque la lance séchera au soleil, le cuir se rétractera et renforcera le lien. L’un de mes compagnons présente son couteau en silex à la pointe allongée, finement taillée sur les deux faces avec une parfaite symétrie, sculptée comme une feuille. Je reste perplexe : un couteau sans symétrie aurait été tout aussi efficace. Pourquoi avoir gaspillé inutilement son temps ? Je grogne pour lui signifier mon incompréhension. Il insiste cependant. Il me retend son couteau pour que je l’examine à nouveau. Il en semble si fier. Je l’observe ostensiblement, le tournant et le retournant dans ma main. Je commence à comprendre : cette forme symétrique provoque un plaisir mystérieux que je n’avais jamais éprouvé auparavant. Un plaisir que je ne comprends pas. « Couteau, beau », me susurre mon compagnon. Il semble vouloir m’apprendre quelque chose… Je vois bien que mon absence de réaction le déçoit.
Le vent est froid et humide. Des rochers couverts de mousses et de lichens affleurent au milieu des graminées. Nous traversons un massif de bouleaux et de saules. Au loin, un troupeau de rennes se dispute une herbe grasse avec quelques bisons. Un chevreuil s’enfuit devant nous. Le chef de notre groupe se met à rire. Nous l’imitons, traversés de halètements rauques.
Nous nous arrêtons devant une grotte humide. Notre chef fait tourner rapidement dans ses mains un long bâton de hêtre, dont il a introduit l’extrémité dans un trou creusé dans un second bout de bois. L’échauffement produit des étincelles qui enflamment un mélange d’amadou, de mousse, de moelle de sureau et de feuilles sèches. Il confectionne une torche avec laquelle il inspecte soigneusement la grotte. Il brûle le sol pour le débarrasser de la vermine, puis allume un foyer au fond d’une cuvette creusée dans la terre. Nous y faisons cuire de gros quartiers de viande que nous dévorons à pleines dents. Quelques-unes me font mal. Certaines sont cassées, et ma gencive est gonflée. Mes compagnons ne sont pas mieux lotis.
Repus, nous nous asseyons autour du foyer. Le chef produit des séries de sons qui forment dans ma tête une histoire. Je vois des images de chasse. Je comprends qu’il est question d’une chute maladroite. Mes compagnons s’esclaffent. Je ris avec eux. Le chef a terminé son récit. L’un après l’autre, nous nous allongeons. La pierre est dure malgré la peau de renne posée dessus. J’entends les premiers ronflements de mes compagnons, tandis qu’au loin quelques bruits de hyènes fendent la nuit. Le feu me rassure. Je m’endors peu à peu.
Nous reprenons notre route le lendemain matin. Les cailloux et les broussailles épineuses entaillent la corne de mes pieds. L’un de mes compagnons a du mal à nous suivre : depuis que l’aurochs l’a percuté, il boîte. Nous l’aidons parfois à avancer.
Après des heures de marche, nous arrivons enfin au campement : quelques huttes en os, perches de bois et peaux de rennes, assemblées au bord d’une rivière poissonneuse. Leur intérieur est pavé de pierres plates et recouvert d’une litière de végétaux.
Les femelles et les enfants nous font la fête. La chasse a été bonne ; le clan aura de quoi manger pour plusieurs jours. Je grimpe dans la grotte aménagée à flanc de falaise. Quelques familles y ont dressé des cloisons avec des morceaux de peau montés sur une armature en bois. Je pose mes affaires dans le recoin dont j’ai fait mon domaine.
Près d’un foyer, une femelle détache des lambeaux de chair d’un os long. Elle le gratte, le casse et en extrait la moelle qu’elle verse dans un bol. A ses côtés, une autre femelle découpe des lanières de viande qu’elle fait sécher au soleil. Elle porte un collier de coquillages, qui éveille en moi le même plaisir que celui qu’avait suscité le couteau symétrique de mon compagnon. Sauf que le désir que je ressens est bien plus violent. Je m’approche en grognant de la femelle, qui s’enfuit effarouchée. Je ne m’accouplerai pas aujourd’hui…
La paroi de la grotte est décorée de motifs gravés à l’ocre. Une pierre attire mon attention : circulaire, plate et mince, gravée d’un signe en forme de croix. Cet objet me fascine, car il a l’apparence d’un être vivant, d’un coquillage, mais il est dur comme la pierre. Est-il possible qu’un être, anciennement vivant, puisse se changer en pierre ? C’est à la fois choquant et excitant. Cela ne pouvait être que l’oeuvre d’une force puissante. (…)
V.3 – Iroukaïs
Le pouvoir de l’humus se dissipa et je repris peu à peu mes esprits. Je compris à l’air égaré de mes compagnons que les autres chemineurs avaient vécu une expérience similaire. Cette plongée dans des formes de pensée différentes, primitives, nous avait tous déstabilisés. Se comprendre d’un humain à l’autre n’était déjà pas facile. Là, nous nous étions immergés dans des cognitions d’une autre espèce depuis longtemps disparue. Mais une espèce qui, comme la nôtre, avait été capable de sculpter des objets. De leur donner une valeur qui dépassait leur utilité immédiate, de leur attribuer des propriétés immatérielles. Nous avions assisté aux débuts de l’abstrait. Le chaman se tourna vers nous.
« L’histoire s’est montrée très injuste envers eux », marmonna-t-il.
Nous acquiesçâmes en silence. Très injuste, en effet. Car pendant des décennies, Neandertal n’avait été perçu que comme une brute épaisse.
« C’était pourtant un grand chasseur, poursuivit le chaman. Mais il était encore bien plus. Bien plus… Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi il n’utilisait, pour chasser son gibier, que des armes en bois ou en pierre ? Neandertal n’utilisait jamais d’arme d’origine animale, contrairement aux Homo sapiens. Comme si quelque chose, un commandement impérieux, l’empêchait de retourner contre le monde animal ce qui lui appartenait. N’y a-t-il pas là comme l’embryon d’un impératif quasi religieux ?
– Moi, ce qui m’étonne davantage, rétorqua un chemineur, c’est qu’il semblait choisir soigneusement les espèces qu’il chassait, mais qu’il ne faisait pas son choix en fonction de ce qui lui était facile ou difficile de tuer, mais selon d’autres critères plus mystérieux. Comme si certaines bêtes n’était pas seulement « bonnes à manger » mais aussi « bonnes à penser ».
– Que veux-tu dire ? ne puis-je m’empêcher de demander. Cette notion de bête « bonne à penser » me paraissait des plus obscures.
– Ce que je veux dire, poursuivit-il, c’est que Neandertal a chassé l’ours brun pendant plusieurs centaines de milliers d’années. Et pourtant, il n’a jamais mangé, à ma connaissance, d’ours des cavernes. Or, il y en avait beaucoup, à l’époque. Et l’ours des cavernes, comme il était végétarien, était moins agressif et dangereux que les autres ours. Alors pourquoi Neandertal est-il allé chasser d’autres espèces beaucoup plus dangereuses pour lui, comme les aurochs ? »
Nous sommes restés longtemps à deviser sur ce mystère…
Lise avança comme théorie que l’ours des cavernes avait dans son imaginaire un statut particulier. Peut-être avait-il rang d’animal totem, particulièrement respecté. L’hypothèse nous paraissait solide. De toute façon, nous n’en avions pas d’autres.
« Bonne à manger, bonne à penser… bonne à penser, bonne à manger », marmonnait sans fin le chaman en partageant avec nous des pommes sautées aux herbes. Alors que nous mangions de bon coeur, nous entendîmes une meute de loups hurler au loin. Sans doute à quelques centaines de mètres de la hutte. Nous y prêtâmes à peine attention, mais notre hôte, lui, semblait inquiet.
« Prenez garde mes amis, de vieilles forces se sont mises en chasse, nous lança-t-il d’un ton aussi grave que mystérieux, tout en tisonnant le feu.
– Rien de tel qu’une bonne chasse pour nous remettre en appétit, plaisanta l’un de mes compagnons.
– Il se pourrait bien que vous soyez, cette fois, le gibier », coupa le chaman, qui ne plaisantait plus.
Son air sévère jeta un froid dans l’assemblée.
« Pas d’inquiétude, grand-père, nous ne craignons pas vraiment les loups », crâna mon voisin en sortant un couteau long d’une vingtaine de centimètres.
C’est Malik, cette fois, qui l’interrompit :
« Ton couteau te sauvera d’un loup, pas d’un Iroukaï. »
Tout le monde fut surpris de l’entendre parler.
« Un… Iroukaï ? »
J’imaginais un fauve immense, aux babines retroussées et au grognement carnassier comme il en existait peut-être dans ces contrées dont j’ignorais encore tout. Le chaman me détrompa.
« Toi, tu es bien ignorant de ce monde. Les Iroukaïs sont des chasseurs, de terribles tueurs. Ils parcourent en petits clans les terres les plus reculées de la paléontologie, comme des fantasmes morbides incrustés dans les replis de l’esprit. Ce sont des pulsions primitives, qui ont imprimé si fortement cette terre que rien ne les fera disparaître. D’habitude, ils ne s’aventurent pas jusqu’ici ; ils ne sont guère à l’aise dans ces contrées chargées de symboles et d’abstraction. Quelque chose a dû les pousser hors de leurs territoires. Un conseil : tenez vous à distance et ne croisez pas leur route. »
Un chemineur s’insurgea.
« Mais enfin, pourquoi nous chasseraient-ils ? Qu’ont-ils contre nous ? N’y aurait-il pas au contraire quelque bénéfice à communiquer pacifiquement avec eux, pour que nous puissions les étudier, assimiler leur culture ?
– Oh, mais c’est bien leur intention d’assimiler la vôtre, susurra le chaman d’un ton acide.
– Mais alors, pourquoi ne pas les inviter au contraire à partager notre repas ?
– Pour une raison fort simple : vous seriez le repas ! »
Nous reculâmes d’effroi.
« Vous voulez dire que ces sauvages sont… cannibales.
– Cannibales ils sont, en effet, répondit le chaman. Mais sauvages, sûrement pas. Du moins, pas plus que vous ou moi. Car voyez-vous, le cannibalisme rituel n’a rien à voir avec le cannibalisme de pénurie. Les Iroukaïs ne mangent pas de l’humain pour se nourrir – un simple lièvre ferait plus facilement l’affaire. Non, le cannibalisme n’a rien à voir avec cela. C’est une pratique aussi vieille que l’humain lui-même, et qui a démarré dès qu’il s’est mis à forger des premiers mythes et des croyances. Le cannibale n’est pas une brute. On peut au contraire considérer que sa pratique témoigne d’un raffinement qui le coupe radicalement du règne animal. Car vous verrez très peu d’animaux mangeant sans nécessité leurs semblables. Le cannibalisme est empreint de rites et d’interdits. On ne choisit pas n’importe quel cadavre. Et on n’en mange que certains morceaux bien précis. Comme la graisse, qui renferme la personnalité du mort, ou les os, qui abritent son âme. En d’autres termes, il ne s’agit pas d’absorber des calories mais des symboles. Le cannibalisme est l’une des formes les plus primaires, immédiates, naturelles, pour ingurgiter de l’abstrait. Dans le monde des humains, des tribus indiennes d’Amérique latine mangent des os broyés dans une soupe rituelle. Des tribus mélanésiennes préfèrent le cerveau où siège la force physique et morale. Il ne s’agit pas de manger n’importe quoi, n’importe comment. Non, le sauvage qui se repaît goulûment de viande humaine crue n’existe que dans les mauvais contes, ou sous la plume d’explorateurs mal inspirés.
– Peut-être, mais ce n’est pas la façon la plus judicieuse de se faire des amis, objecta Lise. Qu’ils n’aillent pas se plaindre, après ça, d’être traqués comme des bêtes dangereuses. Qui peut accepter de vivre à côté de cannibales ?
– Les humains consommés ne sont pas forcément en dehors du clan, rétorqua le chaman. C’est un autre cliché tenace. Beaucoup de cannibales consomment des humains de leur propre groupe et ne représentent donc aucun danger pour leurs voisins. Voyez-vous, il y a deux formes de cannibalisme. Il y a l’exo-cannibalisme, souvent guerrier, qui consiste à manger des adversaires du clan après les avoir tués, pour assimiler leur force vitale, leurs qualités que le clan ne possède pas. C’est donc paradoxalement une forme de respect d’un adversaire à qui l’on reconnaît des caractères supérieurs. Même si parfois, il faut d’abord, pour que l’humain puisse être comestible et être traité en gibier, qu’il ait été préalablement torturé. Cela peut paraître cruel, mais bon, l’esprit ne choisit pas toujours ses associations d’idées ; elles s’imposent à lui. Ne le considérez donc pas comme un vulgaire sadisme… D’autres groupes préfèrent au contraire manger les leurs. C’est l’endo-cannibalisme. On mange ses parents, par exemple. En général, on ne les tue pas soi-même. On attend que la nature s’en charge. Quoique… J’ai perçu dans l’humus des souvenirs de Papous qui avaient tué leurs vieux parents, les avaient découpés, cuisinés et mangés. Et d’autres souvenirs d’Aborigènes qui avaient fait de même avec des nouveaux-nés, pour qu’ils puissent renaître plus forts encore. Mais là aussi, il s’agit bien d’ingérer des qualités, des vertus que possédait l’ancêtre, ou d’éviter que le corps ne se décompose, ne perde au fond son humanité pour ne devenir qu’un amas putréfié. Le corps ingéré échappe à ce destin. Il participe à un nouveau corps. Il reste humain. Il peut donc y avoir dans le cannibalisme comme un altruisme post-mortem… Hélas pour nous, je n’ai jamais vu un Iroukaï manger l’un des siens.
– Néandertal était-il cannibale ? demanda l’un de nous.
– Bien sûr, certifia le chaman. Comment pourrait-il en être autrement ? N’a-t-il pas démontré qu’il était lui aussi capable d’une pensée symbolique ? »
Je me rappelai l’expérience d’anthropophagie que j’avais brièvement vécue à Tautavel après avoir absorbé une pincée d’humus.
« Suivez-moi dans mon jardin, lança-t-il en se levant. Il y pousse quelques arbres-livres. »
Comme nous hésitions à sortir, il nous rassura :
« Ne vous inquiétez pas, les Iroukaïs ne s’aventureront jamais près de ma hutte. Ils craignent l’atmosphère trop abstraite qui y règne. Vous savez, ils n’en sont qu’aux premiers stades de la culture. L’humus est bien trop concentré pour eux, ici… »
V.4 – Arbres-livres
Nous suivîmes le chaman en file indienne derrière sa hutte, foulant de nos pieds un potager planté au milieu des arbres. Les tomates s’y mêlaient aux artichauts et aux courgettes, dans une anarchie végétale qui semblait ne répondre à d’autre logique que celle du hasard ou de la volonté capricieuse du semeur. Notre hôte se dirigea vers un arbuste au feuillage abondant.
« Celui-ci a poussé il y a quelques cycles, là où la terre est la plus riche. Il me paraît très prometteur. »
Son tronc était naturellement gravé. Je m’approchai pour déchiffrer les inscriptions qui s’inscrivaient en relief sur l’écorce, sous l’effet d’une mystérieuse force biologique.
« …Néandertal, une autre humanité, par Marylène Patou-Mathis… C’est étrange, cela ressemble au titre d’un livre, m’exclamai-je.
– Pardi, répondit le chaman sur le ton de l’évidence, puisque c’est un arbre-livre ! »
Mon regard incrédule le surprit.
« Tu… n’as jamais lu d’arbre-livre ? »
Ma réponse négative le décontenança encore davantage.
« Je te pensais pourtant lettré. C’est étonnant… Enfin bon, il n’est jamais trop tard pour se mettre à lire. Prends donc une feuille ! »
Comme j’hésitais, il approcha de moi une des branches, attendant que je la saisisse. J’observai attentivement l’une de ses feuilles et… non, ce n’était pas possible! C’était incroyable, mais le long des nervures des phrases colorées apparaissaient sous mes doigts. J’approchai mes yeux pour lire :
(…) Aujourd’hui, grâce à cette méthode analytique, la pratique du cannibalisme a été clairement démontrée dans plusieurs sites préhistoriques, paléolithiques et néolithiques, en France et à l’étranger. Ainsi, il y a huit cent mille ans, à la Gran Dolina d’Atapuerca en Espagne, six Homo antecessor, des femmes, des hommes et des enfants ont été consommés. En effet, des ossements humains, mêlés à des restes d’animaux, portent des marques de décapitation et sur 50 % d’entre eux, de désarticulation et de décharnement. De plus, les os longs, notamment à moelle, sont fracturés. C’est, actuellement, la plus ancienne trace de la pratique du cannibalisme. Un crâne d’Homo sapiens archaïque, découvert à Bodo en Ethiopie et daté entre 600 000 et 500 000 ans, porte également des stries de décharnement. (…)
Je reculai, aussi interloqué que fasciné. Ainsi donc, dans ce monde, les livres poussaient comme des arbres? Juste retour des choses, ne pus-je m’empêcher de penser, car les pages d’un livre ne sont-elles pas elles-mêmes issues de pâte à bois ? Les feuilles, ici, se lisaient directement sur l’arbre qui les portait. C’était d’une élégante simplicité.
« Mais alors, tous ces arbres…
– … sont des livres, compléta le chaman. Ils ont poussé quand leur auteur de l’au-delà, dans le monde des humains, a commencé à noircir une première page dans l’intimité d’un bureau, ou dans l’animation bruyante d’un café. Beaucoup de jeunes pousses périssent, restées à l’état de projet avorté et vite oublié. La plupart ne sont que des racines qui rampent des années sous terre sans jamais voir la lumière du jour. D’autres restent des arbustes chétifs, mal engagés, qui après une première poussée rapide, s’étiolent et dépérissent, faute de trouver une nourriture suffisante. Mais il arrive que certaines deviennent des troncs puissants, qui irriguent des feuillages abondants et grimpent à des hauteurs impressionnantes, comme s’ils voulaient atteindre le soleil, à moins qu’ils ne s’efforcent surtout de prendre de la lumière aux autres. Les arbres-livres dégagent une énergie, une volonté d’exister, assez unique. Comme tu m’as l’air observateur et dégourdi, tu apprendras vite à les reconnaître. »
J’observais cet arbuste-livre, manifestement né du travail d’une certaine Marylène Patou-Mathis, préhistorienne au CNRS et spécialiste des Néandertaliens, que je n’avais jamais rencontrée dans mon monde mais dont les idées avaient fortifié dans l’humus de cette terre. Son livre avait littéralement pris racine ; il avait trouvé sa place au milieu des autres. Déjà, des colonies d’insectes y élisaient domicile. J’imaginais que les abeilles, à chaque printemps, en butinaient le nectar et fertilisaient de leur pollen d’autres œuvres similaires. Je compris que ses feuilles, en tombant, allaient ensuite fortifier l’humus dans lequel germeraient d’autres arbres-livres. Ainsi donc naissait aux hommes l’inspiration, dont je pensais alors avoir percé une part du mystère !
Je pris une autre branche au hasard. Sur l’une des feuilles, je lus qu’il était question du site de la Baume de Moula-Guercy, en Ardèche. Les ossements d’au moins six Néandertaliens y avaient été découverts, dont un enfant de six à sept ans et un jeune « adulte » de quinze ou seize ans.
(…) L’étude comparative des ossements d’hommes et de cerfs a mis en évidence une similitude du traitement des corps humains et des carcasses animales. Les hommes et les cerfs ont été dépecés et consommés, les Néandertaliens de la Baume Moula-Guercy étaient donc cannibales. (…)
C’était donc une certitude pour la préhistorienne dont j’effeuillais l’ouvrage, Néandertal avait bien été cannibale. Mais l’avait-il été simplement pour se nourrir, lors d’épisodes de famine, ou fallait-il y voir déjà l’expression d’un rite, d’un acte d’assimilation symbolique ? Difficile de trancher. Il me faudrait retrouver dans cet humus le souvenir putréfié de ses premières pensées, si seulement elles avaient laissé la moindre trace.
La présence de restes de gibiers, sur certains sites, permettait d’exclure un contexte de disette qui aurait pu conduire à devoir manger ses semblables. Mais cette question qui me taraudait se retrouvait sur de multiples feuilles, comme si la préhistorienne qui les avaient nourries avait longtemps buté à son tour sur cette énigme :
(…) pourquoi Neandertal a-t-il mangé ses congénères ? Les raisons sont sans doute multiples : pour assouvir sa faim, apaiser, honorer ou prendre la force vitale ou les connaissances d’un défunt, renforcer l’unité de son groupe, se venger ou punir un des siens qui avait violé un interdit… (…)
Je la laissai à ses interrogations pour suivre le chaman, qui nous raccompagna dans sa hutte. Il nous proposa de poursuivre notre immersion en partageant une infusion d’humus qu’il avait concoctée spécialement pour nous. Je lui sus gré d’en avoir agrémenté les tanins acres par une cuillerée de miel.
Nous fûmes alors transportés dans un salon du XVIe siècle. Nous avions en face de nous Montaigne, qui commentait justement son chapitre – Les Cannibales – de ses célèbres Essais. Ce n’est point par sauvagerie, confirmait-il, que les anthropophages des Amériques mangeait la chair de l’adversaire vaincu, mais en vertu d’une tradition parfaitement connue et comprise, si ce n’est approuvée, de sa victime. Foin d’appétit ou de cruauté ! Il fallait y voir au contraire œuvre civilisatrice, dont nous ferions bien de nous inspirer, maintenait-il sous les exclamations outrées de l’assemblée. On voulut le rendre à la raison, mais rien n’y fit : Montaigne persistait à soutenir que les prétendus civilisés d’Occident faisaient preuve de turpitudes bien pires.
La saveur s’estompa. Un autre parfum la remplaça. Je fus projeté, comme mes compagnons, dans un autre salon, mais au XVIIIe siècle cette fois. Et les Lumières, déjà, illuminaient nombre d’esprits. La discussion tournait encore sur le cannibalisme, mais ils étaient à présent plus nombreux à le défendre. Car enfin, si le cannibale mange bien ses morts, encore ne va-t-il pas, comme les Chrétiens, jusqu’à manger son Dieu à l’Eucharistie ! Le salon se remplit des clameurs des catholiques, qui jurèrent qu’on ne pouvait en entendre davantage. Le XIXe siècle leur donnera raison, à en croire les souvenirs épicés qui s’imposèrent ensuite à mon esprit. Les images étaient imprécises, et je ne sus si elles émanaient de la conscience d’un écrivain, d’un philosophe ou d’un homme d’Eglise, mais il y était question de déchéance, d’appétit bestial et désordonné, de pulsions primitives et insatiables. Le cannibale redevenait un sauvage mis au ban d’une humanité dont il s’était exclu. J’entrevis le Radeau de la Méduse et l’effroi qu’il suscitait. Je fus à mon tour ballotté par les flots, affamé et misérable, pris d’une envie sauvage de planter mes dents enragées dans le cadavre dont le bras s’enfonçait dans l’eau froide.
La douceur du miel me fit revenir à moi. Nous passâmes la nuit auprès du chaman. Personne, à vrai dire, n’avait vraiment envie de dormir dans les forêts alentour parcourues par les Iroukaïs. Même si nous comprenions mieux, désormais, leur besoin d’incorporer en eux des parties de nous-mêmes, nous n’étions pas disposés à leur servir de nourriture spirituelle. S’échanger des livres était tout de même plus civilisé ! C’était du moins l’opinion partagée.
Je fis plusieurs cauchemars, dans lesquels j’étais traqué comme un gibier dans des forêts aux arbres gigantesques, ramené à la condition d’un lièvre pris pour livre par des Iroukaïs avides de culture carnée. Ils me rattrapaient. Je tombais. Une main arrachait mes cheveux…
V.5 – Maître Iris
Je me réveillai en sursaut. Forest me tapotait le visage. Perce-neige émergeait, elle aussi, d’une longue torpeur. Le groupe s’était éparpillé pour planter les derniers arbustes. On nous avait laissés dormir, mais il se faisait déjà tard et chacun, sur les consignes de Noël, commençait à ranger ses outils dans la charrette. Sur le chemin du retour, Marie fredonna un chant dont chacun reprit en choeur le refrain. Forest se mot à taper joyeusement dans ses mains pour en marquer le rythme. Devant la Citadelle, nous croisâmes Iris qui marchait d’un bon pas. Il était comme à son habitude absorbé dans ses pensées. Sans doute sur la piste d’une nouvelle théorie…
Il ne fut pas plus loquace durant le repas, répondant par onomatopées à chaque fois qu’on s’adressait à lui. Je connaissais mon ami : quelque chose le perturbait. Rablais fit de son mieux pour le provoquer, mima une nouvelle fois l’air pataud que ce dandy de l’abstrait empruntait quand il croisait Félicitée. Mais ce fut sans succès : Iris ne se donna même pas la peine de protester.
Marie profita du repas pour nous montrer un bracelet d’argent qu’elle avait ciselé elle-même. Elle aimait confectionner des petits bijoux, qu’elle offrait ensuite à l’anniversaire de chacun. Nous avions tous notre petit bracelet gravé à notre surnom, qui scellait encore davantage l’unité du groupe. Celui-ci était taillé pour elle : en apparence simple, discret, il ne se révélait qu’au regard attentif, capable de saisir une subtile maîtrise des proportions. Ce bracelet n’était pas fait pour être montré mais pour être remarqué. Il imposait ses courbes sans ostentation, sa simplicité nue était sa force. Nous fûmes impressionnés.
Lors de la vaisselle, je m’arrangeai pour être seul avec Iris.
« Tu sembles ailleurs mon ami, quelque chose te tracasse ? »
Il hésita à me répondre, visiblement embarrassé.
« Ecoute, tu ne vas pas me croire, mais Isaac m’a dit ce matin qu’il allait demander à ce qu’on m’accorde le statut de Maître. »
J’en restai stupéfait.
« Toi, un Maître?… Déjà… ? »
Je n’osais y croire. Accéder à la maîtrise était le résultat d’un long cheminement. Il fallait convaincre de sa parfaite connaissance d’une discipline. En dominer les principes mais, plus encore, être capable de voir le monde à travers elle, comme des lunettes que l’on chausse et qui font apparaître des formes que l’on ne soupçonnait pas. Iris, je n’en doutais pas, était un génie. Personne, à la Citadelle, ne connaissait mieux que lui la théorie des cordes ou la gravitation quantique à boucles. Isaac lui-même avait du mal à suivre ses démonstrations les plus audacieuses. Il assemblait les concepts comme d’autres jouent aux Lego, par pur divertissement. Je n’avais donc jamais douté qu’il finît un jour par devenir Maître. Mais si jeune ? Nous commencions à peine notre apprentissage. Je regardai mon ami, aussi ravi qu’abasourdi.
« Je préférerais que ça reste entre nous, me fit-il promettre. Je ne voudrais pas compromettre mes chances par une initiative malheureuse de Rablais ou d’un autre. Isaac m’a bien fait comprendre que ma nomination pourrait créer des jalousies et qu’il valait mieux, tant que rien n’était officiel, en dire le moins possible. »
Il avait très certainement raison. Car malgré les grands idéaux qui nous animaient tous, nous restions sensibles aux marques de prestige et de privilèges. Que l’un de nous accède à des fonctions supérieures ne manquerait pas de susciter de l’envie, des rivalités peut-être. Iris n’était pas le seul pensionnaire brillant. Tous avaient été sélectionnés pour leurs capacités à manipuler les idées, pour la qualité de leur réflexion. Tous pouvaient donc, à juste titre, s’estimer dignes d’accéder un jour à la Maîtrise dans le domaine qui était le leur. Les plus solides amitiés se dissolvent parfois sous l’acide de l’ambition et de la jalousie. Il valait donc mieux ne pas fragiliser notre groupe par des fanfaronnades prématurées. Je promis de garder tout cela secret. Mais rien ne pouvait m’empêcher d’être immensément fier de mon ami. Et il n’avait nulle amertume à craindre de ma part : mes ambitions n’étaient déjà plus de ce monde, elles avaient depuis peu un autre univers pour s’exprimer, bien plus prometteur, et des royaumes dont je commençais à peine l’exploration. Nous marchâmes un moment en silence, aussi ému l’un que l’autre.
V.6 – Périclès
Dans la soirée, Perce-neige vint frapper à ma porte, interrompant la lecture du Manuel d’Epictète, que j’avais entrepris de redécouvrir. Elle avait apporté un cidre qu’elle voulait goûter avec moi. Enfin, disons plutôt qu’elle souhaitait discuter avec moi, et que cette dégustation en fournissait le prétexte facile. A force d’entrer dans l’intimité de sa pensée, je commençais à comprendre comment elle agissait. Comment tout était chez elle socialement calculé. Avec bienveillance, certes, car rien ne lui était plus désagréable que de causer du tort à quelqu’un, mais néanmoins avec constance : chacun de ses actes, chacune de ses paroles, était un fil qui vous liait à elle et vous amenait là où elle seule avait conscience. Fallait-il parler de manipulation ? C’était plutôt une fusion orchestrée, chaque fil abolissant un peu plus la barrière qui sépare d’ordinaire un être à l’autre, pour former lentement un duo de deux entités indiscernables, au sens où peuvent l’être deux électrons en mécanique quantique. Comme je savais qu’il était parfaitement inutile de résister, je m’assis docilement à la place qu’elle m’indiqua d’un geste. Elle me servit un verre. Ce cidre était en effet délicieux, mêlant des arrière-parfums subtils de vanille et de cannelle. Je lui en fis compliment.
« Alors, Samuel, comment est-elle, cette terre des Savoirs ? »
Je ne me fis pas prier pour lui narrer mes aventures, n’omettant aucun détail, insistant sur mes frayeurs et sur cette expérience inoubliable d’états plus primitifs de la pensée. Je mimais Neandertal chassant l’aurochs, comme lui-même a dû le faire, il y a 50 000 ans, dans l’espoir d’impressionner une femelle au coin du feu. Qu’avions-nous de si différent de lui ? Pris par mon récit, je tressaillais de peur, guettant l’Iroukaï qui, peut-être, viendrait me dévorer. Perce-neige m’apaisa en glissant ses doigts dans mes cheveux.
Où était-elle allée, de son côté, qu’avait-elle fait ? Je me rendis compte que j’ignorais tout de son propre voyage. Comme si le brin apprenait à compartimenter nos deux expériences.
« Oh, je ne suis pas restée à me rouler les pouces », répliqua-t-elle.
Elle avait repris rendez-vous avec Zératos-Thène, dans l’espoir qu’il l’aiderait à retrouver son père.
« Je ne peux pas faire grand-chose, hélas, lui avait-il répondu, fort gêné de son impuissance. Cela fait des décicycles que j’essaie moi même d’entrer en contact avec lui. J’imagine qu’il prend un soin extrême à ne pas dévoiler où il se trouve. Car j’ai bien peur qu’il connaisse une fin funeste s’il venait par malheur à être arrêté. Quelle avanie, après avoir été un pilier majeur de ce monde ! Mais il en est des Idées comme des humains, n’est-ce pas ? Elles ne sont pas plus reconnaissantes envers ceux qui les ont forgées. L’esprit de Camille est mis à prix, et il est fort à parier qu’ils sont nombreux, au sein de la police des Idées, à rêver d’empocher la prime. »
Zératos-Thène n’était cependant pas sans ressource.
« Diriger la Grande bibliothèque de Nova Alexandrie m’ouvre quelques entrées dans différents cercles bien informés sur tout ce qui se passe dans la cité, avoua-t-il. Il se murmure qu’un aventurier charismatique se fait appeler Périclès, en hommage au célèbre stratège athénien. Est-il réel ? N’est-ce qu’un nom cachant un collectif ? Je n’en sais rien, je ne l’ai jamais rencontré. Mais il aurait fédéré autour de lui un groupe de Nouveaux Alexandrins farouchement attachés à la liberté de penser d’autrefois. Ils se désignent entre eux comme les Frères de Périclès. Et la police des Idées les traque sans ménagement. Sans grand succès non plus. Un de mes informateurs m’a révélé que Camille avait des contacts réguliers, au plus haut niveau, avec ces Frères. Si tu parviens toi-même à entrer en contact avec eux, peut-être réussiras-tu à communiquer avec ton père… »
Perce-neige était sortie perplexe de ce rendez-vous. Elle était excitée d’avoir enfin une piste, mais comment trouver un des ces Frères de Périclès ? Elle avait passé la journée à y réfléchir, assise au bord du port. Elle y observait les navires qui déchargeaient leurs marchandises. Y avait-il des Frères parmi ces matelots ? Comment le savoir sans éveiller les soupçons ?
Un bédouin s’affairait d’un navire à l’autre, hélant les marins comme s’il cherchait quelqu’un. Son manège avait intrigué Perce-neige. Elle était certaine de l’avoir déjà vu quelque part. Le souvenir s’était fait très vite plus précis : il s’agissait de l’ « Ambassadeur » qui nous avait abordé sur l’agora lors de mon premier voyage.
Elle alla l’aborder. Il fut très surpris, mais heureux, de la retrouver.
« Alors, avez-vous trouvé la Grande Bibliothèque ? Avez-vous parlé à Zératos-Thène, demanda-t-il ?
– Nous avons fait tout cela, oui. Et bien d’autres choses encore.
– C’est parfait. Cela rassure toujours un programme de savoir qu’il a accompli sa mission. Je vais pouvoir l’effacer de ma mémoire-cache…
– Vous semblez connaître beaucoup de monde sur ce port.
– C’est un peu ma fonction, comme je vous l’ai dit, d’accueillir certains voyageurs. Du moins ceux qui ont besoin d’une aide… particulière.
– Sans doute certains vous considèrent-ils un peu comme un frère ?
A l’intonation qu’avait prise Perce-neige, l’Ambassadeur comprit aussitôt l’allusion.
– A juste titre, se contenta-t-il de répondre.
– Serait-il possible qu’un frère aide à retrouver… un père ? L’affaire resterait ainsi, pour ainsi dire, en famille.
– Mmmm, chaque famille se méfie des frères ennemis. Mais je peux me renseigner et faire circuler certains messages. Reviens te promener régulièrement sur le port. S’il y a du nouveau, je saurai t’y retrouver. »
L’affaire en était restée là. Perce-neige était ensuite retournée deux ou trois fois sur le port, mais elle n’y avait pas vu l’Ambassadeur. Elle avait flâné le long des berges, observant le manège des navires qui accostaient, se chargeaient de voyageurs et de marchandises, et repartaient au large. D’où venaient-ils ? Où allaient-ils ? Elle n’en savait rien. Beaucoup de ces navires ressemblaient à d’antiques trirèmes, aux influences grecques ou romaines. Elles étaient quasiment semblables à celles qu’elle avait elle-même empruntées pour se rendre en ce monde, quoiqu’elle eût tendance, à présent, à se projeter directement dans la cité sans avoir à accoster au port, comme si des connexions directes avaient fini, pour elle comme pour moi, par se construire.
Certains navires, cependant, bénéficiaient de technologies très élaborées. Même si leurs formes s’inspiraient de modèles antiques ou, parfois, de pagodes asiatiques, elles lévitaient sur l’eau, glissant comme sur un coussin magnétique, en n’émettant qu’un léger sifflement semblable au bruit du vent. C’étaient des « magnétostats », lui avait-on dit. Ils filaient vers des mondes lointains, au-delà de la grande mer. Mais il fallait beaucoup d’edelweiss pour monter à bord. Bien plus que ce que contenait d’ordinaire la bourse d’un Nouvel Alexandrin. Mais qu’irait-on faire au-delà des mers, quand tant de richesses étaient ici à portée ?
Le long des quais, elle aimait suivre les tournois de boule alexandrine. Le principe était simple : l’arbitre lançait une bille – la prémisse – en prononçant un adage, une maxime ou une citation. Chacun lançait ensuite une boule en développant durant sa course un argument. Un argument en phase avec la citation de départ amenait la boule très proche de la prémisse ; un argument cohérent avec un autre, déjà lancé, établissait entre les deux boules correspondantes un champ de force qui construisait un barrage, qu’un contre argument pouvait éventuellement briser, s’il avait assez de force. Deux équipes s’affrontaient ainsi, pointant leurs arguments ou tirant des contre-arguments pour emporter la joute. Le but était de placer à la fin un maximum d’arguments au plus près de la bille de départ.
Ces parties étaient très suivies à Nova Alexandrie. Et certains champions étaient de vraies célébrités. Leurs participations aux tournois amenaient des centaines, voire des milliers de spectateurs au boulodrome central. Les Grands jeux, qui se réunissaient tous les quatre cycles, rassemblaient les meilleures équipes de Nova Alexandrie mais aussi, plus largement, de toutes les terres du Savoir. Chaque discipline avait son propre tournoi, avant que les gagnants de chacune ne vienne se mesurer aux champions des autres. L’ultime équipe était considérée, pour quatre cycles, comme des quasi-dieux. Elle gagnait le droit de séjourner sur l’Olympe, un îlot rocheux suspendu dans les airs, en bordure de la Cité. L’Olympe n’était pas le seul de ces îlots. Il y en avait d’autres, au-dessus de Nova Alexandrie, reliés par des traits lumineux que suivaient de silencieuses navettes, minuscules magnétostats qui permettaient d’aller d’un îlot à l’autre. En levant les yeux, on pouvait suivre leur ballet, durant la journée, à quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres pour les plus élevés. Ces navettes formaient, la nuit, des points scintillants de couleur qu’on pouvait prendre pour des étoiles filantes.
Certains îlots suspendus étaient de petite taille, n’abritant qu’une unique grande villa, d’autres étaient de véritables domaines. Y résider était un privilège, accordé aux dignitaires qui avaient su, par une action d’éclat, gagner l’estime de toute la Cité. De là-haut, la vue était, disait-on, à couper le souffle. Y finir ses jours, au dessus des brumes qui enveloppaient la ville, dans la lumière pure de la gloire, était l’ambition de nombreux Nouveaux Alexandrins.
« Très peu pour moi, avait pesté Zératos-Thène quand Perce-neige l’avait questionné sur ce sujet. La gloire doit y être d’un ennui mortel. Qu’y croise-t-on, si ce n’est ses semblables ? Et je n’ai guère envie de devoir prendre une navette à chaque fois qu’il me prend l’envie d’aller acheter mon pain. Non, je préfère l’animation grouillante des bas-quartiers, ses rencontres imprévues, sa convivialité simple et exubérante. Les idées ne sont pas faites pour finir sur un Panthéon, au-dessus de tous ; elles doivent se mêler sans cesse les unes aux autres. C’est dans ce contact rugueux, malodorant parfois, que se produisent les étincelles de génie », protesta-t-il.
C’était bien l’avis de Perce-neige, qui n’aurait guère goûté non plus la solitude des cimes. Elle s’était cependant juré d’y monter un jour, par curiosité, ne serait-ce que pour y jouir un instant de la vue exceptionnelle sur l’ensemble de ce monde.
Un verre après l’autre, nous bûmes toute la bouteille. Je buvais autant mon verre que ses paroles, qui me plongeaient encore un peu dans l’atmosphère enivrante de cette cité. Je commençais à remplir mes propres carnets des observations que j’y faisais. Je notais tout : les lieux, les personnages, les bâtiments, que j’aurais aimé pouvoir dessiner si j’avais eu un quelconque don dans ce domaine. Je dressais des cartes approximatives, au fil de mes découvertes, maudissant les Maîtres de m’interdire l’accès à l’Annexe qui devait contenir des atlas complets. Je ne comprenais pas cette obstination à garder ces trésors pour eux. Que craignaient-ils donc ?
V.7 – Guide
Le lendemain était un grand jour : celui où devait être choisi le Guide qui remplacerait Camille comme « tuteur des âmes » de la Citadelle. Mon Maître avait occupé cette fonction depuis des années, et il y avait consacré chaque jour une immense énergie, ne prenant jamais son rôle à la légère. La Citadelle l’avait choisi à ce poste, bien des années avant que je ne fisse sa connaissance. Et je ne doutais pas qu’elle avait procédé avec le plus grand soin, car le titre de Guide était tout sauf honorifique : c’était lui qui dirigeait sans bruit les consciences. En prêtre laïc, il écoutait les difficultés des uns et des autres, les peines et les ressentiments, les amours contrariées et les ambitions avortées. Il écoutait et écoutait encore, sans juger, fidèle en cela à la maxime gravée sur le fronton de l’Académie. Puis il conseillait, sans forcer quiconque, aidant chacun à se forger sa propre éthique quotidienne. Son influence pouvait être considérable. Le guide jouait un rôle-clé dans l’harmonie qui devait régner entre ces murs. Un mauvais guide pouvait laisser enfler des rancoeurs comme autant d’abcès qu’il faudrait ensuite percer. Un bon guide, en revanche, parvenait sans avoir l’air d’intervenir, à maintenir un subtile équilibre entre les désirs de chacun. Il savait rassurer, réconforter, mentir aussi, parfois, à bon escient. Garder des secrets, surtout. Il devait avant tout susciter la confiance.
Il était presque dix heures quand, un par un, nous les novices entrâmes dans la grande salle à manger convertie pour l’occasion en grande scène de débat. Les Maîtres se tenaient sur une estrade, répartis autour d’Isaac qui se tenait droit comme la justice. Revêtus d’une tunique, ils arboraient un air sévère et solennel. Nous prîmes place, face à eux, sur des rangées de bancs et de chaises, dans un demi-silence. Nous avions la gorge nouée par une émotion diffuse, tout imprégnés que nous étions par la gravité de l’instant.
Quand nous fûmes tous rassemblés, Isaac s’avança et prit la parole.
« Mes chers novices, entonna-t-il d’une voix que la vieillesse emportait par moments dans les aigus, c’est aujourd’hui un jour important. Nous avons, il y a près d’un an, perdu Maître Camille qui a disparu. A-t-il choisi de nous quitter pour des motifs personnels ? Est-il tombé malade ? Voire pire ? Nous sommes depuis des mois sans nouvelle de lui, malgré nos intenses recherches. J’ai moi-même enquêté, sans succès. Il faut donc se rendre à l’évidence : quelle que soit la cause de son absence, Maître Camille n’est plus parmi nous. Peut-être pour un long moment, peut-être pour toujours. Nous devons désormais continuer sans lui. Or, il occupait, vous le savez, un poste important. Il était celui qui vous représentait au Conseil des Maîtres. Celui qui vous connaissait mieux que quiconque. Il portait les aspirations de chacun. Je sais l’affection que vous lui portiez, la confiance que vous aviez en lui. Il était votre Guide. Non pas, comme dans les textes anciens, avec la barbe sévère et le bâton punitif à la main. Sa mission n’était pas de vous sortir du Sinaï, encore moins de porter votre Croix. Non, il était un Guide au sens où, à l’Académie, nous l’entendons : un directeur des études comme des consciences, car ici l’un ne va pas sans l’autre. Si je cédais aux néologismes modernes dont je me tiens prudemment à distance, je dirais qu’il était d’une certaine manière votre coach. »
Isaac gloussa de son audace, satisfait de voir les sourires s’esquisser dans l’assemblée.
« Soyons sérieux, se reprit-il aussitôt. Camille était donc votre guide, à une époque où ce n’est guère du luxe d’en avoir un de solide. J’aime à croire qu’il s’est acquitté de sa fonction avec talent, si ce n’est avec un génie qui nous manque déjà. J’ai pu voir comment les liens se sont un peu distendus, ces derniers temps. La Citadelle a bruissé de rumeurs, de bruits de parquet qu’il ne faut pas laisser prospérer. Il est plus que temps, nous semble-t-il, de remettre un berger pour rassembler le troupeau. Deux hommes de grande valeur ont manifesté leur désir d’assurer cette fonction. Le premier est Maître de philosophie, vous connaissez sa grande rigueur et son dévouement envers vous. Il n’a jamais compté ses heures pour conseiller vos lectures et vous faire progresser. Je demande à Maître Thomas de s’avancer. »
Le Maître de philosophie s’avança timidement. Il était sans conteste un grand érudit, qui connaissait autant la philosophie que l’histoire, et en particulier celle des Idées. L’histoire des sciences était sa spécialité. Les portraits qu’il nous dressait des grands inventeurs étaient d’une richesse et d’une précision qui nous éblouissaient. Cet homme les avait forcément côtoyés. Il ne pouvait en être autrement. Car il racontait des anecdotes qui ne figuraient dans aucun livre d’histoire, révélait des motivations qui ne pouvaient avoir été connues que les acteurs eux-mêmes. Pour mes camarades, une connaissance aussi intime était quasi-surnaturelle. J’avais pour ma part ma petite idée sur l’origine d’un tel savoir émotionnellement vécu. Je ne doutais pas qu’un jour je le croiserais dans quelque ruelle de Nova Alexandrie. Et peut-être me présenterait-il alors à Newton, Darwin ou à d’autres.
C’était un homme éminemment sympathique, honnête et droit. Il aimait l’excellence, à l’image d’Isaac et de la plupart de nos autres Maîtres, mais sans l’excès de rigidité que pouvait avoir le directeur de la Citadelle. Ferait-il pour autant un bon guide ? Je le trouvais pour ma part un peu gauche dans les rapports humains. Il n’avait pas l’habileté relationnelle de Camille. Thomas était un excellent professeur, mais il avait du chemin à faire, me semblait-il, pour devenir un confesseur.
« Un second Maître s’est également porté volontaire, poursuivit Isaac. Vous l’avez sans doute moins côtoyé, car il n’est parmi nous que depuis quelques années. Il a pour lui la jeunesse puisqu’il n’a guère plus de quarante ans. Il a donc consacré moins de temps à l’étude que Maître Thomas, aussi sa maîtrise est-elle moins assurée, mais peut-être son dynamisme saura-t-il vous séduire ? Je demande à Maître Galet de s’avancer à son tour. »
Bien plus à l’aise en public, le neuropsychologue s’avança d’un pas décidé. Son sourire confiant tranchait avec les manières maladroites de son rival. Droite et fière, Félicitée le fixait avec ferveur, à quelques bancs de moi. Galet était moins érudit, cela ne faisait aucun doute. Mais il avait davantage de charisme, cela en faisait encore moins. Et surtout, il maîtrisait la psychologie sociale, ce qui était un incomparable atout pour ce poste. La psyché humaine n’avait pas de secret pour lui: il naviguait comme un poisson de haute mer dans les strates de l’inconscient et de la mauvaise foi, maîtrisait tous les codes de la communication verbale et non-verbale. Il connaissait précisément nos émotions avant même que nous n’ouvrions la bouche. En clair, il avait le profil. Et il le savait. Serait-il pour autant choisi ? Ce n’était bien sûr pas si simple. Car il était évident que Maître Thomas avait la préférence du Conseil des Maîtres. Isaac avait pour lui les yeux de Chimène. Il n’y avait pas besoin d’être grand psychologue pour savoir qui le chef suprême de la Citadelle allait soutenir de tout son poids.
Or, le Conseil des Maîtres disposait des deux tiers des droits de vote, l’ensemble des novices n’en ayant droit qu’à un tiers. Et Isaac tenait ses troupes d’une main ferme. Cette élection n’était manifestement que de pure forme, pour recouvrir d’un vernis démocratique un choix qui avait déjà été entériné. Il était malgré tout d’usage, même si nul texte ne l’obligeait, qu’un Guide nouvellement élu demandât ensuite formellement, quel que soit le résultat du vote, la confiance des novices qu’il avait pour mission de conseiller. Et il était d’usage que ceux-ci la lui accordassent sans réserve.
Comme la coutume l’exigeait, Thomas prit la parole pour présenter les raisons qui l’avaient incité à se porter candidat.
« Chers novices, chers Maîtres, vous connaissez tous mon engagement envers l’Académie. Cela fait plus de trente ans que je me consacre à elle. Je me souviens encore de mon arrivée. J’avais 24 ans ; je venais de terminer des études de philosophie et j’envisageais sans grande conviction d’enseigner dans quelque lycée de région parisienne. Comme vous, j’étais plein de questions laissées sans réponse. Comme vous, avant de venir ici, j’éprouvais aussi cette sensation de vide, ce désarroi de vivre dans un monde qui n’avait d’autre horizon à m’offrir que l’acquisition laborieuse d’une maison et d’une voiture me permettant d’aller travailler, pour gagner l’argent qui me servirait à payer l’une et l’autre. Pourtant, le monde ne manquait pas, à l’époque déjà, de défis. Nous étions tétanisés par la peur d’un hiver nucléaire, d’une destruction mutuelle d’un bloc contre l’autre. Mais qu’y pouvais-je ? Mon espace de choix se limitait au pavillon que j’allais peut-être acheter, à la marque de ma voiture et des quelques objets de consommation que j’allais m’offrir. Je rêvais d’un autre horizon, sans être séduit pour autant par les groupuscules révolutionnaires que je croisais parfois. La philosophie, qui ne sert pas qu’à faire de belles phrases, me faisait percevoir les failles béantes de leurs idéaux factices. Et comme chacun de vous, j’ai rencontré un homme, ou plutôt, dans mon cas, une femme, ce qui était un peu moins courant à l’époque. Une femme dont l’érudition, mais plus encore, l’expérience profonde de ce monde, m’a ébloui. Elle m’a offert le privilège de venir ici. Et ma vie, comme la vôtre, n’a plus été la même. J’ai découvert que la philosophie n’était pas qu’un jeu logique de rhétorique, qu’elle pouvait se vivre avec intensité et sincérité, pour peu qu’on s’en donnât réellement les moyens. J’ai rencontré des gens prêts à la prendre et à se prendre au mot, à dessiner de vrais horizons et à les suivre. J’ai dévoré des rayons entiers de la bibliothèque. Comme vous, il m’en fallait toujours plus. J’ai commis quelques excès, bien sûr, car j’étais jeune, mais plus jamais je ne me suis senti vide.
Si je vous raconte tout cela, c’est pour vous expliquer que j’étais à votre âge exactement comme vous, que je sais donc ce que vous ressentez, et que l’âge n’a rien effacé de ces souvenirs. Au contraire, il les a enrichis du recul de l’expérience, d’une connaissance intime, aussi, de ce qu’est l’Académie et de ce qu’elle peut vraiment vous apporter. Chacun d’entre vous, ici, a une mission dont il n’a pas forcément conscience. Cette conscience ne vient que peu à peu, à mesure que l’on franchit les paliers vers la maîtrise pour devenir un jour, peut-être, grand Erudit. J’espère que ce sera le cas de beaucoup d’entre vous. Et je serai heureux de vous accompagner dans ce long chemin, comme un guide discret mais présent, à vos côtés pour porter votre sac quand il sera un peu lourd, pour vous suggérer des chemins dont vous n’auriez pas forcément perçu toute la beauté, pour vous dissuader d’emprunter ceux qui mènent dans les marécages et les déserts stériles où tant d’autodidactes se perdent. La maîtrise est un long voyage, qui se prépare avec rigueur et discipline. Certes, chacun d’entre vous suit déjà les pas d’un Maître, que vous avez choisi selon vos affinités et qui encadre jour après jour la rédaction de votre mémoire. Au-delà, je veux être le capitaine qui saura vous faire traverser la mer qui vous sépare de ce que vous voulez vraiment être, affronter les tempêtes et les moments de doute, et vous mener vers des rivages pleins de promesses d’accomplissement… »
Son discours était convaincant. Il paraissait d’autant plus sincère que c’était un homme peu habitué à mentir. Il avait consacré sa vie à l’expression des idées dans leur pure vérité. Maître Thomas était par ailleurs un homme bon. Je le dis sans mièvrerie, car il n’y a pas meilleur mot. Alors autant l’affirmer avec simplicité. On ne percevait dans ses paroles ou dans ses actes aucune trace de calcul. C’était d’ailleurs, me semblait-il, sa principale faiblesse : cet homme serait-il capable, quand il le faudrait, de mentir pour notre bien ? Car c’est bien là toute la complexité des relations humaines : il ne suffit pas d’être bon pour faire le bien. L’enfer, dit-on fort justement, est laborieusement pavé de bonnes intentions. Que dira-t-il à un novice qu’il verrait s’engager avec passion dans une voie pour laquelle il n’aurait guère de talent ? Lui dira-t-il la vérité, au risque de briser son élan, ou saura-t-il manipuler avec profit sa passion initiale pour l’amener, à son insu, vers d’autres contrées plus prometteuses ? Conduire des âmes suppose parfois un brin de duplicité. Il faut savoir masquer parfois ses véritables intentions. Non pour tromper, mais parce qu’il faut bien, pour ainsi dire, nous « faire marcher ». Camille savait le faire avec brio. Et on ne lui en tenait jamais rigueur car il le faisait toujours avec une extrême bienveillance. Mais Thomas pourrait-il jouer ce double jeu ? Trouverait-il les mots pour créer l’illusion porteuse qui nous ferait tous avancer ? Moïse avait tenu ses troupes en haleine pendant quarante ans, dans le désert, avec une image de rivières de lait et de miel. Aurait-il eu un même succès avec de plus réalistes vallées de larmes ? Churchill, certes, y était parvenu… Peu importe, il faut parfois promettre la Lune pour élever quelqu’un d’un simple mètre. Et cela me faisait mal de l’admettre, mais Galet semblait en la matière bien plus compétent.
C’était maintenant à lui de nous convaincre. Il s’avança, resta un un instant silencieux, prenant la pause comme un acteur de one-man-show. Il y avait chez lui un sens du théâtral. Il occupait tout l’espace.
« Chers Maîtres, chers novices…«
Les mots étaient quasiment les mêmes que ceux qu’avait prononcés Thomas. Et pourtant, il y avait quelque chose dans l’intonation, dans sa voix, qui faisait naître de légers frissons. Rapidement, nous nous sentîmes marcher, nous sentions le poids de nos doutes et de nos angoisses sur nos épaules, nous avions soif, froid, nous avancions sous un blizzard qui nous gelait jusqu’aux os, perdus dans une immense toundra nappée de brouillard. Le hurlement des loups, dans de lointaines collines, nous terrifiait. Il est apparu alors, devant nous, muni d’une torche chaude, et nous l’avons suivi. Le brouillard se dissipait, les loups n’étaient que des chiens. Il faisait déjà moins froid, avec une promesse de printemps qui se lisait dans quelques premiers bourgeons qui poussaient sur les arbres. Un horizon se dessinait au loin : notre marche ne serait pas vaine. Un objectif apparaissait. Et nous savions qui allait nous y mener.
C’est alors que j’ai compris. Je me tournai vers Perce-neige, et je vis à son regard incrédule qu’elle aussi avait parfaitement saisi ce qui s’était passé : Galet venait d’utiliser des éléments de psycho-langue. Imparfaitement, car l’illusion avait été loin d’être complète et n’avait duré que quelques secondes. Mais il n’y avait aucun doute sur les techniques oratoires utilisées. Et tous les arguments rationnels seraient à présent impuissants pour briser le charme émotionnel qui s’était instauré. Que valaient les raisonnements face à l’émotion brute d’avoir été physiquement perdu et de s’être réellement senti sauvé par lui. Il était clair que les novices allaient tous voter pour lui. Le jeu était trop inégal pour Thomas : le cortex préfrontal, siège de la raison pure, ne pouvait lutter contre les décisions déjà prises par les strates plus profondes, plus primaires, du cerveau émotionnel. La raison saura ensuite inventer mille prétextes pour ne pas perdre la face, et justifier par des arguments factices un choix fait en dehors d’elle, aux niveaux inférieurs.
Isaac était blême. Il avait compris que Galet avait émotionnellement gagné. Car il devinait, déjà, aux regards de certains Maîtres, qu’eux aussi avaient basculé. Quelle que soit la profondeur de leur érudition, ils étaient des humains comme les autres, dominés par leurs émotions. Eux-aussi plaçaient bien malgré eux l’expérience vécue au-dessus des raisonnements formels. Isaac fulminait, ne voyant pas comment rétablir une situation qui lui échappait de façon imprévue. Il allait devoir avaliser un choix qui n’était pas le sien. Et il n’aimait pas ça.
Galet remporta en effet l’élection. Une mince proportion de Maîtres avait voté pour lui, mais quasiment tous les novices lui ayant donné leurs voix, cela avait été suffisant pour atteindre une très courte majorité. Sans doute les Maîtres qui lui avaient résisté connaissaient-ils le pouvoir de la Langue et avaient su y rester hermétiques. Moi-même, qui avais pourtant eu l’occasion, à plusieurs reprises, de voir oeuvrer cette puissante hypnose, je ne pouvais m’empêcher de voir en Galet un guide bienveillant et protecteur. Cet homme était très fort. Je n’avais plus aucun doute sur sa capacité à nous mener exactement là où il voudrait. Restait à savoir comme allait être géré le conflit qui ne manquerait pas d’advenir entre Isaac et lui.
J’ignore ce que les deux hommes se sont dits. J’imagine qu’ils ont eu une longue discussion juste après l’élection, et qu’Isaac lui a clairement fait comprendre qu’il n’était pas dupe des moyens que Galet avait utilisés pour gagner. Peut-être ce dernier avait-il des arguments solides à faire valoir pour justifier par ailleurs son élection à ce poste. Toujours est-il que leur relation, les jours suivants, resta étonnamment cordiale. Isaac avalisa sans tergiverser le choix fait par les académiciens. Maître Thomas retourna sans rancoeur à ses études et à son enseignement. Et Maître Galet revêtit la chasuble de lin qui officialisait ses nouvelles fonctions.
V.8 – Chasse à l’homme
Qui était vraiment Galet ? Quels objectifs poursuivait-il ? L’homme paraissait sympathique, ouvert, très à l’aise avec les jeunes adultes que nous étions. Et il affichait des positions beaucoup moins élitistes que celles d’Isaac ou de la plupart des autres Maîtres de l’Académie. Peut-être était-il possible d’en faire un allié, qui aiderait les Démocrates à reprendre pied au sein d’une Citadelle où ils semblaient avoir perdu la partie. Peut-être était-il d’ailleurs lui aussi clairement en faveur d’une démocratisation du savoir. Perce-neige et moi, nous ne savions quoi en penser. Ni si nous pouvions nous en ouvrir à lui.
Peu importait, nous avions dans l’immédiat des quêtes plus urgentes à mener. Profitant de l’agitation suscitée par cette élection, nous nous éclipsâmes dans notre Refuge, sous les pins, où le reliquat de réseau de téléphonie mobile permettait à Perce-neige d’accéder, via la passerelle d’Alice, à Nova Alexandrie. Nous passions au Refuge des après-midi entières, qui correspondaient, par une distorsion du temps dont j’ignore encore les mécanismes, à des séjours de plusieurs cycles en terres des Savoirs. Perce-neige explorait chaque ruelle de Nova Alexandrie, à la recherche de son père, pendant que ma propre quête se poursuivait en terres paléontologiques, dans la préhistoire de la pensée symbolique. J’y retrouvais le chaman et ses arbres-livres, et le groupe de chemineurs dont je faisais désormais partie.
Un nouveau partage de thé aux épices me replongea dans les souvenirs lointains d’un Néandertalien. Je compris tout de suite les raisons de l’amertume qu’exhalait le breuvage : cet ancien cousin presque humain avait perdu un de ses compagnons, grand chasseur du clan. La scène prenait corps en moi, dans une succession de sentiments archaïques et de raisonnements primitifs.
(…) Tribu rassemblée en cercles autour des corps. Visages fermés. Mort depuis plusieurs jours. Corps va ramollir, devenir puant. Vers de mouches vont en sortir. Destin à tous ? Devenir liquide pour nourrir vermine ? Pensée insupportable ! Moi gratter tête.
Oreille-coupée creuse un trou. Lui cacher corps dans la terre. Cacher pourriture. Ou autre but ? Corps, vers de mouche, humus… Trou creusé dans cuvette, vers soleil qui couche. Grosse-tête sera bien. Je, Petit-bras, Dos-poilu, coucher Grosse-tête au fond dans trou. Sur dos. Je replier jambes sous cuisses. Petit-bras réfléchir. Etendre bras le long de corps. Poser main sur hanche. Mieux… Plier deuxième bras. Mettre main sur épaule. Pourquoi bouche ouverte ? Crier ? Grosse-tête avoir mal encore ? Je poser pierre sur tête Grosse-tête. Deux pierres sur bras. Bien pour ami de chasse. Poser os animaux tués ensemble. Recouvrir branchages. Peaux pour Grosse-tête donner chaleur. Terre par-dessus. Corps disparaît. Je penser autre chose. (…)
Les saveurs oniriques de l’épice se dissipèrent en bouche. Les chemineurs écoutaient le chaman, qui distribuait des branches cueillies sur l’arbre-livre nourri par la préhistorienne Patou-Mathis. On pouvait lire, sur certaines feuilles, que Neanderthal enterrait en effet les hommes, les femmes et les enfants. « (…) Neanderthal a aussi inhumé, dans des sépultures individuelles, des fœtus et des nouveau-nés. Il avait donc conscience de la valeur d’une vie humaine, même non parvenue à terme (…) », avait-elle écrit. Le site de la Ferrassie, en Dordogne, abrite paraît-il plusieurs corps inhumés : un homme et une femme, déposés en position foetale, plusieurs enfants, aussi, ainsi que quelques fœtus, disposés dans des petites fosses de quelques dizaines de centimètres. Dans l’une d’elle, la plus profonde, le corps d’un enfant de dix ans a été recouvert de graviers, de terre et de cendres, et deux pierres plates superposées. Dans une autre fosse, un bébé d’environ trois mois, et un nouveau-né, recouverts à leur tour de graviers, terre et cendres. Les deux sépultures ont été parées de beaux outils en silex, de pointes et de racloirs.
La plupart des corps seraient orientés d’est en ouest, suivant la course du soleil. Ils seraient allongés sur le côté, en « chien de fusil ». Une position du sommeil, ou qui symbolise peut-être un retour dans le ventre maternel, mais qui est dans tous les cas peu naturelle chez un cadavre. Les corps auraient donc été manipulés, après le 3e jour, une fois dissipée la rigidité cadavérique.
Curieux d’en savoir plus, j’attrapai une feuille que me tendait le chemineur assis à côté de moi, pour la lire à mon tour :
(…) Dans quatre sépultures de la Ferrassie, les Néanderthaliens ont déposé sur les corps des dalles de pierre, dont une creusée de cupules. Ces dalles servaient peut-être à protéger les corps des détériorations ultérieures (de la part de nouveaux occupants ou de charognards). Mais elles pouvaient également avoir une signification symbolique liée à un rituel particulier qui nous échappe (peut-être, par exemple, pour que le mort ne sorte pas de sa sépulture). (…)
Néanderthal avait donc, déjà, ses propres rites, dont la signification profonde n’était connue que de lui seul ! La découverte, dans certaines tombes, de corps sans tête, ou de crânes isolés, permettait même d’affirmer que Néanderthal prélevait parfois le crâne des morts. « (…) En cela, on peut considérer qu’il pratiquait le culte des ancêtres et que, peut-être, il en est l’initiateur ! (…) », avait écrit Marylène Patou-Mathis.
Nous nous fîmes passer, d’un chemineur à l’autre, une large feuille sur laquelle la préhistorienne synthétisait ses réflexions :
(…) Comme l’atteste la diversité des rites funéraires pratiqués par Neanderthal, la mort suscitait chez lui émotion et réflexion. Dans toutes les sociétés, la mort a un rôle socialisant, le groupe est uni par ses morts. Il ne peut exister de groupe sans mémoire et cette mémoire se cristallise autour ou sur eux, car les ancêtres transmettent des héritages qui à leur tour seront transmis. Ils jouent donc un rôle fédérateur et doivent être honorés. Les rites pratiqués en l’honneur des morts permettent de faire resurgir les connaissances et les savoir-faire, les traditions, voire les mythes sans lesquels un groupe social ne peut vivre. (…)
Néanderthal était loin d’être cette brute épaisse, basse du front que les premiers paléontologistes avaient décrite. De toute évidence, les premiers Européens méritaient mieux que cette caricature. Leur intelligence était sans doute – au moins potentiellement – comparable à la nôtre. Comparable, aussi, à celle des Homo sapiens venus à leur tour d’Afrique, qui s’engagèrent en Europe il y a quelques dizaines de milliers d’années.
Ces proto-humains manipulaient des objets différents, et créaient des symboles différents. Sans doute parce que l’un n’allait pas sans l’autre. Ils fabriquaient des pointes de projectiles en matière dure d’origine animale, ils peignaient des fresques sur les murs des grottes, en Ardèche ou ailleurs, ciselaient des sculptures en ivoire.
« Une chose est sûre, expliqua un chemineur attablé avec nous, les Néanderthaliens et les Homo sapiens ont cohabité en Europe il y a environ 30 000 ans. »
Comment s’est passée la rencontre, le premier choc culturel de l’histoire des humanités ? C’est la question qui nous taraudait tous. Pour les Néanderthaliens habitués à vivre isolés, dispersés sur leurs terres depuis des centaines de milliers d’années, le contact avec ces humains à la peau sombre, au front haut et bombé et au menton proéminent a dû être un choc. Dans l’agora rocheuse d’une caverne, une façon de penser s’est heurtée à une autre. Des ponts se sont-ils construits ? Ou ce choc des civilisations a-t-il conduit à une guerre sans merci ? Et si des ponts se sont construits, qui a réellement influencé qui ? Question absurde, sans doute, car il ne peut y avoir d’action sans réaction. Et pourquoi seul Homo Sapiens a-t-il survécu à la rencontre ? Pourquoi Néanderthal a-t-il disparu, en quelques milliers d’années à peine, de la surface de la Terre.
« Peut-être était-il simplement moins intelligent, hasarda un chemineur en tirant sur sa pipe. »
Cette explication ne nous satisfaisait pas, tant les preuves d’une forte activité symbolique chez Neanderthal étaient à présent évidentes. D’ailleurs, n’avait-il pas un cerveau plus gros que celui des Homo Sapiens ?
« Ou alors, il a été foudroyé par une épidémie », proposa une chemineuse.
Peut-être. Après tout, c’est bien le funeste destin que connurent les Indiens d’Amérique, lorsqu’ils rencontrèrent les premiers Occidentaux. Mais il aurait fallu que l’épidémie touchât l’Europe entière, frappant des tribus qui avaient assez peu de contacts entre elles. L’hypothèse méritait d’être creusée, mais nous n’étions guère convaincus.
Alors quoi ? Fallait-il se résoudre à l’idée que les humains avaient exterminé les Néanderthaliens ? Qu’ils portaient sur leurs mains les traces d’un premier génocide ?
« Et s’il fallait voir là le véritable péché originel ? lança le fumeur de pipe.
– Homo sapiens puni pour avoir tué son cousin ? traduisit son voisin.
Nous acquiesçâmes en silence. Non pas que nous prenions cette idée comme vérité, mais parce qu’elle exprimait potentiellement quelque chose d’intéressant à creuser, sur une possible mauvaise conscience collective qui aurait pu germer à l’occasion d’un tel génocide.
Les faits, cependant, étaient têtus : quasiment aucun squelette de cette période n’avait été retrouvé avec des marques de chocs violents qui auraient pu témoigner d’un massacre. D’ailleurs, Néandertal était physiquement plus fort que Sapiens. Il n’était pas certain qu’une guerre lui eût été défavorable. Et pourquoi se seraient-ils combattus : les Néandertaliens n’étaient au plus que 70 000, répartis sur toute l’Europe. Il y avait bien assez de place pour tout le monde ! Non, les chemineurs avaient consommé suffisamment d’humus et lu d’arbres-livres pour savoir que les préhistoriens privilégiaient une coexistence pacifique, des échanges de savoir-faire. Voire plus, si affinités ?
Des gènes sont bien passés, d’une espèce à l’autre, puisque le génome humain comporte aujourd’hui 1 à 4 % de gènes néandertaliens. Des hommes et des femmes des deux communautés s’étaient donc accouplés.
« Moi, je dis que tout était déjà joué bien avant l’arrivée de Sapiens« , proclama un petit chemineur qui était resté jusque-là silencieux.
Nous le fixâmes, attendant qu’il précisât sa pensée.
« Car enfin, les chiffres parlent d’eux mêmes. En tout cas, ceux que j’ai réussi à récupérer. Si on regarde la démographie, les Néandertaliens étaient déjà sur le déclin avant même que Sapiens ne mette un orteil en Europe ! Ce n’est ni une affaire d’intelligence, ni une affaire de guerre ou d’épidémie, juste une question de sexe et de mathématiques : les Néandertaliens se reproduisaient tout simplement trop lentement. Face à eux, Sapiens était un vrai lapin : 15 000 ans après leur arrivée en Europe, les Sapiens étaient déjà dix fois plus nombreux que ne l’étaient les Néandertaliens lorsqu’ils les avaient rencontrés. »
Cela pouvait-il être aussi simple ? Sapiens vainqueur juste parce qu’il copulait plus souvent et plus efficacement ?
« Si j’avais su que l’obsédé sexuel fût un jour l’avenir de l’humanité », pouffa l’un de nous.
Chacun y alla de sa petite grivoiserie, dans un brouhaha de rires désinhibés.
« La fornication n’est peut-être pas seule en cause, poursuivit plus sérieusement celui qui, depuis le début de l’expédition, avait pris la place de chef de troupe. Car il semble que les Néandertaliens n’aient pas eu non plus beaucoup de chance : j’ai lu que lorsqu’un Néandertalien s’accouplait avec une Sapiens, le chromosome Y du bébé mâle porté par la femme Sapiens déclenchait peut-être une réaction immunitaire qui provoquait une fausse couche. Du coup, les hommes néandertaliens ne pouvaient pas renforcer leurs effectifs en intégrant dans leurs clans des femmes Sapiens, alors que l’inverse était possible. »
Un puzzle, d’un coup, s’assemblait. Des effectifs clairsemés, une espèce nouvelle qui se reproduisait plus vite, et un désavantage génétique qui empêchait de tirer vraiment profit de la rencontre : tout jouait contre Néandertal. Sapiens ne pouvait, en quelques millénaires, que s’imposer, qu’il ait été plus intelligent ou pas. Et ses gravures flamboyantes ont pris la place des plus discrètes productions indigènes, notamment sur les murs de la grotte Chauvet.
V.9 – Sanctuaire
Le groupe de chemineurs qui m’avait recueilli était arrivé au terme de leur quête. Ils avaient trouvé dans les terres des Savoirs une réponse cohérente à la question qui les tourmentait. Et cette réponse était apaisante : non, Homo sapiens ne s’était pas forcément élevé sur le meurtre de ses cousins. Ni meilleur ni pire, il avait sans doute eu simplement plus de chance, et plus d’aptitudes à se reproduire. C’était aussi une belle leçon d’humilité à opposer aux eugénistes : ce sont parfois des détails en apparence insignifiants qui assurent la survie d’une espèce à long terme. Les plus intelligents, les plus forts, les plus agiles, peuvent s’effacer devant ceux qui, tout simplement, maîtrisent mieux le sexe.
Nous quittâmes le chaman, prêts à reprendre la route vers Nova Alexandrie. Dans nos bourses, de précieux edelweiss avaient poussé, gratifiant le savoir nouveau que nous avions acquis, et que nous pourrions transmettre et échanger. Le petit groupe de chemineurs était d’accord pour me ramener vers mon canoë. Car s’ils avaient achevé leur quête, j’avais pour ma part à peine entamé la mienne. Qu’est-ce que la pensée ? Qu’est-ce qu’une Idée ? La conscience d’une Idée ? Et comment pouvait-elle faire émerger tout un monde ? Les questions continuaient de se bousculer dans ma tête. Je n’étais qu’au début d’un long voyage. J’avais conscience qu’il me fallait d’abord apprendre à repérer les arbres-livres, pour m’enrichir de leurs feuillages. Un chemineur aguerri me donna pour cela quelques conseils.
« Vois-tu, les arbres-livres ont des feuilles un peu plus grosses que les arbres ordinaires, et elles ont un aspect un peu translucide. Observe la différence, me dit-il en me montrant côte-à-côte une feuille de chaque. Mais c’est surtout l’emplacement qui doit te mettre sur la piste. Les arbres-livres ont tendance à pousser dans des endroits qui pourraient paraître incongrus pour un arbre. Au milieu d’un monument, par exemple. Ou seul sur une vaste plaine. Ou alors, il est au contraire suivi d’un sillage d’autre petits arbres, comme un chef de file. Certains font des rhizomes souterrains pour émettre de nouvelles pousses des dizaines de mètres plus loin. D’autres poussent à l’envers, envers et contre tous. Il m’a fallu des années pour apprendre à les repérer. Tiens, regarde par exemple cette colline… »
Il pointa du doigt un petit relief, à quelques dizaines de mètres de nous, en haut duquel se dressait un arbre au tronc puissant et au feuillage particulièrement fourni. Nous marchâmes vers lui. Et je remarquai en effet que cet arbre avait une façon particulière de refléter la lumière. Chaque feuille agissait comme un prisme qui en décomposait les couleurs. Une myriade d’arcs-en-ciel apparaissaient pour disparaître aussitôt. Le chemineur n’eut pas besoin de me le préciser: seul un arbre-livre pouvait créer un tel jeu de lumière. Son tronc laissait apparaître son titre, comme une gravure naturelle de l’écorce : Sapiens, une brève histoire de l’humanité. L’auteur qui l’avait fertilisé ressortait comme une excroissance : Yuval Noah Harari.
« Cet arbre est connu de nombreux chemineurs, son feuillage a un certain succès », souligna-t-il.
J’avais en effet entendu parler de cet ouvrage de vulgarisation, dans mon monde, sans avoir jamais eu le temps de le feuilleter. Comme ses branches étaient fortes et accessibles, il était aisé d’en escalader le tronc pour accéder à l’ensemble du feuillage. L’arbre avait fait de son mieux pour faciliter la lecture. Il n’était pas comme certains, qui mettaient leurs premières branches – volontairement ? – à des hauteurs telles que nul ne pouvait y accéder sans l’aide d’une échelle. Je parcourus quelques premières feuilles au hasard. Il y était question de l’incroyable accélération de la pensée, survenue chez Homo sapiens il y a entre 70 000 et 30 000 ans.
(…) La période qui va des années 70 000 à 30 000 vit l’invention des bateaux, des lampes à huile, des arcs et des flèches, des aiguilles (essentielles pour coudre des vêtements chauds). Les premiers objets que l’on puisse appeler des objets d’art ou des bijoux datent de cette ère, de même que les premières preuves irrécusables de religion, de commerce et de stratification sociale. (…)
J’en attrapai une autre, que je détachai de l’arbre pour la lire plus à mon aise. « Tu peux les détacher à ta guise, elles repousseront très vite. Le feuillage d’un arbre-livre se reconstitue en permanence », me rassura le chemineur. Je pris le temps de la parcourir.
(…) L’apparition de nouvelles façons de penser et de communiquer, entre 70 000 et 30 000 ans, constitue la Révolution cognitive. Quelle en fut la cause ? Nous n’avons pas de certitude. Selon la théorie la plus répandue, des mutations génétiques accidentelles changèrent le câblage interne du cerveau des Sapiens, leur permettant de penser de façons sans précédent et de communiquer en employant des langages d’une toute nouvelle espèce. (…)
Pour l’auteur dont la pensée avait fertilisé cet arbre, l’accélération de la pensée symbolique observée durant cette période, qu’il appelait Révolution cognitive, aurait donc été due à des mutations génétiques. Le cerveau des Sapiens aurait dérivé pour acquérir de nouvelles capacités, en particulier dans le domaine du langage. J’explorai cette piste. Elle me rappelait mes vieux cours de philosophie, qui insistaient sur la spécificité du langage humain: alors qu’un singe crie à ses congénères pour les prévenir qu’une panthère arrive, seul l’homme peut préciser que la panthère arrive du côté de la rivière, qu’elle marche lentement, accompagnée de deux autres, qu’elles semblent toutes les trois utiliser la même tactique que la semaine dernière, lorsqu’elles avaient déjà failli nous prendre au piège, et qu’il serait donc plus prudent de fuir dans une autre direction. Cette capacité de moduler ainsi à l’infini le signal était-elle une spécificité de Sapiens ? Néandertal en avait probablement été lui aussi capable. Mais il n’était plus là pour en témoigner. A moins que je n’en retrouvasse un jour la trace en partie décomposée dans l’humus…
L’arbre-livre se concentrait sur Sapiens. Et soulevait sur d’autres feuilles un point qui m’intéressait : une théorie prenait comme hypothèse que notre langage n’avait pas évolué pour transmettre des informations sur nos prédateurs, mais pour mieux… colporter des ragots. Foutaises ? Ce fut aussi, je vous l’avoue, ma première réaction. Mais cela ne l’était pas tant que cela, si l’on considérait que l’humain était d’abord un animal social. Il vivait en groupes, en interactions permanentes. Et sans la force collective de son groupe, malgré toute son intelligence, un Homo Sapiens seul ne survivait sans doute pas plus de quelques jours aux multiples prédateurs. C’est ce qu’expliquait d’ailleurs une autre feuille:
(…) La coopération sociale est la clé de notre survie et de notre reproduction. Il ne suffit pas aux hommes et aux femmes de savoir où sont les lions et les bisons. Il importe bien davantage pour eux de savoir qui, dans leur bande, hait qui, qui couche avec qui, qui est honnête, qui triche. (…)
L’être humain aurait donc pu, il y a quelques dizaines de milliers d’années, acquérir cette capacité singulière, unique dans tout le règne animal, de parler dans le dos des autres, de propager sans cesse des rumeurs, vrais ou fausses, d’imaginer qui couche avec qui, qui s’est montré loyal et qui a été fourbe, ce qu’untel aurait dit ou fait, aurait dû dire ou faire, aurait pu dire ou faire, toute la journée, dans un brouhaha continuel d’informations sociales que les réseaux sociaux électroniques n’ont fait, des millénaires plus tard, qu’amplifier.
Futile ? Certes non! Car ce commérage incessant aurait permis de construire des groupes plus grands, au sein desquels des collaborations plus fines ont pu émerger, basée sur la confiance mutuelle que se portaient ses membres.
Ce commérage se serait surtout doublé d’une autre caractéristique du langage humain : la capacité de parler non pas seulement de son voisin ou de la panthère qui approche, mais aussi, et surtout, de choses qui n’existent pas. D’objets qui ont existé dans le passé, d’autres qui existeront dans le futur, et d’autres encore, qui n’ont jamais matériellement existé et n’existeront jamais. Et d’en parler pourtant, comme si l’on pouvait les toucher. De parler de la panthère, certes, mais aussi de l’ « esprit de la panthère », puis du symbolisme de la panthère. L’homme s’est mis à raconter des histoires. Au côté des êtres de chair et d’os avec lesquels il vivait sont apparus autant d’êtres imaginaires que son esprit pouvait concevoir, animés à leur tour d’intentions. Il s’est mis à se projeter aussi bien dans le passé que dans le futur, salivant par avance à la perspective d’un festin dont rien, pourtant, n’était réellement devant ses yeux. Comment cela a-t-il été rendu possible ? Et quel avantage immense cela lui a-t-il apporté sur les autres animaux ?
Un sifflement d’air coupa net le cheminement de ma pensée.
Tchac ! Une flèche s’enfonça dans le tronc, à un mètre à peine de moi. Une autre flèche se ficha dans le sac d’un chemineur, à quelques centimètres de sa poitrine. Malik hurla de nous mettre à couvert. Pour qu’il se donnât ainsi la peine de parler, la situation était critique. Je sautai de l’arbre et courus vers la forêt proche. Nous devinions des silhouettes qui avançaient de buissons en buissons. Elles décochaient des flèches qui allaient se planter dans les troncs qui nous protégeaient. Nous nous regroupâmes derrière Malik, sans trop savoir quoi faire.
« Les Iroukaïs nous ont suivis », chuchota-t-il, l’air grave.
Nous étions terrifiés. Ces sauvages étaient armés d’arcs, de sagaies, de massues. Nous n’avions rien pour nous défendre, si ce n’étaient quelques pierres à lancer, ou de maigres couteaux en cas de corps-à-corps. L’issue du combat paraissait trop évidente.
Il nous fallait fuir. Mais vers où ? Et comment ? Nous étions tapis, à plat ventre dans les hautes fougères qui nous dissimulaient. Les Iroukaïs hésitaient encore à s’approcher. Sans doute ignoraient-ils que nous n’étions pas armés. Mais déjà les plus hardis avançaient, un pas après l’autre, en prenant soin de ne pas s’exposer. Leur prudence nous laissait un répit de quelques minutes. Mais cela ne durerait guère. Nous fixions tous Malik, attendant de lui je ne sais quel miracle, mais je compris à son regard inquiet qu’il n’avait pas plus d’idée que nous pour sortir de cette souricière.
La peur nous labourait le ventre. Elle submergeait tout comme une vague incontrôlable. Nous étions ramenés au statut de gibier traqué par une horde de chasseurs cannibales. Et nous étions trop intelligents pour nous faire la moindre illusion sur nos chances de survie.
« J’ai peut-être une idée, murmura un chemineur. Je ne sais pas ce que ça vaut, ni si ça nous sauvera. Mais il me semble avoir vu sur une carte l’existence d’un sanctuaire tout près d’ici, une ancienne nécropole du début du néolithique. Le chaman nous a bien dit que ces sauvages craignaient les lieux chargés en symboles… »
Je commençais à comprendre où il voulait en venir. Au combat, nous n’avions en effet aucune chance. Nous n’avions pas d’arme… physique. Mais le cerveau humain tire de sa force ses propres faiblesses : peut-être pouvions-nous essayer contre eux des armes psychologiques, mettre de notre côté le pouvoir des symboles sur l’esprit ?
Du doigt, il nous indiqua la direction. Le sanctuaire se trouvait à un kilomètre environ. Un petit sentier y menait. En courant vite, peut-être parviendrions-nous à l’atteindre sans être rattrapés ou touchés d’une flèche ? L’espoir était mince mais il n’était pas nul. Et nous n’avions de toute façon rien de mieux.
Alors chacun rassembla son courage. Nous lançâmes une volée de pierres pour gagner de précieuses secondes et chacun de nous se mit à courir, aussi vite qu’il le put, en zigzaguant pour ne pas offrir aux arcs des cibles trop faciles.
Nous courions avec l’énergie du désespoir, que seul possède celui qui lutte pour survivre, persuadés que le premier à ralentir ne reverrait plus les autres. Mon coeur cognait ma poitrine, l’air brûlait ma gorge et je ne sentais plus mes chevilles. Les fougères nous giflaient les jambes. Les branches basses nous cognaient la tête. Nous entendions les flèches siffler. Un chemineur cria, mais continua à courir. Chaque pas nous rapprochait du but, augmentait nos chances de survivre…
Une première statuette de bois, gravée sur un arbre, nous confirma enfin l’entrée du sanctuaire. Nous courûmes encore, au milieu des tombes, jusqu’à la grotte ornée entourée de menhirs, qui avait dû servir de temple primitif. Nous nous y réfugiâmes, guettant avec angoisse nos poursuivants.
L’intuition du chemineur était bonne : les Iroukaïs n’osèrent pas s’approcher. Ils s’arrêtèrent à la limite du sanctuaire; une frontière invisible les empêchant de faire un pas de plus. Victoire du symbole sur la matière! Nous avions gagné un précieux répit, que nous mîmes à profit pour nous compter rapidement : tout le monde était là. Certains s’étaient blessés légèrement, d’autres plus gravement. Deux d’entre nous avaient reçu une flèche, dans la cuisse pour l’un, dans le ventre pour l’autre. Mais par miracle, aucun organe vital semblait n’avoir été touché. Malik dénicha quelques herbes dont le jus avait des propriétés antibiotiques et cicatrisantes. Nous nous en appliquâmes, faute de mieux, sur nos plaies. Une de mes cheville avait vilainement gonflé.
Nous sentions que nous étions ici en sécurité. Les Iroukaïs n’oseraient jamais pénétrer ces lieux. Du moins, nous l’espérions. Les statuettes et autres symboles disposés régulièrement agissaient comme autant de remparts protecteurs, de portes qu’ils ne pouvaient franchir. La matière ne pouvait rien sans l’esprit qui la commandait : ces talismans nous protégeaient plus efficacement qu’une barrière de feu.
Combien de temps allions nous pouvoir tenir ici ? Nous fîmes un foyer pour cuire un lièvre que Malik avait réussi à attraper entre deux pierres. Tandis que je fixais les flammes, mes nerfs se relâchaient. Je pris conscience que dans la panique, j’avais uriné sur moi. Mon pantalon collait et grattait. Peu m’importait, j’étais vivant. Les flammes exerçaient leur pouvoir hypnotique, tandis que je plongeais peu à peu dans une langueur épaisse.
V.10 – Frères et soeurs
Une odeur de brûlé me fit sursauter. Perce-neige avait apporté quelques saucisses qu’elle faisait cuire sur un petit barbecue de pierre à côté du Refuge.
« Tu dormais si bien, je n’ai pas voulu te réveiller », me sourit-elle.
De mon doigt, je creusai un tunnel dans la mie d’un quignon de pain et j’y glissai avec gourmandise une saucisse chaude pour me confectionner un hot-dog. Tout en mangeant, je racontai mes aventures sauvages à Perce-neige. Elle-même avait avancé dans ses recherches. L’Ambassadeur avait obtenu pour elle un rendez-vous auprès d’un Frère de Périclès. L’entrevue avait eu lieu dans les jardins de la grande Bibliothèque, avec la complicité – ou tout au moins la bienveillance – de Zératos-Thène.
Plutôt qu’un Frère, c’était une Soeur qui s’était présentée à elle. Drapée à la romaine, elle portait une tunique composée de deux pièces de laine cousues sur l’un des côtés, dans laquelle elle avait passé sa tête et ses bras. Elle portait sur ses épaules une stola brodée et bordée de pourpre. Un grand châle lui descendait jusqu’à la taille, dont elle ramenait un pan sur sa tête. Pour se protéger du soleil, mais aussi pour masquer en partie son visage. Elle s’était assise à côté de Perce-neige, sur la margelle d’une fontaine qui rafraîchissait la cour intérieure de la bibliothèque.
« J’aime beaucoup cette fontaine, avait-elle dit innocemment. Cette eau qui s’écoule est une belle métaphore du savoir qui irrigue en continu la ville…
– … comme du temps qui file entre nos doigts », avait répondu Perce-neige, respectant à la lettre le protocole d’authentification convenu avec l’Ambassadeur.
C’était bien la réponse qu’attendait la jeune femme. Elle proposa à Perce-neige de se promener dans les jardins de la bibliothèque, au milieu des roses dont la culture exigeante était depuis longtemps la grande passion de Zératos-Thène.
« Vous cherchez un Frère, m’a-t-on dit.
– Un père, en fait. Mais quelque chose me dit que les Frères pourraient me mettre sur sa piste.
– Cela se pourrait, en effet, confirma-t-elle en marchant.
– Avez-vous eu de ses nouvelles, demanda Perce-neige, le coeur battant.
– Personnellement non, bien sûr. Mon rôle se réduit à transmettre des messages. Mais nous l’avons tous en profonde estime. Comme mes Soeurs et mes Frères, je sais ce qu’il a fait pour ce monde et ce qu’on lui doit. Il a toujours été du côté des modestes, des iconoclastes. Qu’il soit aujourd’hui obligé de se cacher est une honte, un pitoyable abus de pouvoir du Conseil. »
Elle s’arrêta un instant, réfrénant avec peine sa colère.
« Enfin quoi, qu’arrive-t-il à ce monde ? De cycle en cycle, il perd son ouverture, sa tolérance aux nouvelles idées. Le Conseil impose un carcan qui nous étouffe. Il va finir par tuer cette cité avec ses obsessions. Son idéal de pureté ne rime à rien. C’est un virus qui se propage comme une peste de l’esprit. Pensez que des voisins en sont venus récemment à me reprocher mes origines non académiques, car je viens moi-même des lointaines contrées de l’Esotérie. Alors, quand j’ai entendu parler de Périclès et de son combat pour la coexistence démocratique des idées, pour l’accès à tous de Nova Alexandrie, quelles que soient vos origines, j’ai ressenti comme une bouffée d’oxygène dans un air qui devenait lentement irrespirable.
– Avez-vous déjà rencontré Périclès ? demanda Perce-neige.
– Non. À vrai dire, je ne sais même pas à quoi il ressemble. C’est une sécurité : si l’un de nous est interrogé par la police des Idées, il ne pourra révéler ce qu’il ignore. Je serai donc bien incapable de mettre quiconque sur la piste de Périclès : je ne sais pas qui il est, et encore moins où le trouver. Je peux en revanche vous faire rencontrer différents Frères mieux introduits que moi auprès de lui. »
Il fut convenu avec cette femme, qui s’était présentée sous le prénom de Stella, que Perce-neige serait admise à une réunion de Frères qui devait avoir lieu bientôt. Elle y rencontrerait des personnalités qui sauraient la mettre sur la piste de Camille. Le lieu de rendez-vous était éminemment symbolique : dans une crypte creusée sous d’anciennes catacombes. Suivant à la lettre les consignes de Stella, Perce-neige s’était rendue à la Taverne du Livre Blanc, dans le vieux quartier autour de la Bibliothèque. Elle s’était attablée au fond de la salle, au milieu des étudiants et des professeurs qui formaient la clientèle plutôt distinguée de cet établissement.
« Votre tarte au citron est-elle bien meringuée ? a-t-elle demandé au serveur.
– Elle est faite maison, mademoiselle, lui répondit l’employé d’un air faussement offusqué.
– Je vais plutôt prendre un mille-feuille, enchaîna comme convenu Perce-neige. Avez-vous des toilettes?
– Bien sûr. Si vous voulez bien vous donner la peine de me suivre, je vous en montre le chemin.
– Volontiers. »
Perce-neige s’était levée et avait suivi docilement le serveur. « C’est dommage, avait-elle pensé, j’aurais bien mangé quelque chose ». Elle avait traversé la cuisine et s’était retrouvé dans l’arrière-cour. Le serveur, sans dire un mot, lui désigna une porte qu’elle poussa. Elle descendit un escalier de pierre en colimaçon, qui s’enfonçait dans les profondeurs. Ses yeux mirent du temps à s’habituer au faible éclairage.
Jusqu’où est-elle descendue ? Elle ne pouvait le dire. L’escalier donnait sur une galerie plus large, traversée d’un air frais. Au bout lui parvenaient les murmures de conversations lointaines. Elle s’approcha lentement, intimidée par l’étrangeté du lieu. Mieux éclairée, la paroi révélait ça et là des représentations primitives, comme inspirées de l’art rupestre. Des animaux colorés, des scènes champêtres… Les thèmes représentés témoignaient d’une alliance forgée, ou recherchée, entre l’homme et la nature. Perce-neige se sentit en confiance. Un homme en tunique blanche vint l’accueillir avec chaleur.
« Bienvenue à toi, ma Soeur !
– La réunion a-t-elle commencé ?
– Point encore. Mais installe-toi, je t’en prie. »
La galerie se terminait par une salle creusée dans la roche. Une vingtaine de chaises y avaient été installées, dont la plupart étaient déjà occupées. Elle s’assit au fond, prenant soin d’avoir une vue suffisante sur l’estrade qui faisait face. Autour d’elle, des hommes et des femmes, plutôt âgés, conversaient. On s’enquérait de la santé d’un proche, on critiquait les dernières injonctions du Conseil. L’humeur était à la fois joyeuse et recueillie, comme avant un récital ou une conférence d’érudit.
De part et d’autre de la pièce, une abeille avait été gravée comme un emblème, sur des panneaux de bois. L’Ambassadeur en avait expliqué à Perce-neige la symbolique : besogneuse, l’abeille fertilisait sans relâche et sans bruit, à chaque printemps, les fleurs qui se transformaient grâce à elle en fruits. Qui, mieux qu’elle, pouvait représenter l’action souterraine mais continue du peuple sans grade de Nova Alexandrie, dont l’élite tirait son miel ? L’abeille était si nécessaire à la bonne marche du monde que, selon la célèbre citation attribuée à Einstein, « si elle venait à disparaître de la surface du globe, l’humanité n’aurait plus que quatre ans à vivre ». Plus d’abeilles, plus de pollinisation, plus de plantes, plus d’animaux, plus d’hommes… Le raisonnement se tenait. Peut-être Einstein s’était-il trompé d’une année ou deux dans sa prédiction, voire dix. Peu importe, au fond, puisqu’il est établi que le facétieux physicien n’a en fait jamais prononcé ces mots. L’essentiel était dans le message implicite : sans le labeur du demos, du peuple travailleur qui s’épuise à la tâche, la fière élite ne survivrait guère longtemps. Cette leçon avait vocation à promouvoir l’humilité : les plus nécessaires au système, les « premiers de corvée », sont rarement ceux qui en recueillent les fruits. L’humanité avait fort à gagner à étudier et à comprendre ce petit hyménoptère.
Quant à la ruche, n’était-elle pas un trait d’union parfait entre l’ordre naturel et l’ordre culturel ? Un ordre spontané, génétiquement programmé diraient certains, et pourtant si semblable à nos organisations humaines. Un ordre qui, à partir d’un insecte banal et fragile, fait émerger des comportements collectifs capables des plus grandes prouesses. « Intelligente, dévouée, fiable, fidèle, altruiste, travailleuse, économe, géomètre, d’une propreté exemplaire, d’une pureté à toute épreuve, etc., la liste de ses qualités emplit des milliers de pages de la littérature antique, médiévale… et contemporaine. Et on retrouve en elle l’ambivalence nature/culture, puisqu’elle reste sauvage à l’état domestique (sa piqûre est redoutable) et domestique à l’état sauvage (elle produit le miel même sans apiculture). Bref, le monde de l’abeille se situe, dans toutes ses dimensions, à la charnière trouble de plusieurs ordres du réel : le végétal et l’animal, le terrestre et le céleste, la nature et la culture, le vivant et l’éternel, l’humain et le divin… », s’enflammait l’auteur d’un ouvrage que Perce-Neige avait consulté à la Grande Bibliothèque, tiré d’un arbre-livre rapporté par un voyageur des contrées philosophiques. Cet écrit, fort justement intitulé « L’Abeille (et le) philosophe », avait germé des réflexions croisées d’un philosophe et d’un apiculteur. Il en avait résulté un arbre-livre aux formes excentriques, baroques mais pleines de vie. Où les abeilles avaient, comme il se devait, élu domicile dans les boursouflures d’une grosse branche, faisant leur miel d’une littérature qui les concernait au premier chef, fertilisant du pollen emporté dans leurs pattes, les arbres alentour. Perce-neige s’en était rappelé quelques bonnes feuilles. Comme celle-ci :
(…) L’abeille est devenue l’emblème de la fragilité du monde. Pollution chimique, mondialisation frénétique, agriculture intensive, etc. : sur chacun de ces grands dossiers de notre temps, elle apparaît comme l’innocente victime des méfaits de la technique humaine. Son destin témoigne du dérèglement tragique d’une nature qui serait de plus en plus dominée par un consortium diabolique. Faust, Prométhée et Frankenstein Inc., si l’on peut dire, soit : l’omniscience, la toute-puissance et la folie des grandeurs réunies en l’homme, par l’homme et pour l’homme. (…)
L’abeille, victime expiatoire de l’hybris humaine, de cette volonté de domination et de contrôle du monde amorcée par Descartes.
(…) Face à la triple prétention de tout connaître, de tout maîtriser et de tout fabriquer, l’abeille apparaît comme l’être fragile par excellence, symbole de la vulnérabilité d’une nature soumise aux diktats de l’humain. Mais ce qui explique aussi le succès médiatique de cet insecte sur lequel on ne cesse de projeter les angoisses du présent plonge ses racines dans une longue et ancienne tradition. Car si l’on déplore aujourd’hui avec autant d’émotion – et parfois d’emphase – le déclin de l’abeille, c’est quelle fut longtemps considérée comme le symbole privilégié de la beauté et de l’harmonie du monde, lorsque la Nature était considérée comme infiniment plus vaste, plus puissante et plus durable que tous les mortels réunis. (…)
L’abeille se voulait donc trait d’union, entre l’artifice et le naturel, entre le présent et la tradition antique, entre les idées les plus abstraites et les comportements les plus naturels et intuitifs. L’abeille en somme, d’un point de vue symbolique, ratissait large.
« Pour Aristote, lui avait raconté Zératos-Thène, la ruche est un microcosme, c’est-à-dire un cosmos à elle toute seule, mais en plus petit. En l’étudiant de près, avec suffisamment de patience et de sagacité, on peut selon le grand péripatéticien espérer comprendre les mystères du grand cosmos universel. J’aime à croire que c’est surtout dans cette optique que les Frères ont choisi l’abeille comme symbole de leur communauté. Il y a l’idée que Nova Alexandrie elle-même pourrait être considérée, d’une certaine façon, comme une ruche, dont l’étude permettrait aux esprits qui y accostent de mieux comprendre le grand monde d’où ils viennent… Car la ruche, comme la cité, rassemblent toutes deux des individus fort différents. Dans Nova Alexandrie, ou dans toute autre cité comme le faisait remarquer Aristote, ici comme chez vous autres humains, cohabitent des ouvriers, une certaine élite, des oisifs et – il faut bien le dire – une certaine canaille ; de même, la ruche est composée de chefs, d’ouvrières, de faux-bourdons et d’abeilles longues et voleuses qu’il ne faut pas laisser proliférer. Les analogies avaient marqué le grand philosophe grec, qui déplorait par ailleurs que les cités humaines fonctionnassent moins bien que celles des abeilles. Et pour cause : les humains ont besoin de techniques et de délibérations pour les construire, autant d’atouts qui les rendent supérieures à l’animal, mais qui sont leurs faiblesses quand elles sont mal employées.
– N’est-ce pas justement ce qui nous différencie de l’animal?, avait osé Perce-neige. L’humain improvise sans cesse, expérimente au risque de se tromper, alors que l’insecte répète imperturbablement une perfection figée.
– Exactement, s’était enthousiasmé le vieil homme. Et c’est bien pour cela qu’Aristote s’est toujours bien gardé, au nom de la rigueur philosophique, de tirer la moindre leçon politique ou morale de la vie de la ruche ! Une prudence que n’ont eu ni tous ses contemporains ni ses successeurs… La ruche n’est ni une monarchie ni une république idéale. Son fonctionnement « parfait » ne s’explique qu’à l’aune d’une fonction somme toute assez simple : récolter et stocker du miel. Le destin de l’abeille est de l’accomplir dans sa plus belle perfection. Mais Virgile, lui, a eu moins de scrupule à filer la métaphore : la ruche, assurait-il, peut nous rendre meilleur en nous servant de guide dans nos actions. Et l’homme serait bien inspiré, selon lui, de s’en servir comme modèle. Varron sera encore plus explicite, décrivant l’abeille comme sociable, dure à la tâche, prévoyante et productive, douée d’un sens de la géométrie et d’un sens civique à toute épreuve. Frugale et pacifiste, mais aussi disciplinée que dévouée, elle se sacrifierait sans hésiter pour défendre sa colonie. »
Piquée, si l’on peut dire, dans sa curiosité, Perce-neige avait voulu en savoir plus sur ces différentes représentations de l’abeille. Zératos-Thène lui avait alors conseillé de se rendre au domaine de Clément, ainsi nommé en mémoire de Clément d’Alexandrie, un lettré qui avait résidé dans la cité antique entre 150 et 215 de l’ère chrétienne, et qui avait engendré, dans le jardin qui jouxtait le domaine, un humus puissant dont on goûtait encore les saveurs corsées.
L’ancien érudit avait développé une école grecque de première importance, dont l’ambition était de créer un confluent entre deux fleuves puissants de la pensée : la loi juive et la philosophie grecque. Il en avait résulté un bras nouveau et puissant, qui allait alimenter un fleuve promis lui aussi à un bel avenir : le christianisme.
Quand elle s’était rendue dans ce domaine, Perce-neige n’avait donc pas été surprise d’y trouver dans les jardins une multitude de fontaines, symboles de ces sources diverses où l’on pouvait s’abreuver de sagesses anciennes. Un arbre-livre, au tronc d’une largeur impressionnante, continuait d’y croître, stimulé par cette eau abondante. La gardienne du parc avait proposé à Perce-neige, contre deux Edels de sa bourse, de lui en vendre quelques bonnes feuilles à mâcher. Elle avait pu ainsi goûter aux saveurs des Stromates – ou Mélanges – sur lesquels l’arbre-livre avait pris racine. Clément y plaidait un mariage réussi entre la philosophie et la foi, s’inspirant des abeilles qui rassemblaient des éléments divers butinés ça et là pour en forger leur fluide sucré. Le chrétien pouvait donc, à son tour, puiser dans des sources plus anciennes de quoi sublimer le message divin. « Car si le mal se repaît de la perte des hommes, la vérité qui, comme l’abeille, ne souille rien de ce qui existe, ne se félicite que de leur salut », était-il encore écrit sur l’une des feuilles séchées.
L’abeille devint sous la plume de Clément symbole de vérité. Et l’érudit finira d’ailleurs par surnommé son maître – le philosophe Pantène – l’«abeille de Sicile ». Perce-neige n’avait pu hélas s’attarder davantage sous cet agréable feuillage : une abeille l’avait piquée pour de bon.
La piqûre avait été douloureuse. Et sous l’effet du venin enrichi d’humus, Perce-neige était restée un moment suspendue dans une semi-conscience, l’esprit ballotté par les lointains éclats du débat du 3 Brumaire de la Convention, an IV de la Révolution française. Il y était question d’abeilles, justement. Industrieuse, ordonnée, sobre, guerrière et spartiate, l’hyménoptère avait assurément tout pour représenter l’esprit nouveau que voulait incarner la Révolution. Mais elle avait un gros défaut : n’était-elle pas gouvernée par une reine ? Impensable pour représenter la République !
Napoléon eut fort logiquement moins de réserves, son archichancelier le marquis de Cambacérès faisant remarquer que les abeilles « offrent l’image d’une République qui a un chef », c’est-à-dire « l’image de la France même ». Perce-neige fut transportée le 2 décembre 1804, jour du sacre du nouvel empereur français. Dans Notre-Dame, l’abeille était partout. Sculptée, cousue, dorée, tapissée… elle ornait jusqu’au manteau impérial. Au côté de l’aigle qui rappelait l’Empire romain, l’abeille se voulait mérovingienne, tout en renvoyant, dans une allusion subtile, à l’abeille impériale de Virgile, pour mieux suggérer une France éternelle et réconciliée avec son histoire multimillénaire.
Perce-neige était alors revenue à elle. Mais échaudée par cette aventure douloureuse, elle était rentrée sans tarder dans la taverne où elle louait une chambre sur le port, pour moins d’un Edel la nuit.
Observant les visiteurs qui finissaient d’emplir la salle souterraine, Perce-neige se massa machinalement l’avant-bras. Cela faisait déjà quelques jours que cette abeille l’avait piquée, et toute marque avait disparu. Mais le souvenir en était encore vif. Le brouhaha s’estompa quand un homme et une femme, tous deux vêtus de blanc, avancèrent vers l’estrade, sous des applaudissements mesurés. Réclamant le silence d’un signe discret de la main, l’homme prit la parole.
« Chers frères, chères sœurs, entama l’orateur d’une voix grave et puissante, je vous remercie d’être venus ce soir, plutôt nombreux, pour échanger avec nous. J’aimerais démarrer cette soirée par une anecdote. J’étais, ce matin, sur le grand marché de Nova Alexandrie qui jouxte l’Agora. Comme j’entendais des cris et des clameurs de foule, je me suis approché de ce que je pensais être une rixe entre marchands. Or ce n’était pas contre un marchand que la foule en avait, mais contre une petite fille. Une fille sale, crasseuse, habillée de guenilles : c’était une Iroukaï. Je ne sais comment une Iroukaï a pu pénétrer dans Nova Alexandrie, ni même comment elle a pu, avant cela, traverser la terre des Savoirs. Mais enfin elle était là. Et sans l’appui de sa horde, elle n’était qu’une enfant terrorisée. Elle avait faim, bien entendu. Et avait donc volé un peu de nourriture. Si elle avait été l’une de nos enfants, l’affaire se serait soldée par le don de quelques Edels pour qu’elle pût se nourrir à sa faim, car enfin je n’ai jamais vu qu’on laissât mourir de faim quiconque en ces murs. Et encore moins un enfant. Mais là, je ne vis personne lui donner quoi que ce fût. Bien au contraire, on la houspillait, on lui criait dessus, ce qui ne faisait qu’accroître sa terreur. J’allais lui donner quelques Edels de ma poche – j’en dispose bien assez pour mes maigres besoins – quand les gardes sont venus la saisir et l’ont amenée je ne sais où. Eh bien je vous le dis, mes frères et mes sœurs, ce matin j’ai eu honte d’être un Nouvel Alexandrin. Car enfin, quel mal cette Iroukaï pouvait-elle nous faire ? Nous aurions dû au contraire nous réjouir que cette enfant ait pu échapper à la vie de misère qui l’attendait dans sa tribu, pour trouver refuge parmi nous. C’était une occasion unique de lui montrer en quoi notre utopie offre un bien meilleur avenir que les luttes incessantes et stériles qui ravagent les terres d’où elle vient. Au lieu de cela, gageons qu’elle rumine aujourd’hui une rancoeur sourde et indélébile contre nous. Et si elle vient à s’échapper et à rejoindre les siens, il est à parier qu’elle se transforme en chasseuse impitoyable pour nos futurs frères égarés dans les lointaines contrées sauvages. Quelle occasion perdue de construire un premier pont entre nos deux univers ! Qui, après cela, peut encore croire au mirage du phare que nous avons érigé en symbole, si les ténèbres d’une simple fillette suffisent à nous faire peur…
– Une même vision doit au contraire nous rassembler, enchaîna habilement l’oratrice à ses côtés. Celle d’une cité redevenue ouverte à toutes et à tous, confiante dans sa capacité à accueillir quiconque a pu traverser la terre des Savoir sans jamais renoncer. Une cité qui accueille celui qui vient même d’au-delà les limbes, sans lui demander s’il a reçu l’aval du Conseil ou s’il possède un quelconque visa académique. Une cité dans laquelle le bédouin rêvant d’aventures peut venir avec son dromadaire sans qu’on ne l’interroge sur le désert d’où il vient, une cité où chacun puisse s’exprimer dans sa langue comme en Alexandrin, une cité où l’ésotérique, le mystique, voire l’esprit magique est accueilli avec bienveillance et curiosité, et non repoussé hors des murs avec ce dégoût qu’arbore l’élite. Car enfin, de quoi avons-nous peur ? Que les Iroukaïs viennent brûler nos maisons ? Nous savons bien qu’ils ne peuvent s’aventurer jusqu’ici. Le moindre arbre-livre suffit à les épouvanter. Craignons-nous d’être confrontés à des tribus inassimilables, à des logiques trop éloignées des nôtres ? Mais n’était-ce pas justement le projet de cette ville, de créer des ponts entre des mondes que tout sépare. Avons-nous peur qu’une armée de Trolls fasse écrouler nos murs ? Si le jour advenait où nous nous sentirions démunis face à eux, c’est que nous ne serions plus que l’ombre de ce que nous fûmes. Non, je vous le dis, l’ennemi n’est pas hors-les-murs. Il est au contraire niché au coeur-même de la cité. Ce sont nos propres peurs que nous affrontons. Les incohérences de nos idéaux. Cette volonté d’épurer la pensée vers des sommets stériles ! »
L’assemblée applaudissait, aisément conquise. Les deux orateurs se relayaient avec un art consommé du dialogue. En bonne professionnelle de la communication, Perce-neige leur reconnut de solides compétences pour susciter l’émotion du groupe. Une petite heure et quelques questions plus tard, chacun se retrouvait devant le petit buffet que l’animateur de la soirée avait dressé. Les petits fours étaient savoureux. Et Perce-neige s’en éloigna à contre-coeur pour s’approcher du couple d’orateurs.
Elle hésita à faire usage de la psycho-langue, ne sachant si les techniques de suggestion mentale pouvaient fonctionner sur les êtres qui peuplaient ce monde. Elle ne modula donc que très légèrement son timbre, juste assez pour mettre ses interlocuteurs en confiance.
« Joli discours… qui redonne espoir », entama-t-elle par politesse. Après quelques remerciements et banalités d’usage, elle entra sans plus tarder dans le vif du sujet. « On m’a dit que vous auriez l’oreille de Périclès…, hasarda-t-elle.
– On dit beaucoup de choses, vous savez. Et tout n’est pas forcément vrai dans le flot de paroles qui coule dans la ville », rétorqua l’orateur.
Perce-neige n’eut pas grand mal à détecter, dans le ton de sa voix, qu’il ne niait que par pure formalité. Il ne cherchait même pas à être vraiment convaincant.
« S’il vous arrivait de le rencontrer prochainement, faites lui savoir que Perce-neige, la fille de Camille, souhaiterait le rencontrer. C’est important », enchaîna-t-elle.
Elle n’insista pas davantage, pour ne pas importuner ses interlocuteurs ni attirer l’attention sur elle. Ils avaient de toute façon parfaitement compris le message. Et Perce-neige n’eut aucun doute qu’il serait prestement transmis. Elle avait donc quitté l’assemblée, saluant au passage le petit homme en tunique blanche qui semblait être l’organisateur de la soirée. Elle avait remonté le long escalier pour regagner l’arrière-cour de la taverne du Livre-blanc, avait remercié l’aubergiste et était rentrée à son hôtel, sur les quais. Son hameçon était posé. Périclès allait-il y mordre ?
V.11 – Pyramides
Perce-neige avait égayé son récit d’un rosé qui s’accordait plutôt bien aux saucisses. Ces moments d’intimité que nous vivions dans notre Refuge, loin des regards, étaient des parenthèses dont j’appréciais chaque minute. Nous y formions, par la fusion des âmes qui s’opérait au contact de mon amie, les deux faces d’un même esprit. Aussi, vivre sans elle devint vite aussi absurde, impensable – et impensé – que s’il s’était agi de vivre hors de moi-même.
Nos contacts physiques étaient très réduits : à peine lui avais-je parfois effleuré la main ou caressé les cheveux, massé à l’occasion les épaules pour la soulager d’une douleur. Et cependant, j’avais l’impression d’avoir partagé avec elle plus d’intimité que ne pourrait jamais le faire un couple uni durant toute une vie. Je me sentais en elle, et la savais en moi.
Nous marchâmes un moment côte-à-côte, parmi les pissenlits, sur le chemin qui nous ramenait à la Citadelle. J’observais ses cheveux qui flottaient dans le vent. Perce-neige s’amusait à confectionner des petits bouquets, dans lesquels elle insérait des fleurs mauves dont j’ignorais le nom. Elle courait dans l’herbe comme une enfant, heureuse de retrouver des joies enfouies dans les souvenirs confus de ses premières années. Je l’imitai en ramassant un bâton dont je me fis une canne, ainsi que j’aimais le faire quand j’étais petit. La canne devint carabine lorsque nous nous mîmes à jouer aux cow-boys, puis épée de mousquetaire, avec laquelle je la défiai en duel dans cette garrigue transformée en cour de récréation. Nous pourchassâmes des papillons, prélevâmes des coccinelles sur nos doigts pour les observer s’envoler. Sommes-nous restés quelques minutes, ou quelques heures ? Lorsque nous rentrâmes finalement à la Citadelle, éreintés par nos jeux bucoliques, Marie accourut vers nous.
« Vous êtes au courant ? Iris va devenir maître, lança-t-elle très excitée. Si vite, c’est incroyable, non ? »
Je n’en avais jusque-là dit mot, respectant à la lettre la promesse que j’avais faite à mon précieux ami. Une promotion aussi rapide était bien, comme l’avait relevé Marie, tout à fait exceptionnel. Mais je savais qu’Iris ne l’était pas moins. Son admission au rang de maître, quoique accélérée, n’était en rien usurpée. Nous en étions tous fiers, d’ailleurs. Rablais, Forest, Marie et moi étions bien d’accord, depuis le début, pour reconnaître qu’Iris nous dominait tous intellectuellement. A un point tel que toute idée de compétition avec lui aurait paru absurde.
Iris m’avait confié que son adoubement aurait lieu la semaine suivante. C’était ainsi que nous nommions, par analogie avec l’ancienne chevalerie, la cérémonie qui transformait le novice en maître. Elle était l’occasion de jurer fidélité aux grands principes de l’Institut, de témoigner un amour sincère et désintéressé pour le savoir, et de reconnaître au passage l’autorité de la hiérarchie à laquelle l’impétrant se soumettait sans réserve. Il y avait, dans ce rite entretenu d’une génération à l’autre, un savant mélange de tradition ecclésiastique, d’honneur chevaleresque et de ritualité franc-maçonne : l’Institut avait amalgamé avec succès toutes les grandes sources de spiritualité collective. Et pour nos jeunes âmes en quête de merveilleux, ces cérémonies parfaitement codifiées par de solides recherches en psychologie sociale, dont l’esthétique puissante mêlait couleurs, musiques et senteurs entêtantes, jouaient comme un ciment mémoriel que rien ne pouvait par la suite altérer. Quiconque avait assisté à l’un de ces rituels, aux airs de sacrement, en gardait le souvenir viscéral d’avoir fait pleinement partie d’un tout. Ce sentiment transcendant s’approchait de la foi, bien qu’à aucun moment il n’ait été question d’un quelconque dieu, ni même de sacré au sens strict. Parlons donc plutôt d’une foi dans les autres, dans la volonté de chacun de faire corps, et dans celle de l’Institut d’oeuvrer pleinement à l’épanouissement véritable de chacun. Cela faisait-il de l’Institut une secte ? Il est toujours périlleux de vouloir répondre à pareille question de l’intérieur. Je note qu’il lui en manquait de toute évidence des éléments essentiels : chacun de nous restait libre de construire sa propre vérité, puisque c’était le sens de nos séjours en ces murs ; libre aussi, à tout moment, de partir et de revenir. Cette respiration était même fortement encouragée, à la fois pour enrichir l’Académie d’idées nouvelles, forgées au contact de sociétés et de valeurs différentes, mais aussi parce que l’ambition était bien, en retour, d’exercer une influence positive sur ces sociétés dont nous continuions – pour la plupart – de faire partie. Il n’était enfin demandé à personne de céder à l’Institut ses biens personnels. Et pour cause : beaucoup d’entre nous, à leur arrivée, n’en possédaient aucun, et trouvaient au contraire dans la Citadelle un lieu où la misère matérielle s’effaçait naturellement devant la profusion de richesses intellectuelles dont chacun pouvait se rassasier. Il n’y eut d’ailleurs jamais de gourou pour gouverner les lieux. Cela eût paru absolument incongru. Si Isaac avait été choisi, des décennies plus tôt, pour diriger la Citadelle, ce n’était pas pour son charisme – il n’en avait hélas aucun – mais pour son intelligence et son abnégation totale, que personne n’avait jamais mises en doute : ce vieil entêté se serait fait crucifier plutôt que de faire quoi que ce soit qui eût pu salir les grands idéaux qui transcendaient ce lieu. Il était – n’ayons pas peur des mots – l’équivalent d’un saint laïc, dévoué à sa tâche jusqu’au sacrifice ultime de soi. Cela n’avait d’ailleurs rien de si exceptionnel, si l’on y songe, car d’autres institutions ont compté en leur sein de tels profils : combien de professeurs anonymes et fort modestement payés persistent, sans bruit et sans égard pour leur propre santé mentale – voire physique pour certains -, à maintenir une faible lumière dans des recoins du monde désertés par toute autre pensée argumentée. Tel Sisyphe, ils consacrent leur vie à élever imperceptiblement les capacités d’abstraction d’une génération, luttant chaque jour contre de puissants vents contraires et recommençant sans ciller à la génération suivante, n’en tirant ni gloire ni avantage matériel, juste la sensation d’avoir participé à quelque chose de plus grand que soi. J’imagine qu’Isaac ressentait la même fierté face au chemin que nous avions grâce à lui parcouru.
La Citadelle garantissait à beaucoup un cadre sans lequel leur volonté de vivre hors des sentiers battus les aurait lentement conduits vers la marginalité puis la folie. Forest faisait partie de ces esprits extrêmes qui osent aller si loin dans l’exploration d’une nouvelle humanité, qu’ils ne peuvent garder leur intégrité mentale que par des rappels incessants et bienveillants de ce qui constitue la norme des rapports sociaux. Testant les limites d’une symbiose avec la nature, il partait régulièrement plusieurs jours en forêt. Il devenait alors arbre pour laisser les oiseaux se poser sur lui, pierre pour sentir l’eau du ruisseau sculpter lentement sa peau, il était le vent, le soleil ou simplement « l’esprit de Gaïa » comme il appelait la communion intime qu’il avait la sensation d’avoir avec l’ensemble de la Terre. Sans les contacts réguliers qu’il maintenait avec nous, sans les repas pris ensemble durant lesquels il nous racontait ses expériences, sans les séminaires qu’il consentait à suivre à l’Académie, et qui le forçait à structurer sa pensée, il aurait vite sombré dans la folie. Au lieu de cela, il maintenait au contraire un équilibre alternant des périodes de fusion quasi-animiste avec les forces de la nature et de résurgences normatives dans le monde des humains.
Marie avait des ambitions moins spectaculaires, mais peut-être tout aussi extrêmes. Elle tentait une synthèse improbable entre la rigueur, la puissance intellectuelle des mathématiques dans lesquelles sa raison excellait, et l’émotivité qui la secouait en secret, et qu’elle exorcisait comme elle pouvait dans la musique, la peinture et une multitude d’autres arts. Elle s’était donné comme horizon de créer une poésie mathématique – ou une mathématique poétique – qui jouait sur l’esthétique intrinsèque d’une démonstration pour exprimer une émotion. Elle faisait en somme littéralement chanter les théorèmes. Elle avait gagné à sa cause un petit cercle de mathématiciens et de musicologues, qui se réunissaient pour traduire en alexandrins logiques telle démonstration d’algèbre linéaire ou de géométrie différentielle. Futile ? Pas plus, rétorquait-elle, que les cathédrales ou les pyramides égyptiennes. Nous étions bien d’accord avec elle.
Rablais lui-même n’aurait pu passer que pour un bon vivant, un brin paillard, s’il n’y avait dans son épicurisme exubérant la recherche plus subtile d’une voie basée sur la recherche d’une parfaite grammaire culinaire. Loin d’être un rustre, il était au contraire l’agrégé du palais, le docteur en langue et papilles gustatives. Et le soin extrême qu’il mettait à orchestrer, sans fausse note, les ripailles qu’il organisait le soir après l’étude, sublimait des pulsions qui l’auraient conduit sans ce garde-fou vers des excès fatals pour ses artères. Aussi fut-il ravi, ce soir là, de nous servir en apéritif dînatoire quelques terrines truffées au cognac qu’il avait lui-même préparées, arrosées d’un petit vin des Corbières qu’il venait de découvrir. De quoi vous ramener les pieds et l’estomac sur terre après nos folles randonnées dans l’abstrait. Isaac n’était pas le dernier à en étaler sur de larges tartines, dans lesquelles il croquait à pleines dents.
V.12 – Ego
Dong ! Dong ! Dong ! La lourde cloche accrochée en haut du donjon faisait vibrer toute la Citadelle. J’étais au potager, profitant des heures encore fraîches de la matinée pour ramasser quelques fraises. Félicitée m’avait accompagné, délaissant – une fois n’est pas coutume – son mentor de Galet. Ce dernier avait fort à faire, depuis qu’il avait pris la place de Camille comme Guide. Il nous recevait les uns après les autres, s’entretenant longuement avec chacun pour percer nos personnalités, estimer nos forces et nos points faibles, connaître nos aspirations et juger des moyens les plus adaptés qui nous permettraient de les réaliser… ou d’en changer. Il s’en sortait plutôt bien, écoutant sans interrompre mais en guidant néanmoins avec assurance la discussion. Je persistais à lui préférer la bienveillance contagieuse de Camille. Mais enfin, je devais le reconnaître, il « faisait le job » comme on dit. Et sa relative jeunesse était un atout pour séduire certains. Il n’était guère surprenant que Félicitée fût tombée sous son charme. Elle-même n’en était pas dépourvue. Elle dégageait la même sensualité maîtrisée que Perce-neige, quoique plus timide, presque hésitante, elle était comme une fleur bourgeonnante qui n’aurait pas encore donné sa pleine mesure. C’était par ailleurs une femme assez secrète, qui écoutait plus qu’elle ne parlait. Mais je devinais en elle une puissance émotionnelle peu ordinaire. Ce que Perce-neige m’avait confirmé, épiant sous les intonations subtiles de sa voix ou la chorégraphie de ses gestes, l’émergence d’un talent naissant, et encore à peine perceptible, de médiatrice. Toutes deux s’observaient, se jaugeaient comme de potentielles rivales d’une possible lutte dont elles ignoraient les enjeux.
Dong ! Dong ! Dong ! La cloche continuait de battre son rythme sourd. Elle ne sonnait que pour les grandes occasions, de celles qui nécessitaient de réunir tout le monde. Et aujourd’hui en était une, puisque Iris, mon Iris, allait devenir Maître. Nous nous dépêchâmes de cueillir les dernières fraises. Félicitée en glissa maladroitement une dans sa bouche, tachant ses doigts et ses lèvres d’un jus rouge vif.
« L’heure approche. Mais je crois qu’il va falloir que je me change, plaisanta-t-elle en désignant sa robe parsemée de boue.
– Moi aussi, nous n’allons quand même pas faire à Iris l’affront d’arriver tout crottés.
– …C’est ton ami, n’est-ce pas ? releva-t-elle après un bref silence.
– Plus qu’un ami, rectifiai-je, quasiment un frère!
– J’ai remarqué en effet que vous étiez très proches. Il m’est arrivée d’être parfois un peu dure avec lui, tu m’en excuseras auprès de lui… »
Je devinais à quoi elle faisait allusion. Je savais qu’Iris, malgré son génie, était en amour aussi pataud qu’un adolescent. Depuis des mois, il poursuivait Félicitée d’une cour maladroite, ne lui laissant d’autre alternative qu’une indifférence polie mais ferme. J’en avais mal pour lui, car je connaissais la force et la sincérité de ses sentiments. Pouvais-je pour autant en vouloir à Félicitée de décourager sa flamme du mieux qu’elle le pouvait ?
« C’est un étrange garçon, poursuivit-elle. Ses émotions, ses sentiments, sont réels, mais en même temps si… hermétiques. Comme s’il en fermait l’accès avec un cadenas dont il aurait lui-même perdu la clé. »
J’avais souvent eu la même impression à son contact. Etait-il un peu autiste ? Je soupçonnais une réalité plus complexe. Perce-neige m’avait dit un jour qu’elle percevait en lui un vide étrange, comme si son ego s’était dissous dans l’abstraction. « Iris, m’avait-elle dit, est la seule personne dont je ne parviens pas à saisir la conscience intérieure. J’ai l’impression face à lui de courir derrière un fantôme. » Félicitée éprouvait la même incapacité à entrer véritablement en communion avec lui.
« Je sens en lui de la joie, de la tristesse, de la colère, et même de l’amour, mais rien qui les réunisse à travers une conscience solide de soi. Comme si tous ses sentiments avaient leur propre autonomie, comme des idées qui germeraient toutes seules sans avoir été véritablement créées par quelqu’un de conscient. Cela paraît absurde, mais j’ai l’impression qu’en tant que personne, Iris n’existe pas. L’as-tu d’ailleurs souvent entendu dire « je » ? »
Iris, une abstraction pure ? Je ne pense pas qu’elle ait voulu dire ça. Elle semblait plutôt faire allusion à ce qui, en chacun de nous, donne à toutes nos pensées et à tous nos ressentis l’impression d’être véritablement issus de soi. Ce quelque chose qui empêche un robot, quand bien même il simulerait parfaitement les manifestations physiques de la douleur, d’avoir réellement mal. Ce quelque chose dont semble dénué l’insecte mais que l’on sent déjà à l’oeuvre chez les mammifères qui nous sont proches : le ressenti de soi, cette sensation d’être un point singulier de l’univers. Cette conscience sans laquelle le monde n’est guère plus qu’un ballet stérile d’atomes et de forces. Et que mon ami, peut-être à force d’abstractions coupées des sens, avait laissé dangereusement s’étioler.
V.13 – Adoubement
Je montai dans ma chambre pour me changer. J’avais préparé sur ma chaise la chemise blanche et le pantalon de lin clair qui nous faisaient office d’uniforme de cérémonie. Nous portions tous, également, les mêmes sandales que chaussait Camille quand je l’avais rencontré. Une fois n’était pas coutume, je donnai un rapide coup de peigne dans mes cheveux. Un coup de ciseaux n’aurait pas été de trop.
Perce-neige vint me rejoindre. Elle portait à son tour une longue robe blanche de coton, comme toutes les autres femmes de la Citadelle, cintrée d’une simple corde à la taille. Elle s’était permise d’y accrocher un oeillet qu’elle avait trouvé dans les champs. Elle réajusta ma chemise, corrigea une dernière fois une de mes mèches rebelles.
– Mmm, te voilà tout beau ! susurra-t-elle.
Je ne sais si ce fut l’intonation de sa voix, qu’elle avait rendue volontairement chaleureuse, ou la sensualité de ses doigts glissés dans mes cheveux, mais je restai quelques secondes le regard suspendu à ses lèvres. Mon coeur accéléra un instant, jusqu’à ce que la vague passe et s’évanouisse dans l’écume des sentiments. S’était-elle jouée de moi ? Avait-elle sciemment utilisé la psycho-langue ? Peu m’importait, j’étais bien.
Nous nous mêlâmes à la procession des disciples qui s’était mise en branle, pour cheminer vers un vieil amphithéâtre édifié en pleine nature, à une heure de marche, au sommet d’une colline. Tous vêtus de lin clair pour les hommes, de coton blanc pour les femmes, nous marchions au rythme joyeux d’un orchestre de fifres, crabas et grailes occitans. Il faisait beau, une légère brise diffusait les senteurs de la garrigue. Mais cette marche menée par les Maîtres n’était pas qu’une promenade d’agrément. Elle était avant tout symbole du chemin parcouru par celui qu’elle honorait. Elle le ramenait à l’humilité de l’effort qu’il fallait faire à chaque pas pour gravir le sentier de chèvres qui menait à la colline, à la nature sauvage qui nous entourait et à laquelle nous devions nous adapter, à la puissance du groupe que nous formions, chacun mettant résolument ses pas dans ceux des précédents. La chorégraphie subtile que nous jouions exprimait sous ses aspects simples une pensée très élaborée.
A moitié naturel, l’amphithéâtre avait été taillé dans la roche calcaire. Le sculpter au marteau et au burin avait dû être un travail titanesque, malgré ses dimensions plutôt modestes. L’acoustique y était excellente. Un quatuor y avait pris place pour nous accueillir, mêlant harpe, violon, flûte traversière et violoncelle. J’ignore qui avait porté la lourde harpe le matin-même sur son dos, mais j’éprouvais de la compassion pour cette performance anonyme.
Nous nous assîmes l’un après l’autre sur les gradins de pierre, recouverts par endroits d’un tapis de mousse qui les rendait moins inconfortables. La musique invitait au recueillement. Je pris place à côté de Perce-neige, à quelques mètres de Forest, Rablais et Marie. Je reconnus aussi Amako et Maurice, plus loin dans les premiers rangs. Pour l’occasion, le vieil intendant s’était réconcilié comme moi avec son peigne. Il s’était même rasé de frais et – j’imagine – parfumé de sa mythique eau de Cologne dont la bouteille cumulait déjà plusieurs décennies. Nous chuchotions entre nous comme des écoliers. Certains disciples, que nous n’avions plus vus depuis des mois, étaient revenus pour l’occasion. D’autres n’étaient plus venus, selon le témoignage des anciens, depuis des années et nous étaient inconnus. L’adoubement d’un Maître si jeune était si rare qu’ils en avaient pris naturellement prétexte pour renouer les liens avec la Citadelle. J’ignore comment ils avaient appris la nouvelle. Le bouche-à-oreille, sans doute. Car une solidarité sans faille continuait d’unir, à l’extérieur, les anciens disciples partis poursuivre en solitaire leur périple intellectuel. Ils étaient venus retrouver avec plaisir leurs anciens Maîtres. Il y avait dans ces retrouvailles fraternelles des accents de réunion de famille. Car n’était-ce pas ce que nous avions vocation à être ? Une grande famille fondée sur des valeurs intellectuelles, quasi spirituelles, et non sur des liens de sang.
Quand la musique s’arrêta, les Maîtres se placèrent l’un après l’autre sur la scène, se répartissant de façon homogène autour d’Isaac. Le directeur de la Citadelle rayonnait, en maître absolu de la cérémonie.
« Chers novices, chers confrères et consoeurs, lança-t-il après s’être éclairci la voix. Je suis très ému de vous voir aujourd’hui, si nombreux, pour accueillir bientôt en tant que Maître l’un des esprits les plus brillants qu’ait jamais connu cette académie. Iris – car c’est bien de lui qu’il s’agit – promettait dès le départ d’être un disciple hors du commun. Avant même sa venue, les rapports qui s’accumulaient sur mon bureau annonçaient un être d’exception : bachelier à 14 ans, déjà docteur à l’âge où la plupart commencent à peine leurs études universitaires, capable d’embrasser les concepts les plus abstraits, de construire des démonstrations d’une complexité à couper le souffle. Mais aussi d’importer, avec audace et talent, les concepts d’une discipline dans une autre. J’avais hâte de rencontrer un tel prodige et – je l’avoue – j’étais inquiet qu’il ne nous trouvât point à son goût. Fort heureusement, il semble bien que ce ne fut pas le cas, puisqu’en définive il resta. Pour mon plus grand bonheur, car je peux vous certifier que je n’ai été en rien déçu. En une seule année, Iris a parcouru – et surtout compris – l’ensemble des manuscrits les plus avancés en mathématiques et physique théorique de l’Académie. Au point de les compléter parfois lui-même. Son mémoire sur l’interprétation des observables en mécanique quantique est une véritable cathédrale de l’esprit. Je vous l’avoue, je suis jaloux de n’avoir pu l’écrire moi-même. Penser qu’il ne lui a fallu pour cela que quelques mois est une terrible leçon d’humilité que nous prenons tous. Iris porte à des sommets les valeurs qui fondent cette académie : la passion sans limite du savoir, l’excellence, la rigueur, l’exigence et l’obstination à l’effort. En tant que professeur, ce fut un rare moment de bonheur d’avoir un tel élève. Mais il est devenu trop évident que nous ne pouvons continuer plus longtemps à considérer comme notre élève un être dont la compréhension des concepts est d’une telle profondeur qu’elle nous dépasse tous. C’est donc un honneur pour nous, les Maîtres, de l’accueillir à présent parmi nous en tant qu’égal, si tant est que nous puissions vraiment prétendre faire jeu égal avec un tel génie… »
Assis au premier rang, mon ami savourait sans fausse modestie cette hagiographie. Je le savais un brin orgueilleux . J’imaginais donc sans peine le plaisir qu’il éprouvait. Il rougissait sous ce déluge de louanges. Car à la suite d’Isaac, les autres Maîtres défilèrent pour exprimer à leur tour le bien qu’ils pensaient de leur futur confrère, rivalisant d’anecdotes pour démontrer l’extrême agilité de cet esprit hors du commun. Pour moi, peu m’importait qu’il pût extraire n’importe quelle racine carrée de tête, ou retrouver sans note toute la démonstration de la conjecture de Fermat, il était celui qui avait sauvé Perce-neige en décryptant un mémoire abscons d’exobiologie quantique. Et il avait pour cela ma reconnaissance éternelle.
Respectant les usages, Iris présenta ensuite son mémoire. Mais c’est en alexandrins qu’il dut, pour suivre pleinement la tradition, en exposer d’abord les grandes lignes. Chacune des thèses de sa démonstration avait été personnifiée, composant grâce à l’appui des disciples plus littéraires une pièce de théâtre dont l’intrigue amenait inexorablement, comme dans une tragédie grecque, à la conclusion à laquelle Iris était parvenu. L’adaptation était si habile qu’on ne savait plus s’il s’agissait de physique présentée théâtralement, ou de théâtre traitant de physique théorique. Un orchestre rajoutait aux moments les plus importuns une note tour à tour légère ou dramatique. Art et science se confondaient dans une même quête de sens, créant même chez les esprits les plus réfractaires aux mathématiques le vertige d’accéder à des perceptions nouvelles. Il ne s’agissait plus seulement de comprendre l’univers, mais de l’humaniser totalement. Quand Iris conclut sa présentation, tout le monde se leva pour l’acclamer. Le soleil commençait à décliner. Tout le monde se tint la main tandis qu’Iris s’inclina avec humilité, épuisé.
On amena alors un bac que l’on remplit d’eau claire échauffée toute l’après-midi au soleil. Iris enleva l’un après l’autre ses habits de disciple, jusqu’à être entièrement nu. Il s’immergea dans le bain, se purifia le corps avec un bloc de savon et différents sels, tandis qu’un choeur entonnait des chants d’inspiration religieuse. Un frisson parcourait les gradins. A la lueur des torches que l’on allumait l’une après l’autre, Iris sortit lentement de l’eau, se sécha et revêtit la tunique des Maîtres. Quand il fut prêt, l’air grave, il se mit à genoux.
Dans un silence que ne troublaient plus guère que les crissements des criquets, Isaac s’approcha de lui et, d’un bâton d’olivier, lui frappa les deux épaules comme l’aurait fait du plat de l’épée un suzerain à son chevalier. Iris prêta serment. Il jura d’honorer le savoir, de le défendre, de respecter les valeurs et les traditions de la Citadelle, d’accueillir enfin tous ses membres avec la même bienveillance, quelles que fussent leurs façons de chercher un sens à leurs vies.
Il était Maître désormais. Et chaque disciple se présenta à lui, l’un après l’autre, pour lui présenter ses hommages. Arrivé face à lui, j’étreignis longuement mon ami. Je savais que je mettais sa timidité à rude épreuve. Je le sentis raide comme un arbre, ne sachant si ses nouvelles fonctions lui imposaient de respecter désormais une quelconque distance envers moi. Il eut moins d’hésitations avec Perce-neige, qui s’engouffra à ma suite. Rablais le gratifia d’une grande tape dans le dos qui le fit trébucher : Maître ou pas, il faisait toujours partie de la bande.
La nuit se poursuivit par un banquet et des danses autour d’un grand feu, qui se prolongèrent jusqu’aux premières lueurs de l’aube.
V.14 – Tournoi
Je passai la journée du lendemain à somnoler au soleil avec Forest, Rablais et Marie. Iris n’était plus parmi nous : il poursuivait la partie réservée aux Maîtres de son initiation. Quels secrets était-il convié à partager ? J’attendais avec gourmandise qu’il me le racontât !
« Il paraît que les Templiers, lors de leur initiation, devaient s’embrasser le bas du… enfin le bas du dos, plaisanta Rablais. Evidemment, ce n’était qu’une rumeur, qui revenait régulièrement lors de leur procès. Elle n’a jamais été confirmée. Mais bon, moi je trouve quand même qu’Isaac a souvent pour notre ami Iris une tendresse toute templière.
– Rablais, tu es répugnant », lui lança Marie dégoûtée.
Il était clair cependant que la nature des liens qui unissaient les Maîtres entre eux nous échappait partiellement. Le secret dont ils entouraient certaines de leurs réunions aiguisait notre curiosité. Je me doutais qu’il devait y être question d’une cité, construite au-delà des limbes de la pensée symbolique. Quels accès y avaient-ils ? Je laissai s’évanouir ces questions et j’allai prendre une douche dans la salle de bain collective. Par cette après-midi caniculaire, cela ne pouvait que me faire du bien. J’y croisai Marie qui finissait de se coiffer, les traits encore fatigués.
« Une sacrée fête, hier. Cela faisait longtemps qu’on n’avait pas été aussi bien, tous ensemble », sourit-elle.
Cela avait été une belle fête, en effet. Qui avait ressoudé les liens dont certains avaient pu se distendre ces derniers mois. Nous étions plus que jamais unis, heureux de nous construire un avenir commun. Ma serviette sur l’épaule et des sous-vêtements sous le bras, je rentrai dans l’une des douches. L’eau était fraîche. Je pris un petit bloc de savon pour me frotter vigoureusement. J’entendais Marie fredonner une chanson qu’elle avait composée sur les amours déçues de Pythagore.
Quand je revins dans ma chambre, Perce-neige s’éveillait d’une longue sieste. Je la laissai se préparer, et nous descendîmes tous deux dans le réfectoire pour chaparder une boule de pain. Nous nous installâmes dehors, sur un banc à l’ombre. Forest, Marie et Rablais vinrent nous rejoindre. Iris n’était déjà plus parmi nous : il avait désormais ses quartiers dans l’aile des Maîtres.
« Il va nous manquer, soupira Forest.
– C’est sûr, renchérit Rablais. Qui vais-je chambrer maintenant ? J’ai bien peur, mon pauvre Forest, que tu n’en fasses les frais !
– Ne t’avise pas de le toucher », plaisanta Marie en faisant mine de protéger notre timide compagnon.
Rablais avait raison : même si Iris restait physiquement parmi nous, il ne faisait plus vraiment partie du groupe. Quand nous le vîmes traverser la cour en compagnie des autres Maîtres, son visage avait déjà l’air plus grave, comme s’il portait un poids nouveau sur ses frêles épaules. Le groupe se rendait en haut du donjon, sans doute pour une première réunion.
Je consacrai la fin de l’après-midi à de nouvelles recherches sur Hypathie. Il y avait trop longtemps que j’avais négligé l’avancement de mon mémoire. Et je comptais bien sur les nouvelles fonctions d’Iris pour me faire accéder, en secret, aux richesses historiques supplémentaires que contenait l’Annexe.
Un grand débat était prévu le lendemain. Programmé depuis des semaines, il s’étalait sur toute la journée. Il s’agissait de déterminer si les maladies psychiatriques, comme la dépression, les troubles anxieux, la bipolarité ou la schizophrénie, n’étaient que des dérèglements délétères du psychisme ou si elles avaient pu donner à l’espèce humaine, au cours de son évolution, un quelconque avantage sélectif. Car sinon, avançaient les partisans de cette seconde thèse, comment expliquer leur forte prévalence dans nos sociétés et leur caractère en partie héréditaire ? Si des gènes s’étaient maintenus depuis la nuit des temps pour nous prédisposer à ces maladies, c’est bien qu’ils devaient apporter à ceux qui en étaient porteurs un quelconque avantage. Les gènes inutiles ou nuisibles à la reproduction de l’espèce disparaissent vite, faisaient valoir les plus darwiniens.
Deux camps s’étaient donc formés parmi nous. D’un côté, les « psycho-évolutionnistes » s’efforçaient de trouver quels avantages de telles « maladies » pouvaient apporter. Ils expliquaient ainsi que la dépression permettait de ne pas gaspiller son énergie à poursuivre des stratégies qui n’apportaient aucun résultat. Que les troubles anxieux étaient une réponse adaptée à l’environnement très dangereux que constituait la savane des origines. Car mieux vaut un détecteur de fumée qui se déclenche neuf fois sur dix pour rien, assénaient-ils, qu’un détecteur qui ne se déclenche pas lorsqu’un réel incendie survient. En d’autres termes, la paranoïa est bien gage de survie quand des dangers réels sont omniprésents. Quitte à vivre une vie de cauchemar, miné par l’angoisse ? La nature n’a que faire de notre confort, répondaient-ils. Seule compte la survie.
L’un d’eux, qui était par ailleurs psychothérapeute, avait conçu une théorie originale pour expliquer l’anorexie. Les personnes anorexiques, nous expliquait-il, cachent souvent de la nourriture, font des réserves. Elles sont aussi particulièrement représentées, constatait-il, parmi les professions au service des autres, comme les assistantes sociales ou les infirmiers. Aussi, il supposait qu’il ne fallait pas voir dans l’anorexie la volonté de ne rien manger, mais plutôt celle de se sacrifier pour les autres, une forme extrême – et aujourd’hui inadaptée – d’altruisme qui pouvait se révéler très utile à la survie du groupe en période de réelle famine. Aussi essayait-il avec ses patients anorexiques de ne pas se focaliser sur le trouble alimentaire, mais de comprendre plutôt ce besoin exagéré d’altruisme.
Face aux psycho-évolutionnistes, les partisans des caractères acquis déchaînaient leurs critiques, les poussant à chaque fois dans leurs ultimes retranchements. Leur reproche majeur était que ces théories – certes intellectuellement séduisantes – ne pouvaient être vérifiées par quelque expérience que ce fût. Chacun pouvait donc construire la théorie qu’il voulait, sans craindre d’être aussitôt démenti par les faits. Un peu trop facile, estimaient-ils… Nous nous affrontâmes toute la journée, fourbissant nos arguments dans des joutes orales qui, par certains côtés, rappelaient – de façon symbolique – les antiques combats de gladiateurs. Les spectateurs applaudissaient, ovationnaient les vainqueurs qui avaient pu, d’une dialectique imparable, terrasser leur opposant, réclamaient grâce pour un perdant qui s’était bien battu, se passionnaient sans cesse pour de nouveaux duels, jusqu’à ce que nos estomacs affamés sifflassent de façon fort organique la fin du tournoi.
L’Académie avait ses règles : une fois le débat terminé, nul n’avait le droit de le redémarrer durant le repas qui suivait. Ce qui permettait à ceux qui avaient pu s’opposer de façon parfois violente de se réconcilier autour d’un savoureux rôti ou de larges tranches de rillettes maison, sans en remettre une louche. Quelques verres de vin achevaient en général de mettre tout le monde d’accord sur l’unité profonde du groupe, en dépit des fortes divergences intellectuelles qui nous traversaient.
La soirée s’acheva par une pièce de théâtre qu’avait répétée une troupe de novices, suivie d’une nouvelle série de chansons sentimentalo-comiques composées par Marie.
V.16 – Petit Passage
Je croisai Iris un matin, alors qu’il descendait du donjon en grande conversation avec d’autres Maîtres. Il me fit un signe discret de la main, me signifiant de l’attendre. Quelques minutes plus tard il vint me retrouver.
« Te voilà devenu quelqu’un d’important, remarquai-je pour le taquiner.
– Jaloux? Je fais maintenant pleinement partie de la Citadelle, c’est vrai. Ce sera un jour ton tour, n’en doute pas. »
Je sentais qu’il luttait intérieurement contre le désir puissant de me raconter les détails cachés de sa nouvelle vie. Aussi l’aidai-je un peu à transgresser les serments de confidentialité qu’il avait dû faire.
« Nous sommes entre nous, Iris. Et tu sais que je peux tenir ma langue. Alors dis-moi, que faites vous si régulièrement en haut du donjon. On vous voit vous y rendre en groupe au petit matin, pour n’en ressortir que des heures plus tard. Mais aucun Maître n’a jamais voulu nous dire ce que vous y faites. Qu’y a-t-il là-haut de si secret qui doive nous être caché ? »
Iris hésita un moment, prit un air gêné. Je n’eus pourtant pas à insister longtemps, car rapidement il n’y tint plus.
« Nous… méditons ensemble, lâcha-t-il en rougissant.
– Vous passez juste des heures à méditer ? Mais qu’avez-vous besoin de vous retrouver en haut d’une tour pour un exercice aussi solitaire ? Non, mon ami, tu ne t’en tireras pas à si bon compte. Dis-m’en plus… »
Iris se tordait comme un ver. Cela me fit un peu de peine de le voir lutter comme un enfant qui ne sait pas mentir. Mais mon envie d’en savoir plus était trop forte.
« Ecoute Sam, continua-t-il, si je te raconte tout, tu ne vas pas me croire. Tu vas me prendre pour un fou, tu vas dire que j’ai eu des hallucinations, qu’on m’a fait prendre une drogue.
– Crois-tu qu’avec tout ce que nous avons vécu, nos recherches d’Edelweiss pour nourrir une vie synthétique et sauver Perce-neige, je ne sois pas prêt à accepter n’importe quelle réalité, aussi étrange qu’elle puisse paraître ? Je te connais trop pour te croire capable d’affabuler. Alors qu’as-tu vu d’aussi perturbant ?
– Pas vu, juste entr’aperçu. Et encore, de façon très floue, comme dans un rêve qui ne parviendrait pas à se fixer. Des images furtives, quelques sons. J’ai cru voir une cité… mais à quoi bon te raconter, comment pourrais-tu comprendre ?
– Tu as vu Nova Alexandrie ? »
Iris se figea, interdit, presque terrifié.
« Tu… tu en as entendu parler ?, béguaya-t-il.
– Plus que tu ne le crois, mon ami. Ne le dis à personne, mais Camille m’avait longuement décrit cette cité légendaire des Idées ».
J’hésitai, d’instinct, à lui confier mes escapades avec Perce-neige dans ce monde parallèle. Car si je n’avais aucun doute sur ma capacité à garder un secret, je connaissais trop bien mon ami pour savoir qu’il ne résisterait pas longtemps à l’envie de raconter à qui voudrait l’écouter le récit fabuleux de nos aventures. Aussi préférai-je rester prudent.
« Ce n’est pas une légende, corrigea aussitôt Iris. Nova Alexandrie existe bel et bien, je peux te l’assurer.
– Mais comment peux-tu en être si sûr ?
– Parce que… parce que… les Maître s’y rendent. Je ne devrais pas te le dire. J’ai juré d’en garder le secret. Je n’en parle qu’à toi, parce que je sais que tu garderas tout pour toi. Mais au nom de notre amitié, je t’en conjure : pas un mot de ce que je vais te dire ne doit en aucune façon être répété.
– Tu as ma parole, tu connais sa valeur. »
Il hésita encore un peu, souffla bruyamment, puis poursuivit.
« Quand je te dis que nous nous réunissons pour méditer, c’est vrai. Nous nous plaçons en cercle, dans une pièce de l’Annexe, en haut du donjon ; nous nous tenons la main, et nous méditons. Sauf que ce ne sont pas des méditations ordinaires. Je ne peux pas trop te les décrire, ça ressemble à du chamanisme mais sans le côté… disons folklorique. Enfin, tu comprends ce que je veux dire… »
Je connaissais le peu d’attrait de mon ami pour tout ce qui pouvait sembler surnaturel. Je le rassurai donc et l’incitai à poursuivre.
« Ca combine à la fois des gestes, des sons, des paroles, la façon de respirer, et le fait d’être en contact physique les uns avec les autres. Les Maîtres appellent ça le Passage. Nous nous concentrons à la fois sur la conscience de nous-mêmes, des Idées, et des autres à qui nous tenons la main. Je ne saurais pas mieux te l’expliquer. Peu à peu, des visions apparaissent, qui deviennent de plus en plus réelles. Quelques Maîtres parviennent, après des années de pratique, à les fixer en scènes cohérentes. Et ces scènes se déroulent dans la nouvelle Alexandrie dont Camille t’a manifestement déjà parlé. T’a-t-il raconté ce qu’elle était à l’origine ? T’a-t-il parlé des atlas de l’Annexe ? »
Je lui racontai tout ce que je savais sur cette cité, et qu’il savait déjà. Les premiers Hypatistes qui en avaient dressé les contours. Les premiers récits collectifs, figés sur des papyrus puis sur des parchemins. La construction minutieuse d’un univers virtuel qui finit, par la puissance démiurgique de l’esprit, par devenir finalement aussi réel que nos cathédrales.
« C’est fabuleux, n’est-ce pas ? Iris en était tout excité.
– Fabuleux, oui. Mais as-tu pu accéder toi-même à cet univers ?
– Hélas, non, pas encore. Crois-moi, Sam, il faut des années de pratique pour cela. Je commence à peine mon apprentissage. Mais quelques images m’apparaissent déjà. Les autres Maîtres disent que c’est surprenant qu’elles surviennent dès maintenant, alors que je commence à peine mon initiation. Ils disent que c’est sans doute grâce à mes grandes capacités d’abstraction, puisqu’il semblerait que j’en sois doté. Je vois bien que mon cas les intéresse beaucoup. Ils m’encouragent à méditer chaque jour, de façon très intensive. C’est excitant, mais aussi épuisant. J’en ressors souvent désorienté, incapable de savoir dans quelle réalité je suis. »
En l’écoutant, j’étais inquiet pour mon ami. Car s’il était en effet d’une intelligence exceptionnelle, qui tutoyait le génie, je le savais aussi psychologiquement fragile, à la limite parfois de la schizophrénie. Les autres Maîtres en avaient-ils conscience ? Ne jouaient-ils pas avec le feu en poussant sans ménagement Iris dans ses limites psychiques ? Je l’incitai à rester prudent et à se ménager des temps de repos, quoi que pussent en penser ses nouveaux collègues.
Perce-neige était de mon avis. Elle ne voyait pas d’un très bon œil ces pratiques intensives, qui pouvaient être supportées par un esprit bien structuré mais qui, dans le cas d’une personnalité faible comme elle percevait celle d’Iris, pouvaient se révéler destructrices. Tout le monde n’avait pas été préparé dès l’enfance, comme elle, à naviguer entre des univers psychiques radicalement différents. Le risque était grand de se prendre pour un prophète, ou de sombrer tout simplement dans la folie.
Nous convînmes elle et moi de surveiller attentivement notre ami pour le protéger malgré lui.
V.17 – Limbes
« Avez-vous vu Iris aujourd’hui ? demanda Perce-neige lors d’un repas du soir.
– Non, cela fait bien plusieurs jours que je ne l’ai pas aperçu », répondit Marie.
Rablais et Forest acquiescèrent : personne ne l’avait vu depuis plusieurs jours.
Je fis le tour des camarades novices. Aucun n’avait été récemment en contact avec lui. Félicitée était la première étonnée de n’avoir eu récemment de lui aucune remarque courtoise. Elle avait mis cela sur le compte des nouvelles fonctions de son soupirant, qui ne pouvait plus se permettre le moindre comportement ambigu avec une novice. Et elle l’avouait : les gaucheries d’Iris lui manquaient.
Nous allâmes questionner Maître Galet. Il nous assura qu’il n’en savait guère plus de son côté et qu’il allait se renseigner. Mais pour Perce-neige qui avait assisté à l’entretien, la gestuelle du Maître trahissait un grand embarras : Galet mentait.
Lui tirer les vers du nez eût été trop risqué : n’était-il pas Maître en psychologie ? Il détecterait aussitôt la manœuvre. Nous décidâmes d’aller plutôt interroger Maître Thomas, dont les talents en philosophie s’accompagnaient d’une totale candeur dans la compréhension des manigances sociales. Perce-neige n’eut aucun mal à lui faire avouer tout ce qu’il savait, sans qu’il eût même la sensation de révéler quoi que ce fût.
Perce-neige revint vers nous très inquiète.
« Iris va mal, très mal. »
Nous la laissâmes continuer.
« Il y a trois jours, les Maîtres se seraient réunis dans l’Annexe pour méditer. Iris aurait commencé à tenir des propos incohérents, à s’agiter. Puis il aurait convulsé, comme sous l’effet d’une crise d’épilepsie. Depuis, il serait à moitié inconscient, confus, comme s’il était possédé… Les Maîtres ne savent pas quoi faire. Le médecin ne comprend pas ce qui se passe. Ils parlent de faire venir des spécialistes de l’Institut. Maître Thomas n’en sait manifestement pas plus. »
Nous étions atterrés. Notre ami avait besoin de nous ; nous ne pouvions rester sans rien faire. Nous allâmes donc trouver Isaac pour jouer franc-jeu : nous savions qu’Iris était au plus mal, nous voulions le voir. Isaac hésita mais dut se résoudre à satisfaire notre demande. Perce-neige et moi furent autorisés à pénétrer dans l’Annexe pour voir notre ami.
Nous montâmes donc l’escalier de pierre de plus en plus étroit qui donnait accès aux derniers étages du donjon. Maître Isaac nous accompagnait. Nous accédâmes, au tout dernier étage, à une chambre mansardée sous les lourdes charpentes de bois.
Nous vîmes notre ami allongé sur un lit. Maître Galet était à côté de lui. Iris suait et marmonnait des propos inaudibles. Parfois il s’agitait, faisant de grands gestes violents, comme s’il se battait contre un ennemi invisible. Il avait maigri. Le médecin vint vérifier sa température et sa tension. Il était très inquiet.
Perce-neige s’assit sur le lit et prit la main d’Iris. Elle commença à lui parler, doucement, pour essayer d’entrer progressivement en contact avec lui. Sa voix devenait de plus en plus mélodieuse. Elle se mit bientôt à chanter, d’un timbre chaleureux et apaisant. Des images se formèrent spontanément dans ma tête. Je vis une mer paisible, parcourue de mouettes qui partaient au loin. Elles allaient d’un navire à l’autre, à la recherche d’un matelot au nom d’Iris. Le capitaine d’un galion assura qu’il n’avait pas de tel marin à bord. Une autre mouette se posa sur une trirème en tous points semblable à celle que j’avais prise moi-même pour gagner Nova Alexandrie. Là encore, il n’y avait pas d’Iris à bord. Nous volâmes ainsi de navire en navire, durant des heures, cherchant encore, repoussant l’horizon.
Un tronc flottant attira notre attention. Il s’agissait plutôt d’un radeau de fortune fait de branchages. Un corps y gisait déshydraté, brûlé par le soleil. Ses bras et ses jambes étaient tailladées de plaies profondes qu’avaient laissées des prédateurs marins. Nous reconnûmes tout de suite notre ami, malgré son visage boursouflé.
La mouette se posa à côté de lui. Iris était inconscient, le souffle faible. Perdu dans les limbes, entre notre monde matériel et celui auquel il avait tenté avec trop d’empressement d’accéder. L’issue de cette traversée ne faisait aucun doute : il allait mourir. Son psychisme fragile n’avait pu supporter le choc du passage. Peut-être avait-il échoué à vaincre ses propres angoisses ? Je repensai au combat que j’avais moi-même mené avec le terrifiant dragon des mers… Or, j’avais eu l’aide constante de Perce-neige. Iris, lui, avait traversé seul. Quelle inconscience ! Mais quel courage aussi. Avait-il seulement réalisé, avant de s’engager dans cette quête, quels périls il allait affronter ?
J’en voulais aux Maîtres de l’avoir incité à oser, sans grande préparation, une telle traversée. Iris était un génie, mais il n’était pas un dieu. N’aurait-on pu lui fournir l’aide d’un Passeur ? Ou au moins un navire digne de ce nom ? Je ne comprendrais que plus tard que de tels navires, qui m’avaient permis d’accoster, étaient pour la plupart d’entre nous parfaitement inaccessibles. Et que c’était à la nage, ou sur des radeaux de fortune, que les Maîtres parvenaient à force d’obstination à traverser les limbes, perdant parfois un des leurs durant cette épreuve. Le monde des Idées n’accordait pas si facilement un visa d’entrée. Je perçus toute la différence entre ce Petit passage, périlleux, que les Maîtres tentaient l’un après l’autre depuis des siècles, et le Grand passage en trirème dont j’avais pu bénéficier grâce à Perce-neige et l’assistance d’Alice. Il y avait finalement la même différence qu’entre gravir l’Everest à pied et y accéder par hélicoptère. Je n’en eus que plus d’estime pour mon ami.
Que pouvais-je faire pour lui à présent ? Je l’observais à travers les yeux de la mouette. Et j’enrageais de cette impuissance. Perce-neige chantait avec un timbre de plus en plus riche et contrasté. Elle superposait les octaves, passant de l’un à l’autre de façon quasi simultanée, donnant ainsi l’illusion d’un chant à plusieurs voix. Je l’entendais pousser la psycho-langue dans les limites qu’elle pouvait atteindre. Aussi l’illusion me devint plus réelle que la réalité elle-même. Je ne voyais plus seulement la mer, les mouettes, les poissons, mais j’étais la mer, j’étais les mouettes, j’étais les poissons… Gagné par la puissance des vocalises, je me sentais un dieu omniscient.
Une sirène apparut au loin. Elle nageait à une vitesse incroyable, laissant derrière elle une traînée d’écume. Elle atteignit le radeau et s’y hissa. Tandis qu’elle caressait presque amoureusement les cheveux d’Iris, son chant devenait toujours plus puissant, assourdissant. Les notes devenaient aussi dures que des billes qui me frappaient le visage, comme si le son se muait en matière. Oui, il n’y avait pas d’autre façon de décrire la nature de ce que j’entendais : une mélodie si puissante que je pouvais la toucher. Toute distinction entre symbole et matière était abolie.
Le chant créa un cocon protecteur autour d’iris. Le soleil, l’eau infectée de requins ou autres serpents de mer… plus rien ne pouvait désormais l’atteindre. Ce cocon flottait, formant une coque. La sirène le poussait devant elle, tandis que je les suivais à œil de mouette.
Mon ami vogua ainsi durant des heures, ou des jours – j’avais perdu toute notion du temps. La mouette était épuisée, et je sentais le cocon devenir d’heure en heure plus fragile.
C’est alors qu’Iris revint à lui. Il regarda avec étonnement cette bulle translucide qui l’entourait. Il regarda la sirène qui repoussait chaque fois la bulle de sa tête. Et il comprit. Je le vis sourire et reprendre vie. Ses blessures s’estompèrentg à vue d’oeil. Quand le cocon se désagrégea, il était redevenu assez fort pour nager. Il plongea, s’enfonçant dans un tunnel lumineux où je ne pouvais le suivre.
L’horizon se désintégra d’un coup, dans un bruit de cymbale qui me fit mal aux oreilles. Je fus brutalement projeté dans la chambre mansardée du donjon. Le choc fut si violent que je tombai de ma chaise, me cognant la tête contre un meuble. Un peu de sang coula de mon front.
Perce-neige était à demi-consciente, à côté d’Iris qui ouvrait lentement les yeux. Il marmonna qu’il voulait boire. Je me précipitai pour porter un verre à ses lèvres craquelées. Il but goulûment, pendant que Perce-neige reprenait à son tour ses esprits. Elle était épuisée, ne parlant plus que faiblement. Elle avait ramené Iris ! Elle l’avait récupéré des limbes où son esprit avait sombré. Plus qu’un miracle, c’était une promesse inespérée pour tous ceux qui, à l’avenir, y feraient à leur tour naufrage.
Je pris la main de ma petite sirène. Elle sentait encore la mer, ses cheveux mouillés d’une eau qui ne pouvait tremper les draps. Tandis qu’elle baisait tendrement le front d’Iris, je vis derrière elle le visage d’Isaac. Crispé, les dents serrés, il semblait lutter contre une sourde colère.
V.18 – Convalescence
Nous consacrâmes les jours suivants à veiller notre ami, qui récupérait peu à peu. Nous nous relayions à son chevet, lui apportant à boire, à manger, ou tentant simplement de le divertir quand malgré son état extrême de fatigue il pouvait se permettre quelques minutes d’activité intellectuelle. Officiellement, Iris avait fait une crise d’épilepsie, due à des exercices de méditation trop intensifs. Nul parmi les disciples ne mit en doute cette explication qui leur avait été fournie.
Pour le distraire, Marie avait entrepris de lui relire l’intégralité du Jeu des Perles de verre, qu’Iris m’avait fait découvrir lors de notre escapade alpine. Le concept sur lequel s’appuyait ce roman – une fusion complète entre les sciences, les mathématiques et le langage musical – avait touché la sensibilité de Marie, puisque c’est cette même symbiose qu’elle essayait de mettre concrètement à l’oeuvre dans ses compositions musicales. Iris l’écoutait avec la ferveur d’un pèlerin récitant ses psaumes. Il en connaissait de multiples passages par coeur, s’amusant parfois de quelques imperfections de traduction qu’il avait cru relever de l’auteur germanophone.
Félicitée lui rendit une courte visite, qui suffit à le mettre d’humeur joyeuse durant plusieurs jours. Il garda précieusement dans sa chambre le petit bouquet d’oeillets qu’elle lui avait apporté. Rablais lui montait régulièrement quelques pâtisseries qu’il chapardait en cuisine. Nul ne lui tint rigueur pour cette petite entorse à l’idéal de frugalité que nous étions censés poursuivre.
Iris reprenait chaque jour de la vigueur. Malgré tout, Perce-neige restait inquiète.
« Iris est un génie de l’abstraction, mais un nain de l’émotion, confia-t-elle. Et ça va être pour lui un sérieux problème. Son naufrage était prévisible. »
Perce-neige m’expliqua sa théorie. Selon elle, les capacités exceptionnelles d’abstraction que possédait Iris lui donnaient un accès privilégié au monde parallèle de Nova Alexandrie. Le symbolisme s’exprimait avec une telle force en lui qu’un lien s’ouvrait presque naturellement, dans son esprit, entre les deux univers. Et c’était bien en cela qu’il intéressait les autres Maîtres de la Citadelle. Mais sa personnalité était trop faible pour y exercer le moindre contrôle. Les idées, dans son cerveau, se développaient selon leur propre logique, sans qu’une émotion structurée, une conscience forte de soi, vînt les ordonner. Le monde des Idées se développait en lui, mais il ne pouvait guère, en retour, y tracer sa propre route, y inscrire un sillon de sa conscience. Paradoxalement, Iris était le relais d’un monde auquel il ne pouvait accéder en tant que personne.
« Il y a une grande différence, essaya-t-elle de m’expliquer, entre une Idée et la conscience d’une Idée. Or sans réelle conscience de l’Idée, je doute qu’il puisse aisément accéder à Nova Alexandrie. »
Je mesurai alors toute la puissance de l’enseignement que Camille avait prodigué à sa fille, qui consistait moins à développer ses capacités d’abstraction qu’à hypertrophier sa conscience et à la moduler à sa guise. Que 2 plus 2 fissent 4 n’avait guère d’importance. Ce qui en avait pour faire exister cette idée, c’était que des esprits conscients pussent s’en rendre pleinement compte et l’intégrassent émotionnellement en eux.
Isaac venait prendre régulièrement des nouvelles de son ancien disciple. Il restait à côté de lui, pour discuter longuement. Isaac s’en voulait-il d’avoir précipité son entraînement ? Je le sentais tendu, en particulier quand il croisait Perce-neige. Il faisait des efforts maladroits pour nous éloigner d’Iris. Perce-neige s’en amusait, mais son comportement m’interrogeait : de quoi diable avait-il peur ? Il n’avait jamais été question, entre nous, d’accuser notre directeur de quoi que ce fût. Nous savions qu’Isaac avait cru bien faire en poussant Iris aux extrêmes limites de ses capacités. N’était-ce pas son rôle entre ces murs de favoriser jusqu’au bout l’excellence ? Alors quoi ? Qu’est-ce qui pouvait bien le mettre dans un tel état d’angoisse ? Perce-neige n’en avait comme moi aucune idée.
L’accident d’Iris avait eu toutefois une conséquence fâcheuse : Isaac et Galet avaient assisté tous deux à l’incursion de Perce-neige dans les limbes. Qu’avaient-ils vu exactement ? Et qu’en avaient-ils déduit ? Perce-neige avait été trop occupée, sur le moment, pour s’en soucier. L’urgence était de ressusciter notre ami. Mais ni Galet, ni Isaac, n’était idiot. Perce-neige était la fille de Camille, et tout le monde – parmi les Maîtres – connaissaient l’obstination du vieil Érudit à réaliser un jour le Grand Passage. Qu’il ait cherché à entraîner sa fille pour le réaliser était une évidence. Mais que celle-ci pût désormais traverser les limbes à volonté et, surtout, amener avec elle des novices, devait rester secret.
Nous ne reparlâmes jamais, ni avec Isaac, ni avec Galet, de ce sauvetage a priori impossible. Le sujet était devenu tabou. Mais nous nous doutions qu’une brèche dangereuse venait de s’ouvrir dans cet univers de secrets.
Chapitre VI
VI.1 – Premières écritures
Iris était à présent complètement rétabli. Il avait retrouvé son entrain pour les questions épistémologiques les plus ardues. En tant que Maître, il organisait différents séminaires qui intriquaient physique théorique et philosophie. Je dois avouer que nous n’y comprenions pas tout. Mais chacune de ses interventions nous entraînait dans des abîmes de la pensée.
Il avait repris les séances de méditation avec les autres Maîtres. Mais il s’y impliquait avec moins d’intensité, se contentant – me racontait-il – de laisser les images venir à lui, sans forcer le passage. Il n’avait donc de Nova Alexandrie que des visions évanescentes. Il ne percevait qu’un brouillard d’où émergeaient des formes vagues. Ses confrères l’en assuraient cependant : d’année en année, à force de pratique et d’efforts, ces formes se préciseraient, des personnages lui apparaîtraient. Irait-il jusqu’à déambuler librement dans les ruelles de cette cité parallèle, comme nous l’avions fait, Perce-neige et moi ? Les plus grands Érudits y étaient parvenus. Je ne doutais pas qu’Iris en serait un jour capable.
Nous hésitions à l’inclure dans nos propres escapades. Iris ne manquerait pas d’être émerveillé à son tour par tout ce qu’il y découvrirait. Et il serait pour nous un apport précieux. Mais saurait-il garder pour lui les aventures qu’il vivrait avec nous ? Nous redoutions qu’il n’eût ni la capacité ni même la volonté de cacher quoi que ce soit à Isaac. Il y avait une telle complicité intellectuelle entre eux d’eux ! Nous préférâmes donc garder pour nous le privilège de nos incursions dans la terre des Savoirs.
J’y retournais pour ma part avec assiduité, chaque fois que Perce-neige m’en frayait l’entrée. Le contact rugueux que j’avais eu avec les Iroukaïs ne m’avaient en rien découragé. Tout au plus m’avait-il incité à rester prudent. Je savais désormais comment me protéger de ces hordes sauvages, en m’entourant d’une forte charge symbolique. Si l’ail prévient – dit-on – la morsure des vampires, quelques extraits d’arbre-livres suffisent en général à faire fuir ces êtres frustes. Pouvoir du symbole sur la matière… Mais comment de simples taches sur des feuilles, formant des lettres, pouvaient avoir un tel effet sur l’esprit ? Un jour que je la lui posai, ma question amusa Zératos-Thène, qui m’avoua se l’être lui-même demandé il y a de nombreux cycles… Mais peut-être fallait-il pour cela comprendre d’abord comment était née l’écriture elle-même. Revenir aux origines de cette étape majeure de l’évolution, qui vit une espèce particulièrement intelligente et consciente trouver un moyen singulier de transmettre, par des voies détournées et non biologiques, des informations sur les expériences acquises, aux générations suivantes.
L’écriture avait gravé ses premières traces en Mésopotamie, quelque 4 000 ans avant notre ère. Pourquoi là ? Et pourquoi à ce moment-là de notre histoire ?
« Une invention naît d’une capacité et d’un besoin », me souffla le vieux bibliothécaire, qui n’avait guère d’autre explication à me livrer.
Tout en parlant, il fouilla dans sa boîte à épices, ouvrant l’un après l’autre les petits tiroirs qui renfermaient chacun un humus différent. Il racla le fond d’un compartiment.
« Diable, il ne m’en reste déjà presque plus… soupira-t-il. C’est un humus qu’on trouve peu sur les marchés d’Alexandrie. Il faudra que je passe commande à la prochaine caravane qui partira vers la haute Antiquité. »
Il versa les restes de poudre dans le thé qu’il m’invita à boire. La saveur était un peu râpeuse, tant l’épice était vieille, mais je sentis bientôt en moi une profonde joie. Etait-ce vraiment la mienne ? Non, c’était une joie beaucoup plus ancienne. Une joie fossilisée depuis des millénaires dans la poudre d’humus. Celle d’Ibbi-Sin, marchand mésopotamien, qui irriguait peu à peu les aires émotionnelles de mon propre cerveau.
(…) Ibbi-Sin le marchand est content. Il décharge des rondins de bois du radeau amarré sur le canal qui rejoint l’Euphrate. Son dos est douloureux, mais il se frotte les mains : ces beaux rondins vont se vendre à prix d’or sur les marchés d’Uruk. Il s’essuit le front avec un chiffon. La plaine, tout autour, étale à perte de vue ses champs d’orge et de blé.
« Cette région, pense-t-il, est exceptionnelle ». Nulle part où il est allé, Ibbi-Sin n’a vu plus qu’ici, dans cette basse Mésopotamie, encore appelée pays de Sumer, une telle concentration d’hommes et de richesses. Et surtout une telle activité ! La cité d’Uruk, qui en est le centre névralgique, a faim de tout : de bois, de pierres, de métaux… Rien ne semble rassasier ce ventre vorace qui absorbe tout ce que veulent bien lui fournir les marchands comme lui. Sa population grossit chaque année. Et fait enfler de nouveaux quartiers qui mordent toujours plus loin les terres qui ceinturent la ville. Sa surface dépasse déjà les 70 hectares! A-t-on déjà vu une telle démesure ? Ibbi-Sin se souvient des quelques cahutes qui composaient le village où il est né, à de longues journées de marche. On allait parfois, en famille, troquer quelques légumes pour une poule « à la ville ». Combien y avait-il de maisons derrière les mauvaises palissades de bois qui l’avaient tant impressionné à l’époque ? Pas plus d’une vingtaine, assurément. Qu’aurait-il ressenti s’il s’était rendu, enfant, à Uruk ?
La mégapole doit sa puissance à ses canaux d’irrigation, qui compensent dans la plaine l’insuffisance des pluies. Les digues contiennent les crues du printemps, empêchant le Tigre et l’Euphrate de noyer les récoltes. « De la belle ouvrage », s’exclame Ibbi-Sin devant un terrassier qui en drague les fonds. « Pour sûr, lui répond l’ouvrier en soufflant comme une bête, entre deux coups de sarcle. Mais quel boulot d’entretenir tout ça ! ». Résultat ? Les familles, au pays de Sumer, ne partent pas, même quand la population grossit, pour aller défricher ailleurs des lopins disponibles. Non, elles restent pour entretenir ces digues. Et finissent par s’entasser, l’une après l’autre, dans ces plaines où elles sont nées, nourries en retour par ces terres fertiles et par l’élevage de bœufs, de moutons, de chèvres et de porcs. Pourquoi Uruk a-t-elle grossi plus que les villages autour d’elle, au point de les englober peu à peu ? Tout ce qu’ibbi-Sin peut dire, c’est qu’il est loin le temps où Unug, l’ancien nom d’Uruk, n’était qu’un modeste hameau. C’est un passé que lui-même n’a jamais connu. On se le raconte, de génération en génération, à travers des récits dont l’origine s’est à jamais perdue dans la mémoire éteinte des anciens conteurs aujourd’hui disparus. Le grand-père d’Ibbi-Sin, avant qu’il ne quitte ce monde pour un autre dans l’au-delà, lui a raconté comment la déesse Ishtar a créé les premières demeures d’Uruk. Et il a écouté, fasciné, ces histoires d’hommes et de dieux, impressionné par l’immense savoir logé dans la mémoire de son grand-père. Uruk, assurément, est bénie des dieux. Comment interpréter autrement le fait que tant d’hommes et de femmes se regroupent en un même lieu ? Ibbi-Sin y voit la bienveillance d’Anu et d’Ishtar, qui veillent au destin d’Uruk, à travers le grand temple – l’Eanna – dédié à leur gloire.
Il profitera de son séjour pour leur porter une modeste offrande. Mais pour l’heure, il y a mieux à faire. En bon commerçant, Ibbi-Sin pense d’abord aux juteuses transactions qui s’annoncent. Car si les besoins de ces nouveaux citadins sont immenses, le pays est pauvre en ressources. Pour le plus grand profit des caravaniers et autres marchands qui vont chercher, de plus en plus loin, du bois, des pierres et des métaux, parcourant les montagnes du nord pour atteindre le plateau perse au Levant ou l’Anatolie au Couchant. Ils les revendent ensuite – de plus en plus cher – aux négociants sumériens qui assurent ainsi leur fortune. D’une génération à l’autre, ces commerçants deviennent les nouveaux maîtres de ces terres riches en promesses. Car en échange de son bois, Ibbi-Sin sait qu’il pourra acheter, chez la myriade d’artisans qui se sont installés ici, de quoi émerveiller les peuples simples chez qui il retournera. Poterie, céramique, travail des métaux… c’est ici, à Sumer, qu’on trouve ce qu’il y a de plus fin et de meilleur goût !
Mais si Uruk fascine, ce n’est pas seulement par l’étalage de ses richesses. C’est aussi par l’organisation unique qui l’anime. Chacun, ici, semble avoir sa place. Alors que dans les hameaux qui l’entourent chacun fait ce qu’il peut pour survivre, ici les richesses sont telles que l’artisan n’a nul besoin de travailler la terre : le paysan s’en charge. Les marchands, comme Ibbi-Sin, lui apportent de quoi travailler. Certains habitants, même, ne produisent rien. Ils organisent la cité, qui pourvoit en retour à leur nourriture et à leurs autres besoins. Au temple, les prêtres prennent soin d’assurer la clémence des dieux. Quant aux soldats… mieux vaut ne pas les contrarier. Car la taille des monuments rappelle à l’étranger qui l’aurait oublié, que le pouvoir ici n’est pas un vain mot. L’élite qui entoure le roi est de plus en plus puissante. Et il le faut bien, pour organiser la ville, gérer les stocks et prélever les taxes. Tout cela devient de plus en plus complexe. A l’image de la cité, dont le dédale de rues devient si étendu qu’Ibbi-Sin, parfois, s’y perd.
« En route, s’exclame-t-il. La fortune m’attend ! » (…)
VI.2 – Arbre racine
Je ne pus poursuivre l’expérience mémorielle de son histoire, qui avait dû percoler sur d’autres parcelles d’humus. Mais j’avais ressenti assez de vieux souvenirs pour éprouver l’envie violente de découvrir par moi-même cette ancienne cité.
« Ce sera un long voyage », me prévint Zératos-Thène, qui s’y était lui-même rendu quand il était jeune adulte, sur les traces des premières écritures. Longtemps il avait cherché à retrouver les consciences enfouies des hommes qui avaient gravé des premiers bouts de phrase, que ce fût sur de l’argile, sur de l’os ou sur de la pierre. Pourquoi l’avaient-ils faits ? Que cherchaient-ils à transmettre ?
« Cette question a guidé les chercheurs qui se sont réunis dans ton monde, le 26 septembre 2009, au Musée archéologique de Nice-Cemenelum, me confia-t-il. Un colloque qui a laissé ici une forte empreinte… Oui, une forte empreinte. Un puissant arbre-livre en a émergé, deux ans plus tard. On m’en a ramené des feuilles, sous ce titre : « Les premières cités et la naissance de l’écriture ». Je les ai rassemblées dans un herbier personnel. »
Il m’invita à le suivre, d’un pas lent, dans les archives centrales de la bibliothèque. Elles s’organisaient autour d’un immense escalier hélicoïdal qui montait dans un sens, et descendait de l’autre, jusqu’à des hauteurs ou des profondeurs vertigineuses. Nous étions là dans le coeur névralgique de la Grande Bibliothèque, monument lui-même emblématique de Nova Alexandrie. Dans le Saint des saints de cet univers académique.
Nous y croisâmes une armée de bibliothécaires, de tous âges et des deux sexes, tous affairés à chercher l’écrit rare qu’un érudit leur avait demandé. Ils montaient et descendaient l’escalier, les bras chargés d’écrits, se frôlant pour frayer leur passage, comme des globules rouges dans une artère. C’étaient eux qui apportaient l’oxygène à ce monde. Que leur ballet s’arrête, et cet univers de savoir s’écroulait comme un animal mort.
Du gigantesque escalier central rayonnaient des couloirs qui se déployaient comme autant de branches, organisées par thèmes. Chaque branche comportait elle-même de multiples rameaux, selon un motif fractal, pour aboutir après des kilomètres de marche dans un dédale ramifié d’une complexité indescriptible, vers une unique alvéole où se multipliaient, de façon naturelle et spontanée, des copies d’un même ouvrage.
« Impressionnant n’est-ce pas ? me lança Zératos-Thène. Le coeur de notre bibliothèque est construite sur un gigantesque arbre-livre : l’Arbre-racine. Le grand escalier en spirale a été construit autour de son tronc. Les couloirs suivent ses branches. Et on y greffe au bout de chacune, dans les alvéoles, un morceau de chaque arbre-livre retrouvé dans la terre des Savoirs. Il est rare que la greffe échoue. Cela arrive parfois, pour certaines œuvres qui ne supportent pas la copie… Mais le plus souvent, le greffon se développe et fournit des copies régulières de toutes les pages de chaque ouvrage. »
Le savoir en ce monde était donc vivant ! Il croissait, se reproduisait, puis se décomposait en un humus riche qui fertiliserait de nouveaux savoirs.
« L’Arbre-racine est en quelque sorte la mémoire collective de notre monde, poursuivit le vieil érudit, tout comme Internet devient peu à peu celle du vôtre. Dieu seul sait, d’ailleurs, jusqu’où les propres racines de votre réseau électronique se ramifient… »
Nous marchions dans des couloirs de plus en plus étroits, dans les parties supérieures de l’Arbre, jusqu’à un corridor faiblement éclairé, que l’on ne pouvait suivre qu’en file indienne. Il nous mena vers une porte de vieux bois, que Zératos-Thène ouvrit en sortant une lourde clé cuivrée de sa poche. Nous poussâmes la porte d’un coup d’épaule pour parvenir dans une petite salle dont les murs perlaient d’humidité.
« C’est là, m’avoua Zératos-Thène, que je range mes propres ouvrages… car oui, nous en écrivons, nous-aussi, même s’il n’en émerge pas d’arbre-livre. A moins que, par une amusante ironie du sort, ils ne créent eux-mêmes par effet miroir, dans votre propre univers, d’aussi fascinantes excrétions ! »
J’essayai en vain d’imaginer, parmi les manifestations considérées dans notre monde matériel comme surnaturelles, celles qui pourraient éventuellement représenter de telles excroissances, nées des concepts engendrés en amont par nos propres représentations mentales, dans un jeu récursif de mise en abyme. Si Marie avait été là, elle aurait sans doute parlé, en mathématicienne, d’isomorphisme entre nos deux mondes…
Me laissant à mes réflexions, Zératos-Thène extirpa d’un coffre un épais volume relié de cuir.
« Ah, te voilà… », gloussa le vieillard d’un air satisfait.
Il le frotta pour en ôter la poussière. Cela faisait manifestement de nombreux cycles qu’il n’avait plus été ouvert.
« J’y avais consigné toutes mes recherches sur les origines de l’écriture. Un travail malheureusement interrompu… »
Ses yeux brillaient à mesure qu’il tournait les pages, lustrés par les souvenirs qui émergeaient.
« La voici… ! »
Il pointa son doigt sur un passage qu’il avait écrit il y a plusieurs cycles, et qu’il me lut à haute voix :
Avaient-ils vraiment besoin d’immortaliser leurs récoltes, ou de garder une trace de ce que chacun devait à leur roi ? « La thèse qui propose de voir dans les pratiques comptables l’origine de l’écriture a pour point de départ un double postulat dont la pertinence est contestable », proteste dans Les premières cités et la naissance de l’écriture Jean-Jacques Glassner, un spécialiste de la Mésopotamie à l’Ecole des Hautes études en sciences sociales (EHESS). Car le préjugé est tenace, qui voudrait que ces premiers scribes n’aient eu en tête que des problèmes terre-à-terre, comme se nourrir ou régler des problèmes d’héritage. C’est tirer un trait un peu rapide sur des motivations plus spirituelles. Voire ludique, à l’image des tifinagh que les Touaregs dessinent dans le sable. « Une fois le camp dressé, les bêtes attachées, les jeunes gens se réunissent et se livrent à des concours de devises par écrit. Ils dessinent les signes sur un pan de sable lissé et aplani. Le lendemain, toute trace est effacée, et la page, pour ainsi dire, tournée à jamais », raconte Pascal Verjus, égyptologue à l’Ecole pratique des hautes études, dans le même ouvrage. N’écrit-on aujourd’hui que pour dresser sa liste de courses ?
Zératos-Thène leva le nez, pensif.
« C’est bien vrai, s’exclama-t-il. Bien des cycles après, je partage toujours ce point de vue. On a toujours pensé que l’écriture était née de besoins basiques et concrets, comme inventorier des récoltes pour les impôts. Mais l’humain n’est pas si matérialiste. Il ne se soucie pas que de remplir son ventre. Il veut rêver. Imaginer. Et raconter ces belles choses qu’il voit dans sa tête. »
Il poursuivit la lecture de ses anciens écrits.
L’autre préjugé, c’est de croire que des registres de compte ne peuvent pas être tenus oralement. « Songeons par exemple à l’Empire Inca qui contrôlait un territoire immense sans écriture, en se contentant des techniques mnémotechniques comme les qipu », rappelle Pascal Verjus. Les faits, eux, sont têtus : en Mésopotamie, les plus anciens documents écrits ne proviennent pas des quartiers sur terrasses réservés aux élites, mais de demeures privées des villes basses. Ils sont donc sans rapport avec l’organisation de l’État. Dans ces maisons plus modestes, les archéologues ont retrouvé des bulles ou des tablettes portant des sceaux. « Elles ne peuvent être ouvertes qu’une seule fois sans être brisées, ce qui est incompatible avec les normes d’une documentation administrative dont les pièces sont susceptibles d’être consultées autant de fois que nécessaire », relève Jean-Jacques Glassner. Alors à quoi servaient-elles ? « Pour faire court, force est d’admettre que l’on est en présence de documents à caractère privé et, plus précisément, à caractère juridique ; ils accompagnent des transactions ou des contrats », analyse l’assyriologue. L’écriture n’apparaîtra dans l’administration que bien plus tard. « L’écriture n’a pas été inventée pour résoudre de banales questions de comptabilité ou d’administration ; elle n’apparaît dans ce cadre que parce qu’elle existe déjà ailleurs », en conclut-il.
Zératos-Thène fit une pause pour reprendre son souffle. Il éprouvait un plaisir évident à se replonger ainsi dans ses écrits et à partager ses anciennes conclusions. Cependant, sa thèse m’intéressait : j’avais moi-même toujours lu que l’écriture était née de besoins terre-à-terre comme le cadastre ou le calcul de l’impôt. Les dessins de Lascaux n’auraient-ils eu comme fonction que de servir de manuel de chasse ? Nous sous-estimons toujours le besoin de transcender nos besoins immédiats et de trouver du sens. Or nos ancêtres avaient bien le même cerveau que nous.
« En Egypte, les premières traces d’écriture embryonnaire, exhumées de la tombe U-j, dans la ville ancienne d’Abydos, ont elles-aussi, de toute évidence, plus d’ambition que de compter des khar de blé », relut avec gourmandise Zératos-Thène.
Ces étiquettes en os de quelques centimètres, dans lesquelles ont été sculptés des énoncés-titres de quelques syllabes, identifient, certes, des produits contenus dans des jarres. « Le temps, le soin et le coût requis pour leur façonnage et pour l’incision des inscriptions et leur incrustation donnent à penser que leur fonction dépassait le simple usage pratique », observe toutefois Pascal Vernus, pour qui ces premiers hiéroglyphes ont plutôt pour fonction de capter l’essence-même de ce qui est inscrit, de l’inscrire dans un contexte rituel. En un mot, de le sacraliser. Tout comme les hiéroglyphes qui seront introduits bien plus tard, au XIIIe siècle av. J.-C., chez les Hittites d’Anatolie, pour accompagner des représentations divines ou humaines en évoquant leurs noms, titres et épithètes. Agissant comme une signature, ils étaient là pour être vus, contemplés sur la paroi rocheuse. Idem en Chine, où les premières inscriptions retrouvées sur des carapaces de tortues évoquent plus la transcription d’oracles que le banal relevé d’une récolte. Comme si l’écriture était chose trop importante pour lui confier une utilité pratique.
-L’écriture était donc considérée dès le départ comme sacrée ? m’exclamai-je.
– Exactement. Les mots ne sont-ils pas comme des dieux, faisant exister d’une certaine façon ce qu’ils représentent ? Au commencement était le verbe… Votre monde s’imagine que la matière était première. Mais que serait la matière sans un mot pour la désigner ? »
Zératos-Thène sortit une petite gourde de sa poche. Il en but de courtes gorgées et recala ses lunette sur son nez. Il inspira bruyamment et continua la lecture.
Une chose au moins est sûre : partout où elle s’est développée, l’écriture a attendu l’essor des premières villes. Les archéologues en trouvent les toutes premières traces à Uruk, la première de toutes les cités, au sud de la Mésopotamie. Des premiers jetons, matérialisant des chiffres,sont d‘abord enfermés dans des bulles d’argile. Des empreintes, gravées à l’extérieur, évitent ensuite de devoir les briser pour en connaître le contenu. « Nous ne savons pas à quel moment apparaît l’idée de remplacer les empreintes des jetons sur la surface des bulles en argile par des encoches dont les formes sont analogues mais qui sont tracées avec un calame », observe Jaroslaw Maniaczyk, assyriologue au musée du Louvre, dans un second ouvrage, Les Origines de l’écriture, publié en 2012 de leur monde aux éditions Le Pommier. Toujours est-il que les jetons deviennent inutiles. La bulle se transforme en tablette, couverte de chiffres tracés à partir de deux éléments simples : l’encoche et le cercle. Des premiers pictogrammes représentent un objet entier – une tête, un vase – ou une partie, comme une tête de bœuf pour signifier le bœuf entier, un pubis triangulaire pour une femme. Une ligne ondulée se met à signifier « l’eau », un rectangle traduit une « planche de bois »… Une tête hachurée au menton prend le sens de « bouche ». Un vase hachuré devient « bière ». Un même signe inscrit plusieurs fois traduit le pluriel, mais aussi le débat. « On pouvait aussi enrichir le répertoire en associant deux ou, plus rarement, trois signes, la juxtaposition de deux signes leur donnant un sens nouveau », décrypte l’assyriologue. Ces pictogrammes ont un atout immense : ils peuvent être interprétés dans n’importe quelle langue parlée. Mais à partir de 3200 av. J.-C., certains commencent à être utilisés pour prononcer la syllabe du mot qu’ils représentent. En les associant, on peut alors traduire phonétiquement d’autres mots plus longs, à la façon d’un rébus. Le signe « homme » (LU) suivi du signe « grand » (GAL) donne par exemple LUGAL, ou « roi ». Le dessin d’une flèche peut alors signifier également « vie » ou « côte » puisque ces trois mots se prononce à l’aide de la même syllabe « ti » en sumérien. « La barrière capitale entre l’écriture et la parole est définitivement franchie », souligne Jaroslaw Maniaczyk. Ces pictogrammes deviennent de plus en plus abstraits. Les cercles, difficiles à tracer dans l’argile avec un roseau, se muent en courtes entailles. L’élément de base devient un simple trait en forme de clou, d’où le nom d’écriture cunéiforme (du latin cuneus, clou). Le répertoire se fige peu à peu à environ 600 signes différents pour traduire l’ensemble de la langue sumérienne.
Un craquement l’interrompit. Le sol vibrait légèrement. Cela ressemblait à un léger tremblement de terre, mais Zératos-Thène ne paraissait nullement inquiet. Bien au contraire.
« Entendez-vous ? », me demanda-t-il.
De nouveaux craquements se succédaient en saccades, tandis que le sol bougeait comme sur un bateau.
« L’Arbre-racine continue de grossir. Nous devons nous trouver à proximité d’un nouveau rameau. Cela va faire autant de places en plus pour greffer de nouveaux ouvrages ».
Zératos-Thène s’en frottait les mains par avance. Car malgré les dimensions gigantesques de l’Arbre-racine, la place manquait toujours dans cette bibliothèque en constante expansion. Cet univers de lecture enflait, sous l’effet d’une force invisible similaire, à sa façon, à cette « énergie noire » que les cosmologistes imaginaient dans notre monde pour expliquer l’expansion continue, depuis le big-bang, de notre espace-temps. Cela expliquait sans doute que malgré cette expansion permente, les dimensions extérieures de la bibliothèque restent à peu près constantes pour quiconque n’avait pas encore pénétré les lieux : c’est la métrique elle-même qui se modifiait à l’intérieur, comme elle pouvait le faire dans notre univers à proximité d’un trou noir. Sauf que la métrique, à Nova Alexandrie, était liée aux idées et non à la matière. C’étaient elles qui déterminaient la géométrie de ce monde exotique. La densité d’ouvrages, de concepts et de réferences sauvegardés en ce lieu devenait si énorme qu’elle courbait littéralement l’espace lui-même, altérant les longueurs et peut-être aussi le temps. Iris aurait sans doute eu là-dessus de plus justes lumières, lui qui maîtrisait le formalisme de la Relativité générale d’Einstein.
Que l’Arbre-racine pût continuer à grandir sans faire s’écrouler l’édifice construit autour de lui me fascinait. En fait, il était évident que la bibliothèque elle-même grandissait avec lui. Tout comme Zératos-Thène m’expliqua, plus tard, que les Terres du savoir, qui s’étendaient au-delà de Nova Alexandrie, s’agrandissaient elles-aussi de cycles en cycles, à mesure que progressait l’ensemble des connaissances humaines. Je n’eus pas le loisir de poursuivre ma réflexion plus loin. Car dès que les craquement eurent cessé, mon guide se replongea dans la lecture de ses écrits.
Ceux qui, à Sumer, maîtrisent l’écriture sont convoités. Pour les populations, ballottées par les fréquents changements de lit du Tigre et de l’Euphrate, les scribes représentent la garantie d’une stabilité, la persistance d’une certaine organisation. Quant à la monarchie naissante, elle a besoin d’eux pour servir sa propagande, commémorer ses victoire ou établir sa justice. Mais ils ne seront jamais nombreux. «Les textes transmettent 30 noms pour une grande ville comme Girsu à l’époque DA IIIb, une centaine à peine pour l’empire akkadien et 1600 sur quatre générations à l’époque de la IIIe dynastie d’Ur (2112-2004), période durant laquelle l’économie est pourtant très bureaucratisée », recense Jaroslaw Maniaczyk. A l’apogée de l’écriture cunéiforme, au IIe millénaire av. J.-C., des membres de la classe dirigeantes s’initieront à leur tour à la pratique de ses signes, qu’utilisent les Hittites d’Anatolie, les Hourrites de Mitanni, les Cananéens du Liban ou les Elamites sur le plateau iranien. En Egypte, les premières écritures hiéroglyphiques apparaissent elles-aussi vers 3200 av. J.-C. Les archéologues en ont retrouvé des traces, à la fin des années 1980, lors de fouilles dans une nécropole archaïque de la ville d’Abydos, sur la rive du Nil. Dans la tombe dite U-j, 125 étiquettes en os de quelques centimètres, sont incrustées de motifs dont certains peuvent être interprétés comme des embryons de hiéroglyphes. A cette époque pré-dynastique, les premières formes d’État apparaissent en Eypte. Et comme à Sumer, ces premiers dirigeants ont besoin des scribes pour asseoir leur pouvoir à travers la propagande. En particulier par l’intermédiaire du serekh (faire connaître, en Egyptien), emblème représentant de manière stylisée une façade avec niche, qui symbolise la présence du pouvoir à travers le monument où réside celui qui l’incarne. Apposé sur des jarres ou des sceaux pour marquer la propriété, ce ne sont d’abord que de simples énoncés-titres de quelques mots. Comme les pictogrammes sumériens, ils se prononcent largement, eux-aussi, sous forme de rébus.
Tout en parlant, Zératos-Thène se mit à dessiner à la craie, sur les parois, quelques exemple de pictogrammes simples et de hiéroglyphes formant des rébus que je m’amusai à déchiffrer.
En Chine, ce n’est que 2000 ans plus tard que les premières écritures apparaîtront. A Anyang, à environ 150 kilomètres au nord de Zhengzhou, les archéologues ont retrouvé des carapaces de tortues et des omoplates de bovidés, datant de 1250 à 1050 av. J.-C. Elles étaient polies et creusées d’une série d’alvéoles, à intervalles réguliers. Des pointes incandescentes y étaient appliquées pour provoquer des craquelures, dont la disposition était interprétée comme des oracles. « Une fois la divination accomplie, dans une partie des cas, on gravait des inscriptions destinées à enregistrer la question et le résultat », explique Viviane Alleton, sinologue à l’EHESS, dans les origines de l’écriture. L’art d’écrire ne s’étend qu’au IVe siècle av. J.-C. à l’administration chinoise. Là encore, l’astuce du rébus permet d’écrire des mots à plusieurs syllabes. Mais c’est l’alphabet, dont le plus ancien connu est celui des Phéniciens, mille ans avant notre ère, qui pousse le plus loin cette logique phonétique : au lieu d’associer des symboles à des syllabes, chaque son élémentaire – ou phonème – est représenté par une lettre, même quand il ne peut pas être prononcé isolément. Les Phéniciens choisissent pour chaque lettre la représentation stylisée d’un objet dont le nom, dans leur langue, commence par ce son. La tête de bœuf, qui se prononce Aleph, devient la lettre A. le dessin d’une maison – Beth – donne la lettre B. Avec quelques dizaines de symboles, on peut représenter tous les mots d’une langue. Les navigateurs propagent cette invention sur le pourtour de la Méditerranée. Les caravaniers la diffusent au Proche-Orient. Partout où il est repris, l’alphabet évolue. Car certaines lettres peuvent traduire des sons qui n’existent pas dans la nouvelle langue qui l’adopte. Inversement, celle-ci peut comporter des phonèmes que ne codent pas cet alphabet. D’où l’apparition régulière de nouvelles lettres, la disparition d’anciennes, ou la combinaison de lettres (comme PH, IN, ON pour coder le français) pour exprimer des phonèmes inédits. Chaque région, voire chaque cité, développe le sien. Les Etrusques en font un signe identitaire, comme le note Dominique Briquel, spécialiste du monde étrusque à l’Ecole pratique des hautes études « Chaque composante politique du monde étrusque a voulu manifester sa personnalité et sa différence par rapport aux autres, à travers l’emploi d’une écriture particulière », explique-t-elle dans Les premières cités et la naissance de l’écriture. Les grandes familles cultivent leur propre écriture pour témoigner de leur maîtrise des lettres. Ils se posent, en somme, en lettrés. Au sens propre comme au sens plus large d’individus « dotés d’une culture qui les distinguait du reste de leurs compatriotes, ne serait-ce que par le fait qu’ils savaient lire et écrire, ce qui n’était pas négligeable dans une société certainement encore très peu alphabétisée », souligne Dominique Briquel. Ecrire, déjà, divise les sociétés entre une minorité qui maîtrise cet art, et une majorité pour qui ces nouveaux signes restent indéchiffrables.
Zératos-Thène referma le livre, pensif, et le reposa méticuleusement dans le coffre. Ses mains esquissèrent un mouvement circulaire, comme à chaque fois qu’il s’apprêtait à me dire quelque chose d’important.
« Tout savoir donne un pouvoir, soupira le directeur de la Grande Bibliothèque qui, de fait, dirigeait l’organe suprême du pouvoir alexandrin. Cela donne une lourde responsabilité aux plus érudits. Et c’est lorsque ce pouvoir n’a pas pour compagnon la bienveillance que les ennuis commencent. J’ai bien peur que votre monde soit bien mal armé pour profiter pleinement des fruits que vous produisez pourtant avec tant d’efficacité. »
VI.3 – Jack Goody
J’en débattais, le soir, avec le tavernier de l’Auberge du Livre blanc, quand un vieil homme au visage fin comme une souris, coiffée d’une tignasse blanche et indisciplinée, m’apostropha.
– « Savoir… pouvoir. Si je peux m’introduire dans votre conversation, tout se joue, me semble-t-il, dans les modes de transmission d’un tel savoir. J’aime à dire que si le langage nous a fait humain, c’est l’écriture qui nous a fait « civilisés » », énonça-t-il pour relancer la discussion. Ce faisant, il s’extirpa de son siège pour s’approcher du comptoir.
« Pardonnez-moi, je vous entendais disserter d’un sujet qui m’est familier. Je ne me suis pas présenté : John Rankine Goody, mais appelez-moi Jack. »
J’avais entendu parler de cet anthropologue britannique, qui s’était réfugié plusieurs mois, pendant la seconde guerre mondiale, parmi les paysans analphabètes des Abruzzes, en Italie, pour y vivre une expérience ethnologique inédite : se retrouver un long moment sans pouvoir ni lire ni écrire. De cette aventure singulière était née sa passion pour l’étude des différences entre cultures orales et cultures écrites, et du pouvoir que donne l’écriture, tant sur la pensée que sur le monde. Après avoir étudié, dans La Raison graphique, publié dans sa version française en 1978, l’incidence de la représentation graphique du langage sur les formes de pensée, puis, dans La Logique de l’écriture, en 1986, l’incidence de l’écriture sur les organisations (Église, administration, banques…) qui l’utilisent, Jack Goody avait patiemment suivi son fil conducteur pour décrypter le pouvoir que donnait le langage écrit, désormais perçu comme « technologie de l’intellect ». J’avais parcouru l’ouvrage qu’il avait publié en 2007 – Pouvoirs et savoirs de l’écrit – dans lequel il avait rassemblé les conférences qu’il avait données sur ce thème entre 1986 et 1998. Sauf que l’anthropologue était mort, dans notre monde, le 16 juillet 2015, à 95 ans. Ce n’était donc pas véritablement « Jack » que j’avais devant moi, mais la représentation collective que nous en avions, nous les humains, et qui avait acquis suffisamment de force, par la puissance figurative de nos esprits, pour prendre une relative autonomie dans cet univers des Savoirs. J’étais en face de l’idée de Jack.
Qu’il fût fait de concept ou de matière, peu au fond m’importait. Je serrai sans façon la main qu’il me tendit. A la fois par politesse – je savais que les Nouveaux Alexandrins étaient très friands de rites de sociabilisation – mais aussi, et surtout, pour le plaisir de toucher de mes doigts une pure projection de l’esprit.
Jack me parut aussi réel que les nombreux chercheurs que j’avais pu rencontrer dans mon activité de journaliste. Et si je n’avais pas eu la certitude que l’anthropologue était bien décédé, j’aurais juré l’avoir effectivement rencontré ce jour-là.
« Jack » m’invita à partager une bière.
« Je m’intéresse au pouvoir du mot écrit sous deux aspects, m’expliqua-t-il aussitôt. Le premier est le pouvoir qu’il donne aux cultures qui possèdent l’écriture sur celles qui sont purement orales, pouvoir qui permet aux premières de dominer les secondes de diverses manières, dont la plus importante est le développement et l’accumulation de connaissances sur le monde. »
Il s’interrompit pour absorber une longue gorgée.
« L’autre thème majeur est lié au pouvoir que l’écriture peut conférer à certains éléments d’une société donnée. »
Je passai la soirée à écouter l’intellectuel de Cambridge, bientôt rejoint par d’autres clients de l’auberge massés en demi-cercle autour du comptoir.
Nous apprîmes que lire et écrire était resté, jusqu’au 19e siècle, l’apanage d’une élite de gens d’Eglise, d’aristocrates ou de bourgeois. Car l’avènement de l’écriture dans une culture, insistait « Jack », la scinde fatalement en deux groupes : ceux qui la maîtrisent et ceux qui ne la maîtrisent pas, offrant aux premiers un pouvoir sur les seconds. Le monde s’est donc divisé entre sociétés lettrées et sociétés purement orales, les secondes résistant mal aux premières. « L’écriture ne serait-elle qu’un outil de domination ? », demanda un client de l’auberge. « Et les peuples sans écriture ne seraient donc que barbares, de simples Iroukaïs ? » s’interrogeait un autre.
« Les personnes qui vivent dans des sociétés de tradition orale réfléchissent elles-aussi », crut bon de préciser Jack Goody pour nuancer cette inclination trop facile à considérer les cultures orales comme primitives. Des cultures où « les choses changent tout le temps mais personne ne s’en rend compte », nous raconta-t-il. Des cultures sans Histoire et sans Mémoire, dans lesquelles, selon les mots de l’auteur malien Amadou Hampâté Bâ, chaque fois qu’un vieil homme disparaissait, c’était comme si une bibliothèque brûlait, puisque tout ce qui avait été emmagasiné dans sa mémoire mourait avec lui. Abolissant les hiérarchies, les penseurs post-modernes, à la fin du 20e siècle, avaient voulu voir au contraire, dans les savoirs oraux, une légitimité aussi grande que celle des sciences écrites. Jack reconnaissait que les sociétés orales se montraient plus souples, l’absence d’orthodoxie écrite permettant l’expression d’une créativité permanente. Et finit par convenir, rejoignant son grand rival Brian Street, qu’il n’y avait pas lieu d’établir un grand partage, une dichotomie simpliste entre les cultures de l’écrit et celles de l’oral.
L’absence d’écriture influençait néanmoins, nous prévint-il, les modes de pensée des sociétés purement orales. Marquées par la nécessité d’un face à face avec les autres, elles entretenaient une solidarité directe et se méfiaient, constatait-il, des activités solitaires. Les religions tendaient à y avoir une portée plus locale, à être plus étroitement mêlées à la vie quotidienne. Les procédures légales y étaient moins gouvernées par des lois générales et des procédures formelles, puisque seuls les jugements les plus récents étaient véritablement restés en mémoire. Le contexte dominait, en somme, au détriment de l’abstrait. Le particulier l’emportait sur l’universel. Fallait-il pour autant s’en affliger ? Placer un système de pensée au-dessus d’un autre était une entreprise périlleuse, répondit Jack. Car s’il était aisé de constater que nulle société n’avait abandonné l’écrit une fois acquis, nulle n’avait jamais non plus prétendu se passer de l’oral. L’écrit, insista l’anthropologue, ne remplace jamais complètement la parole : « les moyens de communication se cumulent plutôt qu’ils ne se remplacent », répéta-t-il en demandant une nouvelle chope. Et l’écriture n’est pas toujours utilisée par les puissants contre les dominés.
« Les dominés, eux aussi, peuvent faire usage de ce moyen d’interaction avec leur environnement social », observa-t-il en sirotant son nouveau verre. Jack nous cita en exemple la révolte des esclaves noirs affranchis de la ville brésilienne de Bahia, au début du XIXe siècle. Celle-ci prit une ampleur inattendue grâce à la maîtrise que ces esclaves musulmans avaient de l’écriture, qui leur avait permis de s’organiser beaucoup plus efficacement face à des colons pour beaucoup analphabètes. Pouvoir et savoir ne sont donc pas toujours dans le même camp.
Nous en débattîmes jusqu’à ce que l’auberge ferme et que le patron, avec autant de gentillesse que de fermeté, nous pousse dans la rue.
Je pris congé de Jack, étourdi mais ravi de cette rencontre quasi-surnaturelle. Je déambulais dans les ruelles de la vieille cité, profitant de la fraîcheur nocturne. Même à cette heure tardive, elle bruissait encore de badauds qui, comme moi, savouraient le plaisir simple de se mêler aux autres. Une habitude très méditerranéenne, songeai-je. Cette promenade me fit du bien, si ce n’était cette sensation, ressentie à plusieurs reprises, qu’une ombre me suivait.
VI.4 – Contact
Je passai le reste de la nuit à l’Hostel du Vieux Port, où Perce-neige avait sa chambre. Elle m’en avait réservé une autre, petite mais confortable, juste à côté de la sienne. Le matelas devait avoir l’âge de mes grands-parents, mon corps s’y enfonçait comme dans une vieille guimauve. Mais comme je n’étais pas bien lourd, cela n’avait guère d’importance. Le mobilier était dans la même veine : d’un âge canonique. Le bois sentait la mer. Les deux chambres offraient cependant une jolie vue des quais, d’où l’on voyait accoster et repartir les bateaux. L’activité y était continue, de jour et même parfois de nuit. Nous aimions observer les norias de matelots qui emplissaient ou déchargeaient les soutes, écouter les discussions – parfois vives – de capitaines et d’armateurs réglant leurs affaires, suivre les inspections des douanes et de la capitainerie. Ce port était le poumon économique de la cité. Il en alimentait les marchés en marchandises et les hôtels en touristes, érudits ou affairistes de tous poils. Certains devenaient pour quelques nuits nos voisins de chambrée.
L’adresse où nous logions avait bonne réputation parmi les marins, qui appréciaient l’accueil simple mais chaleureux que leur réservait le patron. Petit, très brun et au léger embonpoint, l’aubergiste était un autodidacte qui, bien que n’ayant pas eu la chance de faire de réelles études, avait tiré des nombreuses discussions qu’il lançait avec ses clients un savoir aussi solide qu’étendu. C’était un homme curieux de tout, et en particulier des vies qu’il percevait comme atypiques. Il questionnait alors sans relâche, voulant tout connaître, mais respectant nos silences dès lors que son intérêt heurtait des événements trop intimes. Pour ne rien gâcher, sa cuisine était excellente, l’aubergiste mettant avec son épouse plus discrète un point d’honneur à accorder ses plats aux goûts qu’il nous devinait. Je le soupçonnais de s’être pris d’une affection particulière pour Perce-neige, car je voyais bien qu’il était encore plus prévenant envers elle qu’envers les autres clients. Je n’en ressentais nulle jalousie, bien au contraire. J’étais heureux de constater que l’aura que mon amie avait dans mon monde se dupliquait à l’identique dans celui, pourtant plus abstrait, des projections de Nova Alexandrie.
Nous nous attardions le matin en terrasse, au soleil, trempant dans notre thé les copieuses tartines du petit-déjeuner, quand un adolescent se présenta à notre table. Il portait un message, signé de Zératos-Thène. Le directeur de la Grande bibliothèque nous mandait de venir le voir dès que possible, en toute discrétion. Nous nous préparâmes rapidement.
Nous empruntâmes la Grand-Rue qui remontait jusqu’à l’Agora. J’en profitais pour contempler l’architecture des grandes maisons et des hôtels particuliers qui la bordaient, dans un mélange de styles antiques et haussmanniens. Chacune de ces vénérables habitations portait en elle, dans la pierre massive, le double poids de l’Histoire et de la notoriété. Nous étions là à l’épicentre de la cité, dans les premiers quartiers qui avaient émergé il y a d’innombrables cycles, quand Nova Alexandrie n’était alors qu’une idée balbutiée dans l’esprit d’une poignée d’utopistes. L’artère grouillait de piétons, mais aussi de calèches et de véhicules électriques, juxtaposant sans grand ordre toutes les ères technologiques. Il était impossible de dire quel siècle l’emportait sur les autres, tous se mêlant de façon inextricable. Iris, s’il avait été avec nous, aurait dit que Nova Alexandrie se trouvait dans une superposition quantique de tous les états technologiques qu’avait connus l’humanité.
Nous arrivâmes sur l’Agora. La grande place était occupée par des grappes d’individus de tous âges qui conversaient bruyamment. Certains applaudissaient, d’autres sifflaient. J’en compris très vite la raison : il s’y jouait l’un de ces tournois de boule alexandrine qui me passionnaient. J’entraînai aussitôt Perce-neige pour assister au moins à une partie.
« Quand le sage montre la Lune, le fou regarde le doigt, prononça sentencieusement l’arbitre en lançant une petite bille appelée Prémisse.
– Mais il n’est de pire aveugle que celui qui ne veut point voir, énonça le premier joueur en lançant sa boule qui vint se placer non loin de la Prémisse.
– Hum… Quand le fou te trouve intelligent, le sage s’inquiète », riposta son adversaire en lançant la sienne, sous les murmures admiratifs de la foule. Sa boule alla se positionner un tout petit peu plus près. Le premier joueur pris un air contrarié. Il se concentra, guettant l’inspiration dans les quelques nuages qui flottaient dans le ciel.
« Mais le sage n’est-il pas lui même le fou… du fou ? »
L’argument fit mouche, et sa seconde boule, dès la phrase terminée, frappa d’un coup sec celle de son adversaire, qui fut éjectée du jeu. Celui-ci répliqua aussitôt par un nouvel aphorisme.
« Peu importe… La Lune existerait-elle sans le doigt qui la montre ? » La foule applaudit ce joli contre-pied, qui vint placer sa boule encore plus près de la Prémisse. J’étais curieux d’entendre quel argument l’autre joueur allait pouvoir lui opposer. A moins qu’il ne choisissât, à son tour, de décaler la dialectique.
Je n’en eus pas le loisir, car Perce-Neige me tira par la manche. D’un signe de la tête, elle m’indiqua un individu qui, se croyant caché derrière une colonnade, nous espionnait.
« Cela fait plusieurs fois que j’ai cette sensation que nous sommes observés », me confia-t-elle à voix basse.
Je me rappelai l’impression similaire que j’avais eue la nuit dernière. Nous nous remîmes en route, changeant plusieurs fois d’itinéraire, les sens aux aguets. Nous entendîmes clairement des pas accélérer derrière nous, et nous détectâmes à plusieurs reprises des regards nous cherchant dans la foule. Que nous voulait-on ?
Qu’importe, nous n’avions fait rien de mal. Et nous avions bien le droit, après tout, de déambuler à notre guise dans la cité. Nous préférâmes donc nous en divertir, jouant à cache-cache dans les ruelles de la vieille ville et nous mêlant sans cesse à la foule pour compliquer la tâche de ces mystérieux pisteurs.
Nous arrivâmes du coup fort tard devant la Grande Bibliothèque. Zératos-Thène nous attendait. Il nous reçut la mine grave et ferma derrière nous la porte de son bureau.
« Il semblerait, ma chère enfant, que vos démarches pour entrer en contact avec Périclès aient été couronnées de succès, chuchota-t-il à Perce-neige. Un émissaire m’a fait parvenir un message provenant de lui. Je n’ai aucun doute sur son authenticité : il contient des éléments que seul Périclès peut connaître, et qui identifient sans doute aucun l’auteur des lignes que j’ai reçues. Ces lignes, à dire vrai, vous étaient destinées. Elles vous fixent rendez-vous avec lui, dans le quartier des Utopies. Il vous attendra fort modestement dans la Cabane de Thoreau, au bord de l’étang de Walden. Je vous ai préparé une petite carte pour que vous puissiez vous y rendre. C’est un quartier sauvage, très boisé, qui devrait vous plaire. J’aime m’y promener, parfois, pour y être au calme et écouter les chants des oiseaux. Il vous suffira de vous y rendre et de l’attendre. Votre présence y sera de toute façon très vite remarquée. »
Zératos-Thène n’avait rien de plus à nous dire. Il s’était acquitté de son rôle de messager et nous fit comprendre qu’il était temps de prendre congé sans trop tarder. Même au sein de la Bibliothèque, des oreilles indiscrètes pouvaient traîner.
Une fois sortis, nous dépliâmes la carte qu’il nous avait confiée. Le quartier des Utopies y était un peu excentré. Il s’étirait en longues tentacules, comme autant de tentatives de repousser des frontières. Alors que les quartiers de l’Agora et de la Grande bibliothèque témoignaient d’un urbanisme maîtrisé et harmonieux, celui des Utopies tranchait par son exubérance, par ses excroissances qui semblaient mener nulle part. Chaque îlot y suivait sa logique propre, au détriment d’une cohérence d’ensemble qu’on avait peine à trouver.
Nous avions sans doute l’allure de touristes, car un tireur de pousse-pousse nous héla et proposa de nous conduire où nous voulions pour quelques Edels. Il en profiterait, nous promit-il, pour nous raconter ce qu’il savait des différents monuments, méritant ainsi le prix un peu élevé qu’il négocia pour sa course. Son air jovial nous convainquit. Nous nous installâmes sur la petite banquette, au-dessus de l’essieu, ravis de cette promenade impromptue.
VI.5 – Pousse-pousse
Ces pousse-pousse, qui sillonnaient les artères de Nova Alexandrie et qu’on pouvait héler pour quelques fractions d’Edel, étaient des engins étonnants. Comme leurs homologues de nos pays en développement, ils étaient tractés par des bras vigoureux. Mais ceux-ci bénéficiaient d’une assistance électrique. Aussi le tireur de pousse-pousse choisissait-il lui-même l’effort qu’il lui plaisait de fournir. Cette profession était donc majoritairement assurée, à Nova Alexandrie, par des sportifs qui aimaient courir et profitaient, en étant rémunérés, de la compagnie des clients qu’ils transportaient. Ils pouvaient ainsi transformer leur passion pour la course en un moyen fort utile pour tous de gagner leur vie. Nous n’avions donc aucun scrupule, Perce-neige et moi, à compter sur eux lorsque l’entrain nous quittait de marcher. Coureur et bavard, celui qui nous tracta ce jour-là ne dérogea pas aux solides préjugés qui encadraient ici la profession.
« Saviez-vous que ce petit hôtel particulier appartenait naguère à un célèbre chemineur ? », nous indiqua-t-il en désignant une étrange bâtisse qui fusionnait différents styles. Chacun de ses angles témoignait d’une passion pour une culture différente : architecture clairement grecque pour le côté est, plus romaine à l’ouest, égyptienne au sud. Quant au nord, il semblait être un équilibre entre influences aztèques et mayas. « La légende dit qu’à chaque angle logeait une maîtresse différente, l’une grecque, l’autre romaine, la troisième égyptienne et la quatrième sud-américaine, poursuivit notre guide. Et toutes vivaient en relative harmonie, paraît-il ; cette cohabitation n’a jamais viré au conflit de civilisation. Au contraire, à la mort du chemineur, la maison est restée un carrefour réputé où ont continué à se côtoyer quatre courants majeurs de civilisation, ce qui a donné lieu à des échanges particulièrement riches, qui perdurent encore. »
Il nous apprit que la boule alexandrine était une importation récente ; elle dérivait d’un jeu qui se pratiquait auparavant dans les terres lointaines de la Philosophie.
« Le jeu est né à Nova Athènes, je crois. En tout cas, c’est là-bas qu’on a toujours trouvé les meilleurs équipes. La diaspora novathénienne a fini par l’importer ici. Ils jouaient d’abord sur un petit terrain, près du port. Mais les Nouveaux Alexandrins se sont vite passionnés pour ce jeu. Et en quelques cycles on a commencé à organiser de grands tournois sur l’agora elle-même. »
Notre guide ne nous avait pas menti : il connaissait cette ville comme s’il y avait vécu des siècles. C’était peut-être d’ailleurs le cas, car j’ignorais combien d’années – ou de cycles – les gens d’ici pouvaient vivre. Combien d’années pouvait vivre une idée, ou la représentation d’une idée ? La question avait-elle même un sens ?
VI.6 – Guet-apens
Notre guide nous menait dans des ruelles de plus en plus étroites. Elles ne manquaient pas de charme, avec leurs murs en vieilles pierres et leurs petites terrasses ombragées sur lesquelles séchaient des guirlandes de linge. Je finis néanmoins par m’interroger : je connaissais encore assez peu cette cité, mais ces ruelles ne correspondaient en rien au plan que Zératos-Thène nous avait confié. Je fis part de mes doutes à Perce-Neige, qui examina à son tour la carte et interrogea le coursier. Il prenait un raccourci, nous assura-t-il, pour nous faire découvrir une partie peu connue de Nova Alexandrie, un quartier dans lequel les chemineurs de passage ne s’aventuraient que rarement. J’en étais ravi, mais le ton de sa voix ne rassura pas Perce-neige. Je la sentais un peu nerveuse, comme si son instinct la mettait soudainement en alerte.
Notre guide dut sentir lui-aussi cette tension naissante, car il accéléra et s’engagea brutalement dans l’arrière-cour d’un immeuble dont le portail se referma d’un coup sec derrière nous.
Je ne compris pas bien ce qui se passait. Un groupe d’hommes se jeta sur nous et nous recouvrit la tête de cagoules poussiéreuses. Nous criâmes aussitôt, nous débattant et appelant à l’aide, mais nos voix étaient étouffées par le tissu épais. Je suffoquais. Je sentais qu’on me liait les mains avec une corde qui brûlait la peau, puis qu’on m’enserrait le cou dans ce que j’identifiais comme un lourd collier. J’essayais de me calmer, sans y parvenir : qui étaient-ils ? Que nous voulaient-ils ? Etaient-ils des Frères de Périclès ? Mais à quoi rimait alors cette agression ? En voulaient-ils à notre bourse ? L’idée était ridicule : un Edel se fanait aussitôt qu’il n’était pas volontairement donné. Et ce monde portait de toute façon peu d’intérêt à toute accumulation matérielle. Non, ces hommes avaient un autre but. Mais lequel ?
Leur intention n’était pas de nous blesser : nous n’avions reçu aucun coup, et ils prenaient au contraire grand soin de nous faire le moins mal possible. Nous comprîmes néanmoins assez vite que toute résistance était vaine.
Mon angoisse était plus pour Perce-neige que pour moi-même, quoique je devinais qu’ils n’exerçaient pas plus de violence envers elle qu’envers moi. Ces hommes agissaient avec méthode et précision. J’oserais dire avec professionnalisme.
Nous fûmes enfermés tous deux dans une caisse, dont ils refermèrent le lourd couvercle au-dessus de nos têtes. Un bruit sourd succéda aux crissements métalliques des gonds. Je parvins à saisir la main de Perce-neige qui avait comme moi les poignets liés derrière le dos. Ce simple contact, dos à dos, nous apporta à tous les deux un grand réconfort.
Notre caisse fut posée sur une carriole à chevaux, dont les hoquets sur les pavés de la rue étaient fort inconfortables. Nous entendîmes bientôt des cris de marins et le bruit des vagues : nous étions sur le port. On nous monta à bord d’un navire, dans une cale obscure qui sentait l’humide et le rance, où nous restâmes un temps indéfini que j’estimais à quelques heures. Notre caisse s’ouvrit et l’on nous retira nos cagoules.
Perce-neige portait un collier métallique, un peu phosphorescent. J’imaginais que le mien devait être d’allure semblable. L’homme qui se tenait face à nous n’avait pas l’air franchement sympathique. Il avait les cheveux longs et sales, une barbe négligée et il puait la sueur. Pour autant, je mentirais en le décrivant comme agressif. Non, il était presque aimable, mais déterminé.
Il nous expliqua les règles du jeu : nous étions bien dans la cale d’un navire, voguant vers une destination qu’il ne pouvait nous indiquer. Peut-être ne la connaissait-il d’ailleurs pas lui-même. La cale n’avait aucune fenêtre, mais la faible lueur d’une lampe permettait d’en distinguer les contours. Il nous prévint qu’il ne nous serait fait aucun mal, que nous disposerions d’à boire et à manger, sous réserve que nous nous tenions sagement et que nous ne lui créions pas d’histoire. Il trancha nos liens d’un coup sec de son couteau. J’en profitai pour masser mes poignets douloureux.
La pièce où nous étions prisonniers était un rectangle d’une dizaine de mètres de long pour quelques mètres de large. Un matelas était posé par terre ; des provisions avaient été empilées à côté d’un tonneau d’eau. Notre geôlier nous montra un petit coin aménagé derrière un rideau pour nous soulager avec un brin d’intimité.
« Ne vous inquiétez pas, il suffit d’appuyer ici pour que tout parte à la mer », expliqua-t-il en joignant le geste à la parole.
Une chasse d’eau de mer se déversa dans la cuvette, pour s’évacuer grâce à l’ouverture d’une trappe. Bien que rustique et malodorant, ce bateau ne manquait pas d’astuces pour limiter l’inconfort.
L’homme nous déconseilla toute tentative d’évasion. « En pleine mer, vous n’iriez de toute façon pas bien loin, et nous serions contraints d’être moins sympathiques », nous prévint-il. Il nous souhaita malgré tout bonne nuit et ferma la porte à clé derrière lui. Un escalier grinça sous son poids.
Nous étions seuls à présent. Et guère rassurés : nous ne savions toujours pas ce que l’on nous voulait. Comme nous avions faim et soif, nous bûmes une rasade d’eau qui avait pris du fût un arrière-goût de vieux bois, et nous piochâmes quelques bouts de fromage, que nous découpâmes avec nos dents puisqu’on ne nous avait pas fourni, bien sûr, le moindre couteau. Nous fîmes de même avec une miche de pain dans laquelle nous mordîmes à pleines dents.
Il était clair qu’on ne voulait pas nous affamer. Bien au contraire. Fromages, charcuteries et salaisons, fruits secs, biscuits… il y avait là de quoi tenir plusieurs semaines. A vrai dire, cela ne nous rassurait pas vraiment : cette traversée allait peut-être durer. Et de fait, elle dura. Plusieurs jours, à en croire les rais de lumière qui frayaient par quelques ouvertures entre les planches du plafond.
Plusieurs fois par jour, notre geôlier ouvrait la porte à l’improviste et entrait pour vérifier ce que nous faisions. Nous le bombardions alors de questions, auxquelles il ne répondait pas.
Un détail nous inquiétait : malgré notre désir de revenir dans notre monde matériel, nous ne parvenions plus à interrompre notre séjour dans cet univers. La connexion semblait être devenue permanente, ce qui était fort fâcheux. « Vous perdez votre temps, finit par lâcher notre gardien devant Perce-neige plongée en méditation intense. Vous ne reviendrez jamais dans votre monde. Le collier vous en empêche. Il retient votre esprit ici plus sûrement que l’ancre de ce navire. Croyez moi, il va vous falloir vous faire à l’idée que vous êtes ici pour longtemps.
– Ce monde n’est pas pour me déplaire, lui rétorquai-je. Mais pourquoi nous y enfermer ? Quel gain en retirez-vous ?
– Ouh-là, je ne suis pas payé pour le savoir. Je vous surveille, c’est tout. Voyez ça avec le capitaine, si jamais il descend vous voir. »
Voyant s’entrouvrir une faille, Perce-neige consolida l’infime élan d’empathie qu’il venait d’exprimer. Elle se plaignit d’avoir atrocement mal et provoqua un bref échange tactile qui créa un trouble dans son esprit fruste.
« Qui nous en veut ainsi, susurra-t-elle alors d’une voix plaintive.
– Je… je n’en sais rien, pour sûr, je ne fais qu’obéir aux ordres du capitaine, bredouilla notre geôlier. Je vous aurais bien répondu, croix de bois. Mais ce n’est pas à moi qu’on explique ces choses. Tout ce que je peux dire, c’est que si le capitaine a pris l’affaire, c’est que vous vous êtes fait un ennemi puissant. Pour sûr, le chef ne se dérange pas pour de faibles gains. »
Nous n’en sûmes pas plus. Les jours et les nuits s’enchaînèrent, sans que jamais nous ne vîmes le capitaine. Fort heureusement, la mer était bonne. Ce qui nous évita d’ajouter à notre angoisse les nausées d’une houle trop forte. Je dus même reconnaître qu’il y avait dans notre mésaventure quelque avantage : je passais mes journées, et plus encore mes nuits, à côté de Perce-neige. Certes sur un mauvais matelas, humide et rance, mais ces longs moments passés seuls tous les deux, bercés par les vagues, nous tenant la main pour nous réconforter, apportaient à ce cauchemar des notes presque heureuses. Perce-neige fredonnait le soir des mélodies qui m’apaisaient aussitôt, et je lui racontais en retour des histoires qui mêlaient des références historiques, que j’avais acquises grâce aux enseignements de Camille, et des inventions de mon cru pour rendre le récit plus palpitant. Perce-neige me regardait alors avec des yeux d’enfants, écoutant mes histoires comme si elles les vivaient en elle. Nous finîmes par attendre avec impatience ces soirées où notre créativité se donnait pleinement à l’autre.
Nous percevions aussi les bruits hétéroclites de la vie à bord d’un navire : craquements de pas, voix indistinctes, cognements sourds d’objets qui tombent, claquements de voiles… Parfois les notes d’une guitare ou d’un banjo. Ces manifestations de vie nous rassuraient. Elles témoignaient que nous n’étions pas seuls. Du reste, qu’avions-nous à craindre de ces gens ? Il était clair qu’ils ne nous voulaient – au moins pour l’instant – aucun mal.
Au bout d’un certain nombre de jours que nous n’avions pas eu la présence d’esprit de compter, nous accostâmes. Où ? Nous n’en savions rien. Mais nous entendîmes l’agitation typique d’un quai portuaire, avec ses vendeurs à la criée, ses roulements de chariots sur les pavés, l’odeur des poissons empilés dans des cagettes…
Notre geôlier entra dans ce qui était devenu notre cellule, accompagné de plusieurs marins solidement bâtis. Après nous avoir lié les mains et bâillonné la bouche, il nous demanda avec courtoisie de le suivre. Nous n’avions aucune envie de résister ; cela n’aurait en rien changé l’issue d’une lutte que nous sentions par trop inégale. Nous montâmes donc sans protester sur le pont, pressés d’en finir avec tous ces mystères.
Il nous faudrait malgré tout attendre. Car on nous présenta une grande caisse dans laquelle nous fûmes « invités » à entrer. Un lourd pan de bois la referma derrière nous, nous plongeant dans une obscurité presque totale. Nous n’étions pas encore au bout de notre voyage.
Nous aurions pu crier, mais à quoi bon ? Dans le tumulte incessant du port, qui nous entendrait ? Nous n’avions aucune envie de gaspiller notre énergie et préférions au contraire tenir nos oreilles aux aguets pour essayer de deviner – mais comment ? – où nous pouvions bien nous trouver.
Nous nous sentîmes lentement soulevés. La lourde caisse où nous étions emprisonnés fut hissée sur une charrette, qui se mit en branle.
Au bruit, nous devinâmes bientôt que nous avions quitté la cité. Nous fûmes changés plusieurs fois de véhicules, certains motorisés, voire aéroportés puisque nous ne sentions plus aucun cahot de la route, d’autres plus rustiques, tractés par un animal dont l’odeur était épouvantable.
Nous bénéficiâmes de quelques pauses, méticuleusement encagoulés, pour boire, manger ou nous soulager sans pouvoir percevoir le moindre paysage. Nous apprîmes donc à uriner au jugé, sans savoir si quelqu’un nous regardait. Les actes les plus banals du corps se révèlent parfois les plus inconfortables pour l’esprit.
Nous finîmes par nous endormir de fatigue.
VI.7 – Captifs
Des murmures nous réveillèrent. Nous étions allongés sur une paillasse malodorante, dans le recoin d’une grande pièce fermée de barreaux. Autour de nous s’affairaient une dizaine de personnes.
Il y avait des hommes et des femmes, jeunes et vieux. Beaucoup avaient le regard absent de ceux qui ont cessé depuis longtemps de lutter.
Derrière un rideau, nous devinâmes des toilettes. L’odeur, et les mouches noires qui s’en échappaient bruyamment, nous dissuadèrent de les visiter tout de suite. Nous attendrions d’y être contraints. Notre séjour ici, où que nous fussions, promettait d’être plus inconfortable que sur le bateau.
Une clochette retentit; les regards de nos camarades d’infortune s’éveillèrent. Tout le monde se dirigea vers les barreaux qui fermaient l’accès au couloir. Un garde s’approcha d’un pas lent, traînant un chariot d’où s’échappaient des vapeurs de soupe. Il en versa des louches épaisses dans des bols qu’il nous tendait par une ouverture. Quand chacun eut sa part, il repartit. Sans avoir dit le moindre mot.
Cette soupe n’était pas mauvaise. C’était un mélange de choux, carottes et autres légumes, dans lequel traînaient quelques morceaux de viande grasse.
Un homme jeune, à la peau noire, s’approcha de nous.
« Bienvenus parmi les damnés. Alors ? Qu’avez-vous fait pour mériter votre place ici?
– Nous l’ignorons, répondis-je. Nous ne savons à vrai dire ni où nous sommes, ni pourquoi nous sommes là.
– Bien sûr, bien sûr… Tout le monde, ici, vous dira qu’il ne comprend guère ce qu’il fait là. Moi-même, voyez-vous, je m’obstine encore à me croire innocent. On m’accuse de plagiat ou, en d’autres termes, d’usurpation d’identité. C’est absurde, et je le prouverai.
– Ferme-là, tu nous emmerdes, protesta un grand chauve aussi épais du crâne que bas du front.
– Faites attention à lui, chuchota le « plagiaire », il est là pour refus de débattre et suppression d’argument. Il a plusieurs meurtres plutôt moches à son casier. »
Une femme dodelinait de la tête, le regard absent. Personne ne savait pourquoi elle était là.
Nous étions donc parmi les criminels de la Terre des savoirs. Là où finissaient les idées aussi dangereuses qu’irrécupérables. Nous y croisâmes des racistes, des fondamentalistes, quelques fascistes, toute une faune avec laquelle nous n’avions guère envie de débattre. La question qui me taraudait était plutôt de savoir ce que diable nous faisions parmi eux.
Les jours passèrent, tous aussi éprouvants les uns que les autres. Les tentatives de Perce-neige de questionner les gardiens échouèrent les unes après les autres. Ils semblaient avoir pour consigne de ne jamais nous répondre. Ou peut-être n’y voyaient-ils tout simplement aucun intérêt. Je ne pouvais guère leur en vouloir, tant la conversation avec certains de nos compagnons de cellule était un supplice pour la raison.
Nous ne pouvions pas dire cependant que nous étions maltraités. J’étais évidemment inquiet pour Perce-neige, tant l’arrivée d’une jeune femme dans un tel environnement me semblait propice à bien des débordements, qui ne survinrent pas. Quels que fussent leurs crimes, ces gens n’étaient ni violeurs, ni même réellement violents. Je ne savais si c’était parce que de tels comportements n’existaient pas dans la Terre des savoirs, ou si l’on avait pris soin de nous en éviter la redoutable compagnie.
Celui qui nous en voulait et avait organisé notre transfert ici, dans ce cul de basse-fosse, ne nous haïssait peut-être pas assez pour nous faire souffrir physiquement.
Hormis la crasse et la puanteur à laquelle, ma foi, on s’habituait, les lieux n’étaient d’ailleurs pas si terribles. Nous avions droit, chaque jour, à une promenade dans une cour ombragée cernée de hautes murailles. On nous fournissait trois repas par jour, qui n’avaient rien d’infects. Certains soirs on nous portait même des infusions relaxantes. Chacun y trouvait son compte : ce petit luxe nous apaisait, et les gardiens en trouvaient leur travail facilité d’autant. Bref, si nous étions encore loin de l’utopie carcérale, nous n’étions pas non plus en enfer.
VI.8 – Escape Game
Un soir, après nous avoir apporté une verveine, un garde oublia de verrouiller la porte. D’un regard, Perce-neige me fit comprendre qu’elle avait elle aussi perçu une occasion inespérée de hâter notre libération.
Nous attendîmes que nos rustres compagnons se fussent endormis pour nous éclipser. Non que nous voulions forcément nous échapper seuls, mais enfin, nous n’avions guère confiance en eux. Nous suspections que beaucoup étaient ici pour de bonnes raisons, que leur mauvaise foi refusait d’admettre. Libre à eux de s’enfuir à leur guise, mais nous n’allions pas leur mâcher la voie.
Nous parcourûmes le long couloir, sur la pointe des pieds. Il menait vers l’escalier en colimaçon que nous prenions chaque jour pour descendre dans la cour. Nous l’empruntâmes sans bruit, craignant à chaque instant de croiser un garde.
L’accès à la cour était fermé d’une lourde grille de fer forgé. Il nous fallait continuer à descendre. Au niveau plus bas se trouvaient les cuisines, qui étaient désertes. Nous passâmes ensuite devant un dortoir, d’où s’échappaient des ronflements réguliers, puis devant un autre, un niveau plus bas, et encore un autre… Cet escalier n’en finissait pas de descendre. Nous nous enfoncions toujours plus bas, des centaines de marches les unes après les autres. Nous commencions à être épuisés quand nous débouchâmes enfin sur un nouveau long couloir.
Il nous parut d’emblée familier, la faible lueur des torches en éclairant les murs sales. Il se terminait par une grande pièce fermée d’une grille. Perce-neige poussa un petit cri : elle aussi avait reconnu…. notre cellule !
C’était impossible, nous n’avions fait que descendre. Et pourtant, c’était bien la même cellule, les mêmes codétenus qui sommeillaient encore. Et la même porte qui était restée entrouverte.
Le plagiaire ouvrit un oeil et, devant nos mines défaites, il ricana.
« Oh, vous aussi, vous aviez cru pouvoir vous enfuir ! »
Son air goguenard nous fit l’effet d’un coup de massue.
« Mais comment… comment est-ce possible ? bégayai-je.
– Vous débarquez d’où, les amis ? Vous vous croyiez peut-être dans une prison d’Alexandrie ? Tu ne peux pas t’échapper d’ici, frère. Toute la prison est bâtie sur un paradoxe. C’est bien ce qui fait l’essence de notre peine. Tout, ici, défie la logique. Quoi de plus terrible pour embarrasser une idée… Tu auras beau descendre toujours plus bas, tu retomberas toujours ici. Pourquoi crois-tu qu’on appelle cette prison l’enfer d’Escher-Penrose ? »
Escher-Penrose ? Ce nom me disait vaguement quelque chose. Et tout d’un coup, je me souvins de ces représentations d’escaliers impossibles, descendant d’un étage à l’autre pour revenir sans cesse au point de départ, grâce à un habile effet de perspective. Nous étions enfermés dans cette illusion d’optique.
Les barreaux étaient dès lors inutiles puisque nous étions coincés dans une structure topologique sans issue.
« Croyez-moi, nous avons tous essayé de nous enfuir, poursuivit le plagiaire en ricanant de plus belle. Mais nous sommes à chaque fois retournés dans nos cellules. Cela fait plusieurs cycles que nous avons tous renoncé. On se demande d’ailleurs pourquoi ils se donnent encore la peine de fermer la cage. Pour nous laisser espérer, peut-être… Ou pour rire des nouveaux comme vous. »
Nous étions donc condamnés à errer sans fin dans une fausse perspective. Mais qu’allaient devenir nos corps physiques, dans notre monde matériel ? Peut-être, pensais-je, y étions-nous dans un état de coma, ou l’esprit absent. Je n’osais trop y penser. Il fallait trouver un moyen de sortir de là au plus vite ! Mais comment ?
Nous passâmes plusieurs nuits à nous évader, retombant à chaque fois sur notre cellule. Mais nous essayâmes encore. Et encore. Jusqu’à ce que l’épuisement, ou le désespoir, nous gagnât. Nous sombrâmes alors à notre tour dans une torpeur résignée.
VI.9 – Le paradoxe du menteur
Nous apprîmes peu à peu à reconnaître nos gardiens. Il y avait Tête-plate, bâti comme un roc, au souffle aussi court que sa pensée. Il ne parlait jamais, laissant ses muscles s’exprimer pour lui. Personne n’avait envie de lui chercher querelle. Il marchait en s’appuyant lourdement sur un gourdin, qu’il laissait parfois traîner derrière lui et racler le pavage.
Il y avait Chien-fou, au regard sadique, qui aimait nous houspiller et nous jouer des tours. Il remplaçait le sucre par du sel, nous réveillait en sursaut la nuit, urinait dans nos gobelets, que nous devions alors nettoyer. Tout cela le faisait rire aux éclats.
Il y avait enfin Queue-de-pie, à la mine austère et aux traits tirés. Son corps était raide comme une planche. Et son esprit n’en paraissait pas moins. Il donnait rigoureusement la même quantité d’aliments à chacun, remplissait les gobelets jusqu’au même repère invisible. L’idée même du désordre lui était insupportable. Aussi nous obligeait-il à faire nos lits au cordeau, sans le moindre pli. Nous devions nous présenter à lui par taille croissante, ou décroissante, à notre guise, c’était la seule souplesse qu’il permettait.
Perce-neige l’avait vite cerné comme un homme intègre, droit dans ses bottes, qui aimait que tout fût parfaitement logique, y compris notre propre présence en ces lieux.
Des trois gardiens, il était le mieux attentionné à notre égard. Sans doute n’avait-il rien contre nous : nous étions là pour une bonne raison, et sa mission consistait à nous empêcher de sortir. Sa pensée n’allait pas plus loin que ces quelques règles.
Son esprit logique, mais simple, n’était pas de taille à lutter contre Perce-neige, qui sut rapidement l’émouvoir. Je la voyais jouer un mélange de séduction et de faiblesse, rajouter de la chaleur dans sa voix quand elle s’adressait à lui. Elle cherchait la faille, et n’eut pas grand mal à la trouver.
Queue-de-pie eut bientôt le comportement d’un homme épris. Il trouvait le moindre prétexte pour traîner devant la cellule, observant Perce-neige à la dérobée, lui donnant double ration de nourriture sans que cela ne le troublât, et s’enquérant régulièrement de son état.
Que Perce-neige parût malheureuse lui fut assez vite insupportable. Sa logique lui suggéra donc de rendre son séjour aussi agréable que possible. Perce-neige s’ingéniait à le mettre au supplice par son air triste et les larmes qui perlaient par moments son regard. Il lui fallait en faire assez pour l’émouvoir, sans trop surjouer cependant, car le garde avait gardé un peu d’esprit et pouvait comprendre la manoeuvre si elle devenait trop grossière. Mais mon amie était une virtuose qui dominait tous les compartiments de ce jeu émotionnel. Moi-même, quand je la regardais, je me sentais le coeur malgré moi retourné.
« Je ne puis croire que vous soyez une mauvaise personne, soupira Queue-de-Pie face à Perce-neige qui éclatait un soir en sanglots. Votre présence ici m’est une énigme insupportable.
– Croyez-bien qu’elle l’est tout autant pour moi, lui répondit-elle en haletant. Car nous ne comprenons pas plus que vous ce que nous faisons ici. Cette situation est pire qu’injuste, elle est illogique.«
Je perçus sans mal le changement de timbre qui entourait l’adjectif. Perce-neige joua finement. Car couplée au profond attachement que le garde éprouvait pour elle, l’idée que notre présence fût illogique contamina bientôt son esprit. Si la présence de Perce-neige en ces lieux n’avait pas de raison établie, alors sa mission de l’empêcher d’en sortir n’en avait pas plus.
« Prouvez-moi que vous êtes innocente et je vous fais sortir sur le champ, se crut-il obligé de promettre. Qu’avez-vous donc fait tous deux pour vous retrouver ici? », nous demanda-t-il.
Mon premier réflexe fut de lui répéter, une fois de plus, que nous n’en savions rien. Mais je me ravisai aussitôt. Non seulement le sourire sarcastique du plagiaire me revint douloureusement en mémoire, mais ma raison me glissa qu’il y avait peut-être matière à tirer profit de ses rigidités et de son besoin pathologique de logique. Je tentai un coup de bluff.
« Nous avons été condamnés car nous serions de purs menteurs, incapables de dire la vérité.
– Dans ce cas, c’est donc que vous me mentez à nouveau », ne put s’empêcher de répondre fort logiquement le garde. »
Il devint perplexe, en proie à une intense réflexion dont je devinais l’objet. Sa logique trop rigide était en train de tourner en boucle : si j’avais menti encore une fois, c’était donc que je n’étais pas un menteur et que je disais la vérité. Mais si je disais la vérité, j’étais donc un menteur… Il ne savait comment s’extirper de ce piège connu de tout étudiant de première année en logique. Il s’épuisa à essayer, en vain, de résoudre ce paradoxe. Et pour ne pas perdre la raison, il dut sortir de toute logique et n’écouter que son coeur : n’avait-il pas promis de libérer Perce-neige si elle était innocente ? Les sanglots qu’il voyait ne pouvaient mentir. Libérée du carcan de la raison pure, son empathie amoureuse lui intimait d’aider cette jeune femme.
Il nous escorta lui-même, à la nuit tombée, vers la salle de garde déserte. Il se dirigea vers une petite bibliothèque, au fond de la pièce, et sortit de sa poche une petite clé qu’il introduisit dans un livre. La bibliothèque pivota comme une porte. En m’approchant, je découvris qu’il s’agissait bien d’une porte, sur laquelle avait été peinte une bibliothèque en trompe-l’oeil, d’un réalisme saisissant. Il fallut que j’en touche le bois pour me convaincre tout à fait qu’il n’y avait là aucun livre. Du reste, jamais je n’avais vu un seul de ces gardes en ouvrir un.
Nous suivîmes une longue galerie, fermée d’une dernière porte qu’il nous ouvrit en soupirant.
« Vous voilà hors les murs, nous lança-t-il. Partez, car je préfère vous savoir dehors que de vous voir briser ainsi la belle logique de ces lieux. »
Pour qu’il ne se ravise pas, Perce-neige l’embrassa chaudement.
« Merci« , lui murmura-t-elle.
Nous étions libres.
Libres de nos mouvements, mais sans savoir où aller. La Lune pleine éclairait devant nous une vaste steppe. Nous ignorions totalement où nous étions.
Nous choisîmes donc une direction au hasard et, pour ne pas tourner en rond et gaspiller nos efforts, nous décidâmes d’avoir constamment la prison dans notre dos. Quand elle fut hors de vue, nous nous fiâmes à la Lune et aux étoiles.
La température était clémente. Nous n’aurions pas à souffrir du froid. Le sol était rocailleux, mais l’herbe basse amortissait nos pas. Nous marchâmes plusieurs heures avant de trouver une petite colline surmontée de gros rochers. Nous décidâmes de nous y abriter pour dormir un peu.
VI.10 – De cause à effet
Les premières lueurs de l’aube nous réveillèrent. Je me levai aussitôt, les sens en alerte, guettant le moindre signe qui aurait pu révéler des gardes à nos trousses. Tout autour de nous, la steppe immense était silencieuse. Seuls quelques rapaces tournoyaient, en quête de rongeurs ou de quelques autres proies. La prison était déjà au-delà de l’horizon, hors de notre vue. Sur cette vaste plaine sans relief, nous aurions vite fait de voir quiconque s’approcher de nous. Mais l’inverse était tout aussi vrai : il y avait peu d’endroits pour nous cacher. Il nous fallait continuer à marcher, trouver une forêt dans laquelle nous pourrions disparaître avant que des moyens soient lancés à notre recherche. Nous ne pouvions rester sur ces rochers. Bientôt la soif, puis la faim, auraient fatalement raison de nous. Mais les quelques montagnes que nous percevions au loin étaient de bon augure : cette steppe avait une fin, que nous pouvions atteindre. Nous nous mîmes donc en route, en scrutant régulièrement derrière nous pour vérifier que nous n’étions pas suivis.
Par moments, j’essayais encore de m’enlever ce collier qui, depuis des jours, sans doute des semaines, m’enserrait le cou. Sans succès. Rien ne semblait l’user ni pouvoir le briser. Nous nous étions libérés du cachot, mais nous restions prisonniers de ce monde.
Je remarquai que le sol devenait de plus en plus humide, presque spongieux. Voilà qui était plutôt bienvenu, car la soif devenait lancinante. Des premières flaques apparurent bientôt, dans lesquelles nous trempâmes aussitôt nos mains et nos lèvres. Nous n’avions pas vraiment le loisir de vérifier que cette eau était potable. Nous prîmes le risque de la boire. Au moins paraissait-elle propre et claire, comme une eau de pluie.
« Regarde, me fit remarquer Perce-neige, la flaque grossit. »
Elle me montra en effet le rebord qui, à mesure que nous buvions, montait au lieu de descendre. Cela nous intrigua d’autant plus que d’autres flaques apparurent tout autour de nous, grossissant elles aussi. Étaient-elles alimentées par quelque source souterraine ? Nous reprîmes notre marche, contournant des mares de plus en plus profondes. Un ruisseau se mit à couler, comme jaillissant de terre. D’abord très faiblement, puis avec une vigueur croissante. L’eau semblait surgir de partout à la fois, car il y en avait autant derrière nous, sur des terrains que nous avions parcourus à sec, que devant. Elle sortait littéralement du sol. Guère rassurés, nous pressâmes le pas.
Les mares devinrent marécages, toujours plus longs à contourner. Le ruisseau avait maintenant la largeur d’une rivière. C’est alors que la pluie se mit à tomber. Quelques gouttes, d’abord, puis une forte averse. Des gouttes énormes s’aplatissaient sur nos têtes, sans que nous puissions nous en protéger. Des éclairs déchirèrent le ciel. Pour estimer la distance de l’orage, et apaiser ma peur d’être stupidement foudroyé sur cette plaine, je comptai le temps qui séparait chaque éclair du tonnerre. Le son se déplace en effet beaucoup moins vite que la lumière, à environ 340 mètres par seconde dans l’air à température et pression ordinaires. Résultat ? Si l’on considère la vision de l’éclair comme instantanée à notre échelle, il faut en revanche près de trois secondes au bruit du tonnerre pour parcourir un kilomètre. Je comptais donc les secondes, puis divisais par trois pour estimer notre distance au coeur de l’orage. Mais les résultats que j’obtenais étaient totalement incohérents. Je comptais parfois deux secondes, parfois vingt. Certains éclairs ne s’accompagnaient d’aucun tonnerre. Cet orage semblait prendre un malin plaisir à échapper aux lois de la physique élémentaire.
Alors qu’un puissant coup de tonnerre s’ensuivit quelques secondes plus tard d’un éclair très proche qui resta paradoxalement silencieux, je finis par tester une hypothèse absurde : que le son nous parvienne avant, et non après, chaque éclair. Il fallut me faire violence pour accepter de tester cette idée, tant elle heurtait la logique. Cela revenait à entendre un choc avant qu’il ne se fût produit, à entendre un cri avant de voir s’ouvrir la bouche. Et pourtant, je dus me rendre à l’évidence. Chaque éclair apparaissait bien quelques secondes après le bruit du tonnerre. Le son se déplaçait donc plus vite que la lumière. Ce qui, à la fois, me rassura sur le fait que l’orage était suffisamment lointain pour ne pas finir foudroyé, mais m’inquiéta sur les conséquences physiques qu’une telle inversion pouvait avoir.
Perce-neige, elle, se souciait comme d’une guigne de mes problèmes de théorie physique. Elle grelottait et je voyais bien qu’elle faisait des efforts surhumains pour ne pas me communiquer la terreur qui l’envahissait. Je cherchai du regard un abri dans lequel nous réfugier, mais il n’y avait autour de nous que pierres et herbe basse. Il nous fallait continuer notre route, et prier que la foudre continuât de nous épargner.
Je ne sais combien de temps nous marchâmes ainsi sous l’orage, trempés à l’os, mais une autre bizarrerie m’intriguait : plus la pluie tombait, moins les mares étaient grosses. Elles rétrécissaient à présent à vue d’oeil, comme si l’eau s’infiltrait cette fois plus rapidement dans la terre qu’elle ne tombait du ciel. A tel point que le sol finit par être sec, sous une pluie encore battante. Puis l’orage s’arrêta, sous un ciel noir et lourd, chargé d’une chaleur moite.
« Celui qui a dit qu’après la pluie venait le beau temps n’a pas dû naître ici », plaisanta Perce-neige. Le ciel restait en effet très orageux. Comme si la pluie tombée l’avait chargé en eau au lieu de l’en délester. Il ne se dégagea que très lentement, d’heure en heure, suivant une météorologie parfaitement fantasque. Peu nous importait, nous en avions profité pour boire jusqu’à plus soif. Je regrettais cependant que nous n’eussions pas de gourde pour faire quelques réserves.
La faim était un autre problème. Après une journée de marche, sans avoir avalé quoi que ce fût, nos forces commençaient à décliner. Et il était clair que nous serions le lendemain encore plus faibles. Que pouvions-nous trouver de comestible dans cette steppe ? Les réflexes archaïques du chasseur-cueillir, enfouis au plus profond de notre mémoire génétique, refaisaient par nécessité surface. Nous guettions la présence éventuelles de baies ou d’un tubercule à déterrer, l’herbe s’étant révélée à la fois amère et coriace. En soi, cela n’avait rien d’une révélation : il était clair que cette herbe sauvage était immangeable. Plus étrange fut en revanche de sentir clairement cette amertume avant même d’en avoir mis le premier brin en bouche. Comme si notre cerveau en avait parfaitement anticipé le goût hostile.
Je m’en faisais la réflexion quand Perce-neige, d’un signe, m’indiqua la présence d’un lièvre qui, se dressant sur ses pattes arrières, nous observait toutes oreilles dressées. En d’autres temps, nous l’eussions trouvé mignon. Sans doute aurais-je cherché à le prendre en photo. Mais la faim dicte ses lois et réduit l’empathie. Je me baissai lentement pour saisir une pierre, que je lançai vigoureusement vers cette promesse de repas. Bien sûr, je le ratai. Nul ne s’improvise chasseur en une journée. Ma surprise fut ailleurs : le lapin détala avant même que la pierre ne pût l’atteindre mais, surtout, j’entendis clairement le bruit qu’elle fit avant même qu’elle ne cognât le sol !
Gagné d’une terrifiante intuition, je me mis à lancer plusieurs pierres autour de moi. Mes soupçons se confirmèrent : elles firent toutes un bruit sourd avant de toucher le sol. Autre fait étrange sur lequel j’attirai l’attention de Perce-neige, des brindilles d’herbe, à chaque bourrasque, remontaient le vent au lieu d’être poussées par lui.
Ainsi donc, l’herbe de cette steppe dégageait son amertume avant d’être mise en bouche, et remontait les rafales de vent au lieu de les suivre. Le bruit d’une pierre s’entendait avant qu’elle ne tombe, et celui du tonnerre avant qu’il n’éclate. Tout cela n’avait aucun sens. A moins que…
Je ramassai quelques pierres que j’assemblai volontairement en un édifice en équilibre instable.
« Que fais-tu ?, me demanda Perce-neige.
– Si je te le dis, tu vas te moquer de moi. Je teste une intuition. Elle est si farfelue que je n’ose encore la formuler. »
Je continuai à poser une pierre sur l’autre jusqu’à construire une petite colonne. Puis je m’éloignai de quelques pas et pris une grosse pierre dans mes mains. Je demandai à Perce-neige d’observer tandis que je la lançai avec force sur ma colonne de pierres. Il se passa ce que j’avais prévu mais ne pouvais encore formuler en phrases tellement cela défiait le sens commun : la colonne s’effondra au moment où la pierre lâcha ma main. Et nous entendîmes tous deux clairement le choc qu’elle fit juste avant de cogner une colonne qui n’existait déjà plus.
« Crois moi si tu peux, mais je ne vois qu’une explication à ce prodige.
– Laquelle ?, demanda Perce-neige, désemparée.
– Après avoir été enfermés dans une prison de paradoxes, nous devons à présent renoncer au postulat fondamental de toute logique : une cause précède son effet. Là, dans cette steppe, c’est l’inverse qui se produit : l’effet précède sa cause. Le bruit se propage avant le choc, la tour s’écroule avant que la pierre ne la frappe. Et je suis sûr qu’un feu te brûle avant même qu’il ne s’allume, que l’eau se transforme en glace avant que la température ne baisse et que la glace fond juste avant que le soleil revienne. Ne me demande pas comment cela peut être possible, je ne fais que le constater avec toi. »
Perce-neige resta un moment interdite. Elle réfléchit en silence puis se mit à marcher dans la boue.
« Ton raisonnement ne tient pas. Regarde, les traces se font bien après que mon pied s’enfonce dans la boue et non avant… »
En effet, je ne pus que le constater. Cette fois c’était moi qui restais perplexe. M’étais-je trompé ? Je fis tomber une pierre dans la boue : la trace apparut cette fois clairement avant qu’elle ne touchât le sol. Pourquoi n’en était-il pas de même avec nos pas ?
« Je crois comprendre, finis-je par dire. Car imagine que la trace se fasse dans la boue avant que tu n’y poses ton pied, mais que tu décides finalement de ne pas poser ton pied et de le garder en l’air. Alors la trace ne peut pas apparaître, puisque la cause n’existe plus. Or, elle est apparue, tu l’as vue. L’effet précédant la cause, tu serais alors obligée, dans ce monde, de poser ton pied. Ce qui nierait ton libre arbitre et ta liberté de le poser finalement ou pas sur le sol. La différence avec la pierre, c’est qu’elle n’a pas de libre arbitre : une fois que je la laisse tomber, elle ne peut pas décider de ne plus chuter. Et c’est pour cela que la trace apparaît avant qu’elle ne s’écrase au sol. Ce monde est rempli de paradoxes, mais il ne peut pas pour autant s’affranchir de toute logique. Car un monde sans logique ne pourrait avoir la moindre structure stable. »
Perce-neige acquiesça. Cela lui semblait… logique. Et je me mis à réfléchir sur les implications d’un tel monde, dans lequel la conscience d’un événement prenait une importance singulière, puisque – l’effet précédant la cause – voir quelque chose se produire impliquait que la cause qui en était à l’origine ne pouvait que fatalement arriver. Cela donnait à la conscience la capacité, en quelque sorte, de lire partiellement dans l’avenir, du moment que cela n’impliquait pas le libre arbitre d’une autre conscience.
Nous marchâmes encore quelques heures, avant de nous écrouler de fatigue sur un lit de branchages. La nuit tombait. Nous nous endormîmes rapidement.
VI.11 – Ravin de flammes
Nous reprîmes notre marche aux premières lueurs de l’aube. Épuisés dès le réveil. Mais que faire si ce n’était d’avancer. Nous ne pouvions prendre le risque d’être rattrapés par les gardes, bien que nous n’en eussions vu aucun derrière nous. Sans doute étaient-ils convaincus que la steppe aurait de toute façon raison de nous. Leur désintérêt pour nous n’était pas de bon augure. Qu’importe, nous posions un pas devant l’autre, la bouche sèche et l’estomac en feu, quand la steppe était sans fin. Serait-elle notre tombeau ? Les larges vautours qui tournoyaient haut dans le ciel semblaient s’en convaincre. Ils n’avaient cure de nos efforts : ils avaient le temps pour eux.
« Dis-moi Sam, est-ce un mirage ou vois-tu bien comme moi à l’horizon ? », finit cependant par articuler Perce-neige.
Je fronçai les yeux pour voir au loin. Une vague ligne sombre zigzaguait à l’horizon. Elle dansait sous le soleil.
En nous rapprochant peu à peu nous comprîmes qu’il s’agissait de l’ombre d’un gouffre qui zébrait toute la plaine. Et quand nous fûmes encore plus près, nous réalisâmes la profondeur incroyable qu’il devait avoir. Ses dimensions gigantesques nous apparurent quand nous en arrivâmes tout à fait au bord. Il était si profond que nous pouvions à peine en voir le fond qui rougeoyait comme une rivière de lave. Il devait faire au moins une centaine de mètres de largeur. Impossible de le franchir. Nous ne pouvions plus avancer.
Nous longeâmes le ravin durant des heures, dans l’espoir de trouver un passage. Nous ne pouvions ni revenir en arrière, ni avancer. Je comprenais à présent pourquoi personne ne s’était lancé à nos trousses. Ce territoire était sans issue. Nous avions le choix entre une mort rapide au fond du ravin, ou une plus lente, de soif et de faim, avant que les vautours ne fassent de nous leur affaire.
Perce-neige me montra cependant du doigt un passage, d’une dizaine de mètres qui traversait le ravin. Il formait comme une brisure ponctuelle sur la ligne que le gouffre dessinait sur la steppe. Un pont entre deux mondes. Mais notre joie fut de courte durée. Ce passage était traversé d’écrans de feu qui surgissaient du sol de façon totalement aléatoire, duraient plusieurs secondes, puis s’éteignaient tout aussi spontanément. Parfois dans les premiers mètres, parfois les derniers, ou entre les deux. Mais ils étaient à chaque fois si denses qu’il n’était pas possible de s’aventurer sur ce pont de pierre sans se faire rapidement rôtir. Je m’écroulai de désespoir.
« Allons-nous vraiment mourir ici ? », se lamenta Perce-neige. Je ne savais que dire pour la réconforter. Nous restâmes prostrés, résolus à rester au bord de ce pont infranchissable, sans avoir la force de continuer ni dans un sens ni dans l’autre. Mes oreilles bourdonnaient par manque de sucre. Mes pensées devenaient confuses. Allions-nous à la fois mourir symboliquement dans ce monde et physiquement dans le nôtre ? Nous nous installâmes sur des branchages pour que notre fin fût au moins confortable. Je ne sais combien de temps nous restâmes ainsi, les yeux vers le ciel, à suivre les ronds que dessinaient les charognards ailés.
Une idée me traversa soudain l’esprit. Les pensées s’enchaînèrent d’elles-mêmes les unes aux autres, dans un dernier effort de mon cerveau à assurer sa survie : le pont était infranchissable parce qu’il était impossible de prévoir quand et où les écrans de feu allaient apparaître. Nous ne pouvions qu’avancer au hasard, jusqu’à ce que la malchance nous grille fatalement sur place. Mais si, par un moyen quelconque, nous avions la possibilité d’anticiper, ne serait-ce que de quelques secondes, l’apparition d’un écran devant nous. Nous pourrions alors nous arrêter, attendre qu’il disparaisse, et continuer ainsi, mètre après mètre, jusqu’à l’autre extrémité du pont.
Mon cerveau explora l’éventail des possibles, à l’affût d’une solution. Du feu, des brûleurs aléatoires, dans un monde où l’effet précède la cause… je pris une longue branche et l’approchai du pont. J’attendis quelques instants quand, d’un coup, le bout s’enflamma et se calcina spontanément. Deux secondes plus tard, le rideau de feu se leva là où se trouvait auparavant l’extrémité du bâton. Nous pouvions donc anticiper de deux secondes, au moyen d’une branche, l’apparition des flammes. Deux secondes qui séparaient la vie d’une mort douloureuse.
J’expliquai mon plan à Perce-neige. Il était dangereux, ne reposait que sur une intuition – certes corroborée par une expérimentation – et nous garantissait de mourir en cas d’échec. Autant dire qu’il n’était pas vendu d’avance. Mais qu’avions-nous comme alternative ? Au moins mon stratagème avait-il une chance de réussir. Mon amie se laissa convaincre.
Nous rassemblâmes autant de bâtons que Perce-neige pouvait en tenir dans ses bras. J’en pris un que je tins à bout de bras. Nous nous plaçâmes de façon à former une ligne parallèle aux rideaux de feu. Nous avancions lentement tandis que je guettais l’extrémité du bâton. Quand il se calcina, je lui criai de reculer. Deux secondes après, la chaleur était suffocante, mais nous étions en vie. Dès que les flammes s’atténuèrent, je repris un bâton que je tins à nouveau à bout de bras, et nous reprîmes notre marche. Nous stoppèrent à nouveau quelques mètres plus loin, et je repris un autre bâton. La chaleur était atroce, mais nous n’avions pas pris feu. Nous progressâmes, mètre après mètre, terrorisés à l’idée qu’une flamme plus sournoise surgisse sans prévenir. Après tout, que savions-nous vraiment de ce monde ? Notre stock de bâtons était quasiment épuisé quand nos pieds touchèrent enfin l’autre rive du ravin. Nous avions réussi !
Nous titubâmes jusqu’à l’eau claire d’une petite source qui jaillissait entre deux rochers. L’eau fraîche labourait notre gorge gonflée. Nous étions vivant ! Je dressai un poing rageur vers les vautours. Décidés à survivre, nous nous remîmes en route.

